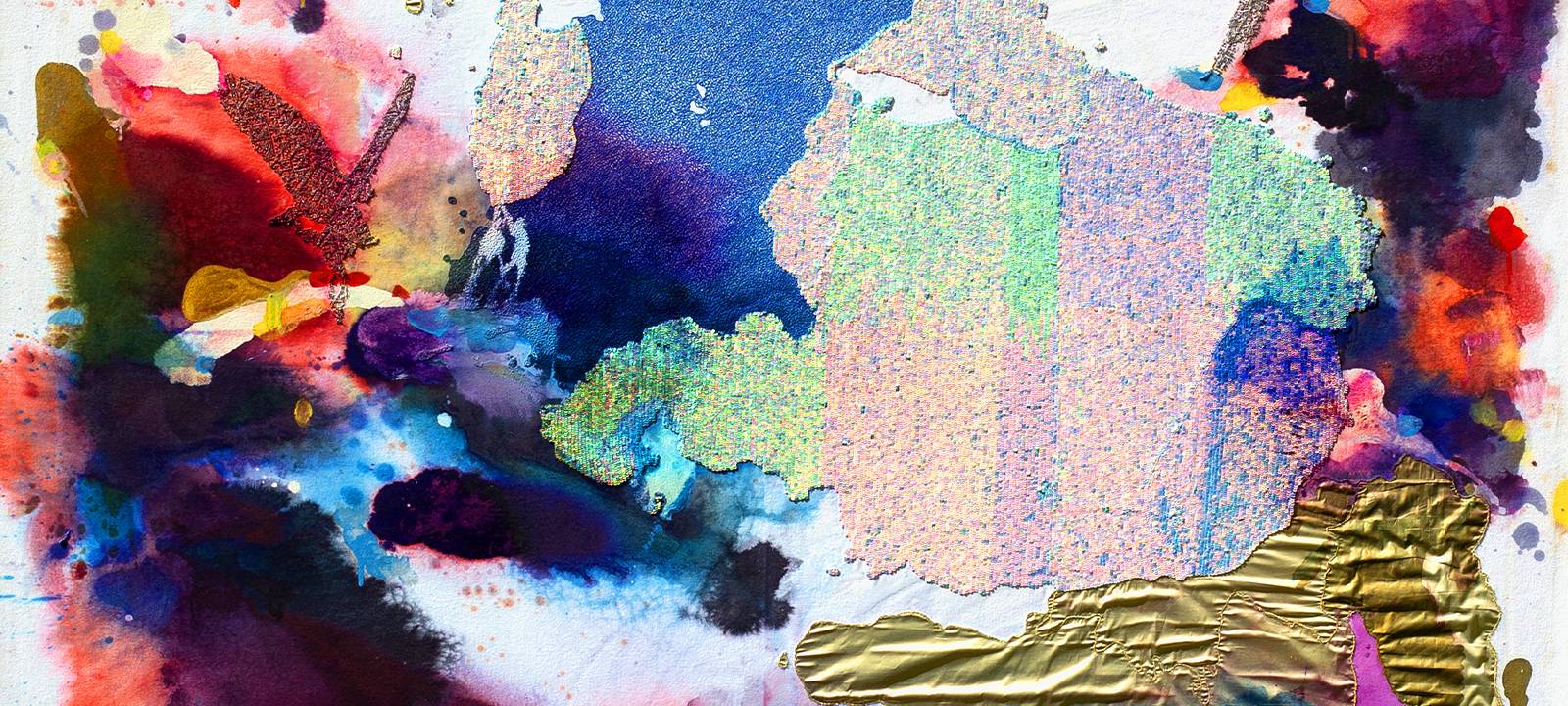9

9
Rencontre avec Isabelle Huppert, cover star de Numéro art avec La Joconde
Numéro art dévoile sa nouvelle couverture avec Isabelle Huppert photographiée au musée du Louvre devant la Joconde. Au sein de la série réalisée par Reto Schmid, l’iconique actrice revisite ainsi les plus grands chefs-d’œuvre de l’institution. Découvrez son interview publiée dans le tout dernier Numéro art 14, actuellement en kiosque, où Isabelle Huppert revient sur son expérience de tournage du film Sidonie au Japon d’Élise Girard, actuellement en salle.
Couverture par Reto Schmid,
Stylisme par Natacha Voranger Thibaut Wychowanok.
Publié le 9 avril 2024. Modifié le 12 septembre 2025.

L’iconique actrice française a accepté de nous accompagner au musée du Louvre pour en revisiter les plus grands chefs-d’œuvre. En dialogue avec La Joconde, la Victoire de Samothrace ou la Vénus de Milo, Isabelle Huppert se métamorphose et interprète tour à tour, dans cette série exclusive pour Numéro art 14, une galerie de personnages saisissants et charismatiques. À l’affiche de Sidonie au Japon d’Élise Girard, sorti en salles début avril, et récemment au théâtre avec Bérénice de Romeo Castellucci, la Française incarne plus que jamais la comédienne ultime, capable de tout jouer, à la fois glamour et mystérieuse, libre et audacieuse.
Rencontre avec Isabelle Huppert, en couverture du Numéro art 14
Numéro art : Quand on pense à votre rapport à l’art, vient tout de suite en tête l’un de vos premiers grands rôles. Dans Aloïse, le film sorti en 1975, vous incarnez une artiste peintre, schizophrène et internée. Quel souvenir en avez-vous?
Isabelle Huppert : C’est un film auquel je tiens beaucoup, c’était en effet l’un de mes premiers très beaux rôles. Si je l’aime autant, c’est aussi parce que c’est un film de Liliane de Kermadec, qui n’est plus là et que j’aimais beaucoup. Liliane, c’est une des premières à m’avoir fait tourner. Et puis c’est un film avec Delphine Seyrig, que je n’ai pourtant pas vraiment rencontrée quand j’ai fait le film. Nous nous sommes juste croisées, je m’en souviens bien, dans le hall d’un hôtel, elle partait quand j’arrivais, moi je tournais Aloïse jeune et elle Aloïse adulte. Le film m’a aussi fait découvrir le mouvement de l’art brut et Dubuffet, qui a initié ce mouvement. Je me souviens qu’à l’époque, j’avais pu voir la grande collection d’art brut dans un lieu fermé au public, rue de Sèvres. J’ai des souvenirs très précis de ces artistes qui n’étaient pas socialement définis comme tels. L’un d’entre eux avait creusé les murs de sa cellule avec une petite cuillère. Des panneaux en bois, creusés à la petite cuillère. À chaque fois que je vais à Lausanne, où la collection est présentée désormais, j’en suis très émue. Ce sont des artistes qui font éclater le récit, la normalité, des artistes qui ne savent pas qu’ils le sont. Aloïse, elle, était schizophrène, elle a passé trente ans en hôpital psychiatrique. Elle peignait sur ce qu’elle pouvait, des immenses pans de papier kraft reliés entre eux avec de la ficelle. Elle rêvait d’être actrice et de prendre des cours de théâtre. Dans le film, elle marche sur une scène et le directeur du théâtre lui pose une question. Je ne me souviens plus de la question, mais la réponse était : “Ça ne me fait pas peur une grande scène vide, ça n’est pas ça qui me fait peur.” Je n’ai jamais oublié cette phrase.

On vous connaît beaucoup de collaborations avec des metteurs en scène qui sont aussi considérés comme de grands plasticiens. Je pense à Bob Wilson, avec qui vous jouerez Mary Said What She Said à Londres en mai, ou à Romeo Castellucci, pour qui vous avez récemment interprété Bérénice.
Leurs propositions peuvent parfois susciter l’incompréhension. C’est comme des langages qui ne se comprennent tout simplement pas. Pour ma part, ce sont justement des langages auxquels je n’oppose aucune résistance. Pour moi, c’est toujours un terrain de jeu, une aire de liberté. Cela peut paraître contraignant parce que, c’est vrai, je me glisse dans une forme qui m’est proposée, mais je n’ai pas le sentiment de renoncer à ce qui fait l’essence même de mon plaisir et de ma nature d’actrice. Pas une minute. Bien au contraire, je dirais. De la contrainte naît la liberté… Enfin pas toujours !
Êtes-vous particulièrement attirée par des metteurs en scène à la vision plastique affirmée ?
Je ne suis pas attirée que par cela. Le théâtre est un champ large. Je suis attirée par les expériences. Je peux aussi faire un théâtre plus classique. Je peux aussi éprouver beaucoup de plaisir à jouer La Mère de Florian Zeller dans une proposition qui n’a, évidemment, strictement rien à voir.
Castellucci explique, à propos de Bérénice, qu’il essaie de pousser une version hard-core du théâtre. Partagez-vous cette ambition ?
On sait bien que, la plupart du temps, Romeo Castellucci aime faire ressortir tout ce qu’il peut y avoir de plus hard-core au théâtre. On l’imagine mal mettre en scène une pièce de boulevard. Nous avons surtout la chance que la France accueille des spectacles comme le sien. Il y a ici une facilité à faire exister ce genre de propositions. Vous ne verrez certainement pas cela aux États-Unis, même si, historiquement, il y a eu des propositions singulières, comme avec le Living Theatre.
Qu’avez-vous retenu de vos expériences avec Bob Wilson, que vous retrouvez en mai au Barbican à Londres ?
Ma première collaboration avec Bob Wilson date de 1993 avec Orlando. Puis il y a eu Quartett de Heiner Müller et enfin Mary Said What She Said. Bob Wilson modifie fondamentalement la perception du temps et de l’espace au théâtre. Et le rapport au corps. Il y a eu un avant et un après Bob Wilson. Et puis il y a la lumière.
Lorsque vous tournez au cinéma, vous posez-vous beaucoup de questions sur votre personnage ?
J’ai honte de le dire… Mais pourquoi j’aurais honte d’ailleurs? Je ne me pose jamais de questions. Ni avant, ni pendant, ni après. Je ne m’en pose pas parce que j’ai déjà toutes les réponses. Les réponses vous sont apportées au fur et à mesure par le film. Elles ont déjà commencé à vous être apportées, je pense, dès lors qu’on TW décide de faire le film. Le point le plus crucial, c’est le moment de la décision de faire le film. C’est l’instant décisif ! Et à partir de là, c’est comme un fil très ténu, et très long, qui se dévide. Et la pensée est en marche. En fait, le cinéma ou le théâtre, ce n’est que de la pensée. Ce n’est pas tellement autre chose. Après, évidemment, c’est aussi tout le reste. Mais c’est de la pensée, une pensée inconsciente aussi.

Dans Sidonie au Japon, sorti au cinéma au début du mois d’avril, vous jouez une écrivaine aux prises avec le fantôme de votre mari lors d’un voyage au Japon. Comment la réalisatrice Élise Girard vous a-t-elle présenté le film ? Est-ce une histoire de triangle amoureux avec le fantôme de votre mari et votre éditeur, avec lequel des liens se tissent ? Ou plutôt un récit sur le déplacement et l’expérience d’un ailleurs inconnu ?
Je retiens plutôt cette dernière définition, c’est un film sur les sensations. J’ai rencontré Élise alors qu’elle tournait un film avec ma fille Lolita Chammah – Drôles d’oiseaux. Le film était merveilleux et Lolita ne l’était pas moins. Je ne sais plus quelle a été sa façon de parler du film, mais je crois qu’elle m’a dit qu’il se tournerait au Japon. Bien sûr, cela convoquait un certain nombre d’images. Ce n’est que dans un second temps qu’est venue l’histoire du fantôme, de cette écrivaine, une femme qui doit surmonter un événement tragique de sa vie.
Le film déjoue le cliché d’un Japon aux rues agitées pour nous plonger dans des environnements au calme et à la sérénité étonnants. Un sentiment renforcé par le rôle prépondérant du silence dans le film.
Oui, les voitures sont calmes, la foule est calme. Dans la journée, les gens se déplacent comme ça, très doucement. Même s’il est vrai qu’y coexiste aussi la vie animée de la nuit… Élise a un vrai talent pour laisser infuser la poésie du pays. Et pour filmer les silences, comme pour les scènes dans la voiture. Toutes ces scènes d’une grande douceur, ces moments dans le taxi et le silence éloquent qui règne entre mon personnage et son éditeur [l’acteur japonais Tsuyoshi Ihara] sont très émouvants. Aucun bruit ne vient parasiter leur trajet intime et intérieur qui suit le trajet de la voiture.
Comme actrice, j’ai quand même une bonne imagination : n’importe quelle situation m’inspire.” – Isabelle Huppert.
Élise Girard se joue des genres en mêlant le fantastique et des pointes de burlesque. Votre personnage semble parfois se déplacer dans l’espace comme s’il était ahuri. On se croirait dans un film de Tati.
Le film joue sur les contrastes. Lorsque j’arrive à l’aéroport, à Tokyo, je rencontre l’éditeur japonais, et tout de suite notre différence de taille saute aux yeux. Les contrastes sont alors propices au burlesque. Lui, qui marche très vite, et moi, qui lui court après… C’est très drôle. Ça s’est fait très naturellement parce que cela était induit par la situation. Comme actrice, j’ai quand même une bonne imagination : n’importe quelle situation m’inspire.
Sidonie au Japon : un récit sur le déplacement et l’expérience d’un ailleurs inconnu…
Le fantôme de votre mari apparaît et disparaît avec une grande simplicité et une grande banalité, sans effets visuels superlatifs. Comme s’il revenait à la vie, puis quittait la pièce…
Curieusement, plus il est vivant, visible, et plus il est vivace, comme une plante un peu maléfique, envahissante. Il fabrique de la vie, mais une vie mortelle. C’est une vie qui empêche Sidonie de vivre. Et puis, plus il disparaît, et plus, évidemment, il y a le chagrin. La bonne idée, c’est de ne pas en avoir fait un fantôme morbide, mais un fantôme vivant qui est d’autant plus destructeur qu’il est vivant. Il finit par disparaître, et l’on comprend qu’il laisse une place libre. Alors ça ne va pas sans nostalgie et sans émotions, mais le deuil se fait. Sidonie peut finalement accueillir quelqu’un d’autre dans sa vie. C’est l’histoire d’une renaissance.
Une partie du film se passe sur l’île de Naoshima, qui accueille parmi les plus beaux musées au monde. On vous voit de dos face à des photographies d’Hiroshi Sugimoto. Un clin d’œil amusant quand on sait que le Japonais a réalisé votre portrait.
On aurait eu envie de rester plus longtemps à Naoshima. C’est l’inconvénient quand on tourne, on n’est pas forcément disponible pour profiter des lieux que l’on visite… Je n’y étais pas comme touriste, j’y étais en tant qu’actrice, c’est-à-dire dans mon monde à moi. On oublie ce qui nous entoure. C’est assez curieux. Enfin à Naoshima, le lien est tellement unique qu’il est difficile de ne pas le regarder.

On est fasciné par la fascination que La Joconde exerce. On ne sait plus si c’est la sienne ou si c’est celle du monde entier. On peut la regarder éternellement… ” – Isabelle Huppert.
Nous venons de passer une journée dans un autre lieu artistique, le Louvre. Quelle relation entretenez-vous avec les musées?
Ce sont les premiers endroits dans lesquels je vais dès que j’arrive dans une ville. J’ai l’occasion de voyager dans de nombreux lieux à travers le monde. J’arrive, et je ne connais rien, et je ne connais personne. J’adore tourner dans ces conditions et ce n’est pas forcément au cinéma que je vais spontanément, mais plutôt dans un musée. J’y ai des souvenirs très forts. Quant au Louvre, je n’y suis pas encore assez allée. J’y ai vécu de très bons moments. De sublimes Delacroix une certaine matinée… Et surtout, je me suis dit ce matin-là que ce que je voyais par les fenêtres était pratiquement aussi beau que ce que je voyais dans les salles.
Quel rapport avez-vous avec les œuvres ? Quand vous vous retrouvez face à La Joconde, par exemple ?
La Joconde ? Oui, on est fasciné par la fascination qu’elle exerce. On ne sait plus si c’est la sienne ou si c’est celle du monde entier. On peut la regarder éternellement… C’est le regard, bien sûr. Et les mains.
Au Louvre, pendant les prises de vue, vous avez immédiatement pris une pose en rapport avec les toiles ou les sculptures qui se trouvaient à côté de vous, comme si vous étiez vous-même le personnage représenté.
Il y avait une sorte de mimétisme. C’était aussi un jeu, nous faisions des photos. L’immobilité de la photo était propice à reproduire la pose de la statue ou de la peinture. Face à la Vénus de Milo, j’ai pensé au placement des épaules. Dans la grande salle des Caryatides, je pensais à des peintures de Vélasquez, la grande robe que je portais y était pour beaucoup. Les mains se sont placées naturellement sur la robe…
À cette occasion, vous me parliez de votre goût pour des artistes plus contemporains. Vous avez, par exemple, été commissaire d’une exposition Mapplethorpe à la galerie Thaddaeus Ropac.
Quand Thaddaeus Ropac m’avait fait cette proposition, j’étais en Australie. Il m’a envoyé tout le fonds Mapplethorpe que j’ai regardé pendant des heures. Et puis j’ai choisi… Évidemment, l’intérêt de demander ça à quelqu’un, c’est que chacun trouve des choses que d’autres n’ont peut-être pas vues avant. Chacun le voit selon sa sensibilité ou même son ignorance, je ne sais pas… Alors mon choix s’est porté sur des photos de Mapplethorpe que l’on ne voit pas souvent : entre autres, des paysages. Il s’agissait de paysages complètement claustrophobiques. Que des arbres, et pas du tout d’air autour. Des paysages comme des espaces clos.
Retrouvez l’interview d’Isabelle Huppert dans le Numéro art 14, en kiosque et sur iPad.