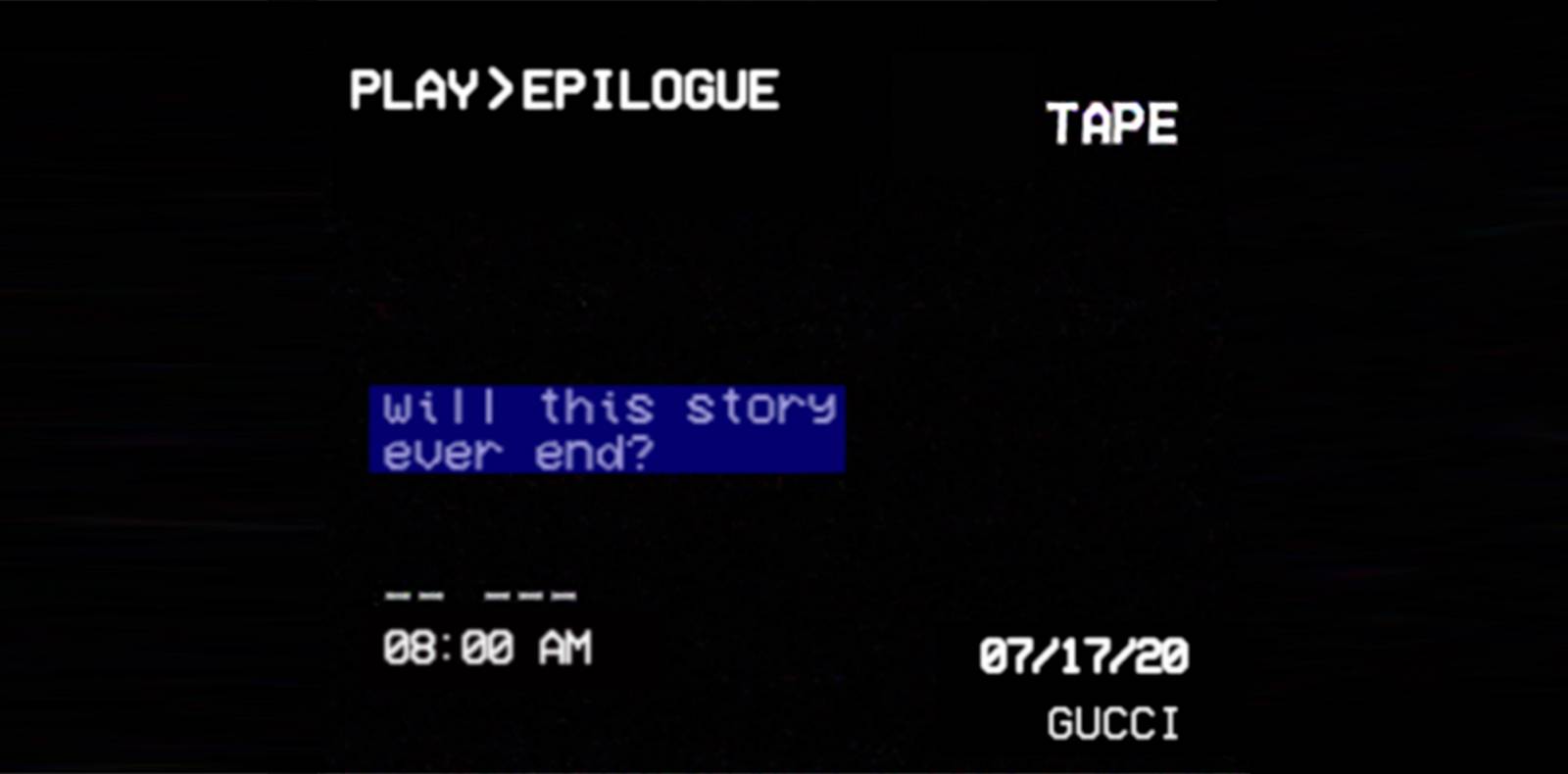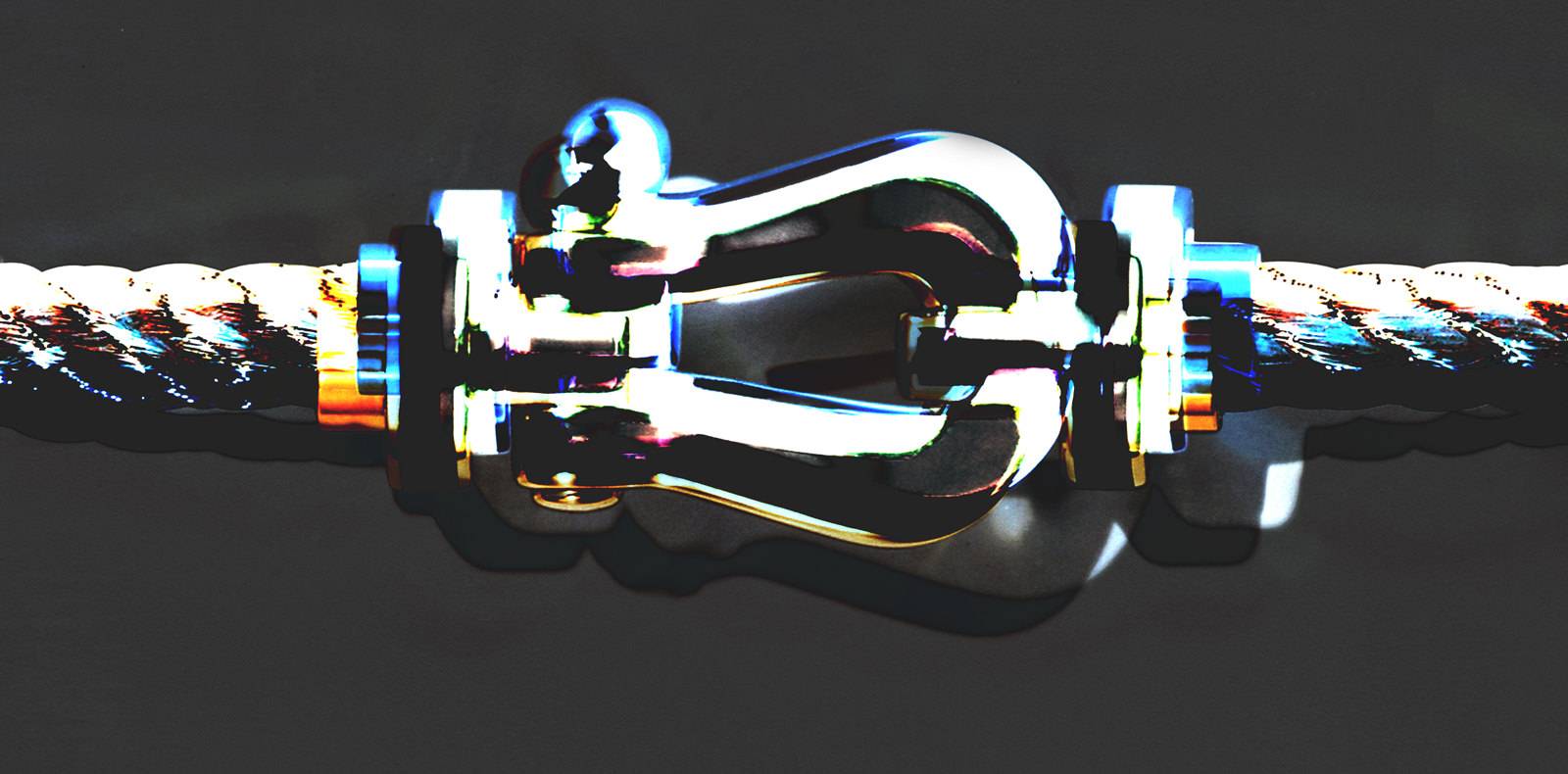7

7
Rencontre avec MC Solaar : « J’ai eu des chances exceptionnelles »
Dans les années 90, il est l’un de ceux par qui le grand public français a découvert le rap. Avec ses productions jazzy et ses paroles poétiques, MC Solaar était l’anti-JoeyStarr, la fraction acceptable d’une musique encore mal comprise dans l’Hexagone. Nous avons rencontré Claude M’Barali, désormais quinquagénaire, pour évoquer avec lui ses heures de gloire et son héritage.
Portrait Jean-Baptiste Mondino,
Réalisation Edem Dossou,
Texte Chloé Sarraméa.

Il est la première star du hip-hop en France. En 1991 sortait son album Qui sème le vent récolte le tempo, comprenant les tubes Caroline, Bouge de là et Victime de la mode, avec lesquels MC Solaar a soudain propulsé le rap, encore inconnu du très grand public hexagonal, sous les feux de la rampe. Cette même année, il enflammait L’Olympia en première partie du groupe new-yorkais De La Soul – avec une jambe dans le plâtre, après s’être enfui de l’hôpital de la ville où il a grandi, Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). De façon injuste, ce succès populaire précoce tend à ternir quelque peu, aux yeux de la postérité, la crédibilité du “poète du rap français”. Pourtant, ses apports créatifs au genre du hip-hop sont cruciaux, qu’il s’agisse de sa collaboration avec le légendaire MC américain Guru, ou de son travail avec la fine fleur des producteurs français, Hubert Blanc-Francard et Philippe Zdar, qui deviendront bientôt des stars de la French Touch. Comment expliquer ce relatif désamour qui a terni l’aura de celui qui se définit comme “l’homme qui capte le mic’ et dont le nom possède le double A” ? En sus de ses fréquentations jugées pour les puristes du rap trop “showbiz”, le fait que ses trois premiers albums soient longtemps restés absents des plateformes de streaming a privé la fameuse gen Z de la découverte de ses chefs-d’œuvre. À l’heure où le monde est bien différent de celui qui a vu éclore sa légende, nous avons rencontré Claude M’Barali, aujourd’hui quinquagénaire, pour évoquer avec lui son héritage et le regard qu’il porte sur sa gloire passée.
Numéro Homme : Fin 2021, vous avez réédité vos trois premiers albums sortis il y a trente ans et jusqu’ici indisponibles en streaming. C’est à cause d’un litige avec votre ancienne maison de disque, Polydor, que vous vous êtes assis sur les royalties qu’ils auraient pu générer pendant tant d’années ?
MC Solaar : Je les avais oubliés. Mais pendant le premier confinement, je les ai réécoutés et je me suis dit qu’il était indispensable que toutes les générations puissent en profiter. À l’époque, j’avais gagné un procès en appel mais il aurait fallu retourner chez un arbitre… J’aurais pu demander à un assistant ou à des membres de mon entourage d’attaquer, mais je ne m’en suis pas occupé. Finalement, l’argent, à un moment donné, tu passes à autre chose.
Alors, comment avez-vous gagné votre vie pendant ces vingt dernières années ?
Quelqu’un me souffle les numéros gagnants du tiercé ! [Rires.] Plus sérieusement, par la musique. Mais l’argent ne me guide pas. Après la sortie de ces disques, à l’aube de l’an 2000, j’étais même parti pour reprendre mes études…
À cette époque-là, on vous taxait parfois de rappeur trop mièvre. Comment l’avez-vous vécu ?
Dès l’enregistrement de mon premier album, j’ai fait venir en studio tous les rappeurs que j’avais connus dans le métro, dans le RER, dans les sound systems… Il y avait quelque chose de familial, fraternel même. Et on a dit que cet album était trop gentil ! Mais ça ne m’a rien fait. Je connaissais tout le monde, je savais comment les gens se comportaient… J’allais dans les soirées depuis si longtemps sans être acteur, juste en observateur, j’étais un peu “cui-cui les petits oiseaux”. Ces critiques ont surtout motivé les producteurs du disque, Jimmy Jay et Hubert Blanc-Francard [alias Boom Bass, futur artisan de la French Touch]. Ils ont voulu frapper un grand coup : faire un deuxième album en suivant une méthode peu orthodoxe, seulement avec des machines et sans aucun refrain !
Cette musique hybride, qui mêle des samples de jazz aux textes de rap, n’a pas fait l’unanimité à l’époque. Le duo new-yorkais Gang Starr, qui a initié ce courant à la fin des années 80, s’est même fait virer de scène lors du festival de jazz à Juan-les-Pins en 1991… Avez-vous vous- même ressenti un certain rejet ?
Sur le coup, les amateurs de jazz classique ne se sont pas rendu compte que cet intellectuel de Boston et son DJ, DJ Premier, voulaient rendre au jazz ses lettres de noblesse. Mais quelques années plus tard, le groupe était célébré dans le milieu du rap pour sa différence. Me concernant, je ne veux pas dire qu’il n’y a pas eu de difficulté, parce que, de 1986 à 1990, c’était extrêmement difficile pour les rappeurs de trouver des prods et des samplers, de pouvoir jouer dans des soirées… Mais beaucoup de gens connaissaient l’underground. En 1991, quand j’ai fait la première partie de De La Soul [groupe de hip-hop américain], c’était l’un des premiers concerts de rap en France et beaucoup connaissaient déjà mes chansons par cœur.
Il paraît que vous étiez difficile à attraper. Vous passiez votre temps en soirée ?
Je traînais beaucoup dans mon studio à Bagnolet. Ce n’était pas un squat : il y avait du Perrier, des rastas qui faisaient la sécurité en bas. À l’époque, il n’y avait pas de téléphones, on pouvait seulement m’appeler avec un bipeur. Parfois, je prenais le train pour réfléchir, j’allais jusqu’en Suisse, en Allemagne, en Hollande… J’allais souvent aux État-Unis pour enregistrer. Avec Philippe Zdar, on a mixé Paradisiaque à New York. On y était aussi passé pour Prose combat, je voulais voir Pete Rock [producteur américain, auteur des albums cultes de hip-hop Soul Survivor et Soul Survivor II, et collaborateur de Kanye West], mais je l’ai raté : je suis tombé sur sa cousine…
En 1992, vous avez signé chez Talkin’ Loud, le label du DJ et célèbre animateur radio de la BBC Gilles Peterson. Votre carrière s’est alors ouverte à l’international, vous avez rencontré Björk…
J’ai toujours aimé traîner avec tous les groupes du monde. Comme je faisais de la musique un peu jazz, je me suis fait des amis partout : au Canada, en Angleterre… Gilles Peterson a flashé sur mon son, il m’a fait venir à Londres, et là je suis allé dans des trucs… C’est indescriptible. Et ça t’ouvre l’esprit. Tu rencontres Marxman – un groupe de rappeurs irlandais marxistes –, Galliano, le groupe Incognito, Björk… C’était le côté anti-showbusiness et libre de l’Angleterre, tu es avec des mecs qui sont ultra connus jusqu’au Japon mais qui mixent pour deux cents personnes dans des petites salles chez eux.
À cette époque-là, en France, JoeyStarr appelait son groupe Nique Ta Mère, mieux connu sous son acronyme, tandis que Doc Gynéco chantait Ma salope à moi. Aujourd’hui, ça ne passerait plus. Quelle est votre opinion sur la cancel culture ?
C’est que, quand j’ai commencé le rap, dans les années 80, certaines figures n’étaient pas terribles… Aujourd’hui, c’est quand même pas mal d’enlever, par exemple, une statue érigée sous l’apartheid. Parce que les mentalités ont évolué, parce qu’il y a une certaine intelligence en réseau… La cancel culture sert donc à quelque chose lorsque le sujet fait consensus et que c’est une évidence. Je suis ravi de toutes les avancées impulsées par des minorités : pour les droits de la femme, contre le racisme…

Certains artistes, comme Eddy de Pretto, militent pour une remise en question de la masculinité. Qu’en pensez-vous ?
À l’époque de la sortie de Red Hot + Cool [compilation sortie en 1994 réunissant des artistes de jazz, de rap, de pop et de rock, et dont les bénéfices ont été reversés à une association qui lutte contre le sida], certains artistes combattaient déjà l’enfermement machiste du rap américain. Mais, depuis la fin des années 2010, ça existe de plus en plus. La première fois que j’ai entendu Fête de trop d’Eddy de Pretto, j’ai pensé : “Qu’est-ce que c’est que ça ? C’est super fort et beau !” Après,j’ai vu qu’il venait du Val-de-Marne, et je me suis dit : “C’est bon, je vais le voir en concert.” Ce type témoigne en musique pour les gens qui ont vécu des choses comme lui.
Êtes-vous d’accord lorsqu’on le qualifie de transfuge de classe ?
Pour moi, le terme “transfuge de classe” est un terme de combat. Il a été inventé pour écarter quelqu’un malgré son mérite. J’imagine qu’on pourrait coller cette étiquette à un maître d’école qui débarque de Brive au Collège de France parce qu’on veut sa place… Peu de gens parlent de “classe” aujourd’hui, c’est presque obsolète, alors dire “transfuge de classe”, ça revient à formuler une insulte ! Une injure qu’on colle à 90 % des gens qu’on voit au théâtre, à la télévision ou qu’on lit dans les journaux…
Vous avez appelé l’un de vos titres phares Obsolète. Considérez-vous certains de vos morceaux comme tels ?
Franchement, non. Quand j’ai réécouté les albums, j’ai trouvé que tous avaient du sens, que sans musique je pouvais les lire. Parce que je tentais de bien écrire, je voulais un côté poétique, presque irréel. Pourtant, ça parlait de la vie, c’était très imagé. J’aime dire qu’il y avait des “lubrifiants didactiques”, c’est-à-dire des façons d’aborder un sujet avec humour, ce qu’on appelle “feel good” aujourd’hui.
Comment expliquez-vous que certains rappeurs des années 90 ont duré, alors que d’autres non, comme les Sages Poètes de la rue ou La Cliqua ?
Dans mon cas, c’est grâce aux productions d’Hubert [Blanc-Francard] et Zdar. Ils ont fait quelque chose de subjuguant au niveau du son : ils l’ont rendu durable. Mais il y a beaucoup de choses superbes de cette époque-là. J’adore les morceaux des Sages Poètes de la rue, de La Rumeur, d’Ideal J… J’apprends toujours à chaque fois que j’entends des petits rapper sur ces textes.
Votre ami Big Red a dit dans une interview : “Si t’es encore MC à 50 ans, c’est qu’il y a un truc qui déconne.” Vous êtes d’accord avec ça ?
Il déconne ! [Rires.] Mais Mickey Mossman [l’un des membres de Démocrates D, un groupe de rap hardcore français des années 90] me disait la même chose quand j’avais 20 ans : “C’est quoi ces rappeurs qui ont des gosses, la honte !” Moi, j’ai préféré anticiper. Je n’ai jamais rappé avec une voix aiguë, je n’ai jamais exagéré les gestes avec mes mains, je n’ai jamais saccadé mon flow, ni chanté sur une musique trop dansante parce que, quelques années plus tard, tu ne peux plus les jouer sur scène : impossible de lever les genoux ! Mais regardez Jay-Z, Eminem et même Pharrell Williams… Sans parler de Big Daddy Kane [rappeur américain qui a commencé sa carrière à la fin des années 80], qui tourne dans tous les États-Unis.
En 1994, vous êtes face à Christine Ockrent à la télévision. Elle vous demande quel goût vous garderez de cette époque quand vous serez vieux. Vous répondez : “Un goût à la chinoise : aigre-doux.” C’est le cas ?
Waouh ! [Rires.] J’étais tellement impressionné pendant l’interview que lorsque Christine Ockrent m’a posé des questions sur les footballeurs que j’aimais bien, j’ai inventé des noms, genre Stefano. Il n’existait même pas ! Alors pour le reste… Il y a peu, j’ai passé la journée avec des gens que j’ai connus quand j’avais 8 ans. On s’est posé cette question et je me suis dit que je gardais un souvenir très doux : j’ai eu des chances exceptionnelles. Je ne vais pas dire que je n’éprouve aucun regret mais je ne garde en tête que des choses positives, à cent pour cent.
Qui sème le vent récolte le tempo, Prose Combat et Paradisiaque, de MC Solaar, disponibles.