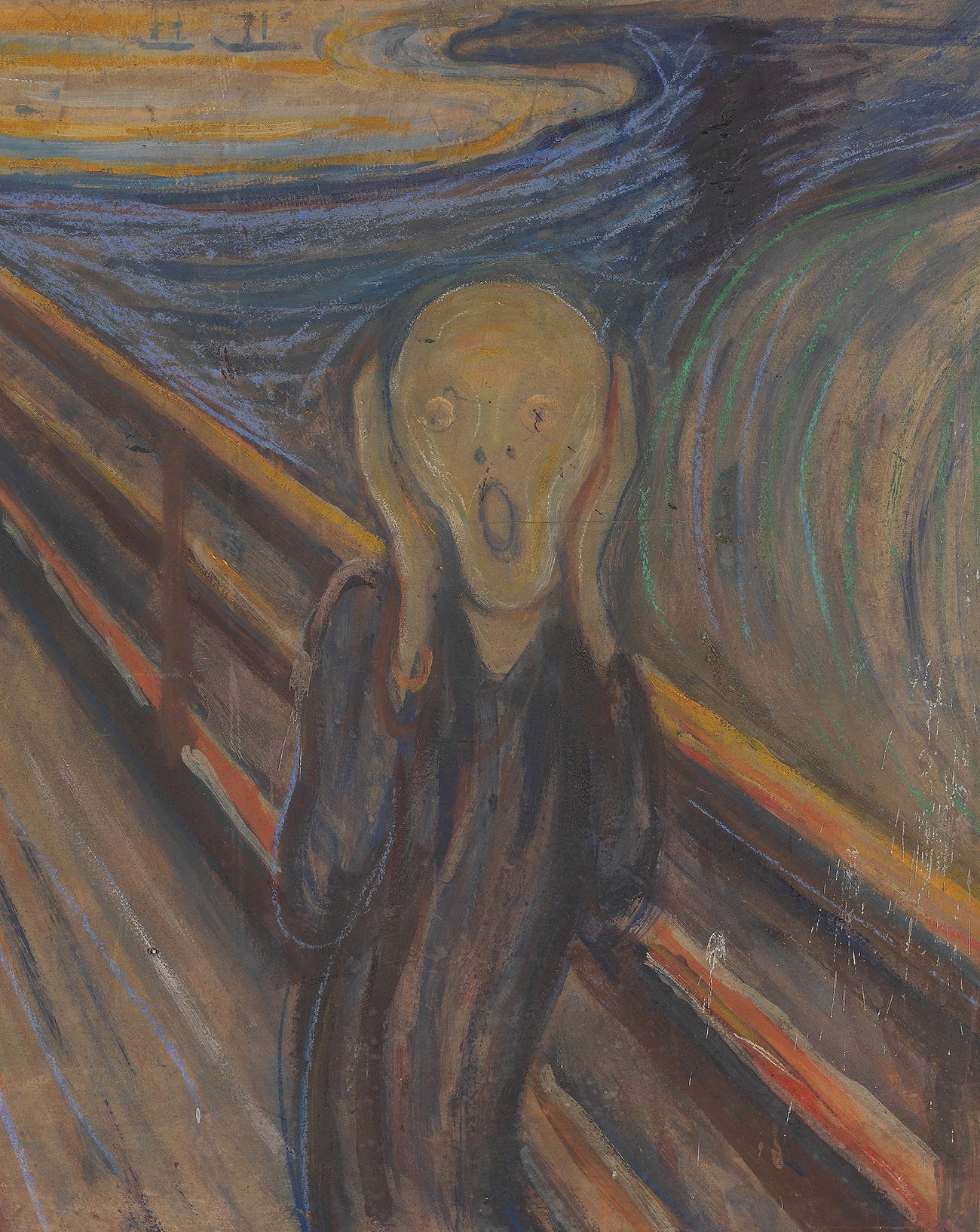9

9
Sterling Ruby, a vibrant artist at the Gagosian Gallery in Paris
La Gagosian Gallery révèle à Paris différentes facettes de la star américaine de l’art contemporain. Graffitis, collages, céramiques, peintures, sculptures, artisanat… il ne s’interdit rien et s’est même essayé à la mode avec la complicité de Raf Simons.
par Thibaut Wychowanok.
Au mois d’octobre prochain, Sterling Ruby va occuper simultanément trois lieux parisiens pendant la FIAC : les deux espaces de la Gagosian Gallery, ainsi que le musée de la Chasse et de la Nature dans le Marais. Sans doute l’un des artistes les plus ambitieux de sa génération, Sterling Ruby est un touche-à-tout qui teste tous les médiums et toutes les techniques possibles : peintures, céramiques, sculptures en époxy ou en bronze, collages, dessins, textiles, vidéos et même la mode puisqu’il a signé une collection pour le designer Raf Simons. Né en 1972 dans une base de l’armée de l’air américaine à Bitburg, en Allemagne, d’un père américain et d’une mère néerlandaise, il vit et travaille désormais à Los Angeles dans un des plus grands ateliers d’artiste de la ville. Son travail évoque tout à la fois la sociologie urbaine et l’histoire de l’art, les contraintes sociales ou encore l’architecture, le graffiti, l’art minimal, l’artisanat, etc.
Les nouvelles pièces qu’il va exposer dans l’espace du Bourget de la Gagosian Gallery sont des ready-mades de fragments de sous-marins de l’armée américaine, qui sont, comme souvent chez l’artiste, des œuvres plutôt monumentales. Rue de Ponthieu, il présentera de nouvelles peintures qui utilisent la technique du frottage, alors que ses œuvres picturales emblématiques sont réalisées habituellement à base de sprays. Enfin, au musée de la Chasse et de la Nature, ce sont de véritables poêles à bois en fonctionnement qui seront installés dans la cour.Nous l’avons rencontré alors qu’il venait d’emménager dans son nouveau studio, downtown Los Angeles.
Numéro : Quel a été votre parcours ?
Sterling Ruby : Mon père est américain, ma mère était néerlandaise. Je suis né dans une base de l’armée de l’air américaine, à Bitburg, en Allemagne. Nous avons vécu très peu de temps en Europe. Ensuite, nous avons déménagé aux États-Unis. D’abord à Baltimore, puis dans la petite ville de New Freedom, en Pennsylvanie. J’ai grandi dans une ferme mais j’ai passé mon adolescence à faire des escapades à Baltimore ou à Washington, fuyant mon environnement rural pour assister à trois ou quatre concerts par semaine. J’ai fait des études d’art à Lancaster en Pennsylvanie, à Chicago et à Los Angeles. J’ai commencé par étudier le dessin de nu, la nature morte et le paysage. À la Video Data Bank de Chicago, j’ai regardé à peu près toutes les vidéos artistiques et toutes les interviews d’artiste disponibles. J’ai étudié la psychologie des cultes, le minimalisme, la théorie des couleurs, la philosophie française et le postmodernisme. J’ai suivi les cours de Sylvère Lotringer, de Laurence Rickels, de Mike Kelley, de Richard Hawkins et de Diana Thater au Art Center College of Design de Pasadena.
Comment votre parcours et votre milieu familial et culturel vous ont-ils influencé ?
Le coin de Pennsylvanie où j’ai grandi était davantage rural et prolétarien qu’intellectuel. J’étais constamment en butte à une mentalité provinciale. Je recherchais la créativité partout où je pouvais la trouver. Je sentais qu’il m’était absolument nécessaire d’échapper à ce milieu, mais avec le temps, j’ai pris conscience que beaucoup de mes centres d’intérêt, et peut-être aussi beaucoup de mes références esthétiques, viennent directement de cette époque de ma vie.
Quelles ont été vos références artistiques ?
Ma première grande influence contemporaine, mon premier grand moment, a été la rétrospective de Bruce Nauman au MoMA, à New York, en 1995. Il fait toujours partie de mes artistes préférés. Sinon, dans l’histoire de l’art, j’adore le Bauhaus. En imposant une perspective utilitaire, cette école a tout bouleversé. Elle a poussé l’artisanat à devenir du grand art et réciproquement. Je me rappelle souvent que cette période a produit certaines des œuvres qui m’ont le plus influencé.
Vous êtes connu pour travailler avec différents médias : dessin, peinture, sculpture, mais aussi textile ou argile. Avec lequel de ces médiums vous sentez-vous le plus à l’aise ?
J’aime chercher à résoudre les problèmes inhérents à chaque médium, tantôt en l’utilisant d’une manière inattendue, hors de son contexte habituel, tantôt en l’utilisant de façon assez traditionnelle. J’aime bousculer les choses. Cela fait partie de mon approche schizophrénique.
Dans votre travail, la notion d’artisanat est très importante. Certaines pratiques comme la céramique requièrent des savoir-faire particuliers. Produisez-vous toutes vos pièces vous-même ?
L’artisanat m’a paru digne d’intérêt bien avant que je ne m’intéresse à l’art. J’ai découvert les patchworks et l’artisanat amish avant de voir ou de comprendre l’art moderne ou contemporain. Dans ma famille, la vaisselle était de la céramique traditionnelle de Pennsylvanie. Là aussi, l’esthétique artisanale était présente. La céramique est un bon exemple de la manière dont je travaille. Cela fait maintenant quinze ans que je la pratique. J’ai compris comment pousser à l’extrême les procédés de cuisson et d’émaillage. Un céramiste plus orthodoxe trouverait peut-être mon travail naïf, primitif ou même amateur, mais après tant d’années, je sais très bien quelle argile utiliser, quelle proportion de chamotte employer, de combien une pièce va rétrécir, quel rôle jouent les briques et les éléments du four, comment utiliser au mieux la convection et la circulation de l’air pendant la cuisson, comment la température affecte les couleurs de l’émail et comment, quelle que soit ma maîtrise technique, certaines pièces exploseront inévitablement.
Ma formation a été très empirique. On m’a enseigné que, pour utiliser un matériau, il faut d’abord connaître ses propriétés. Il existe cependant encore des techniques, comme le moulage du bronze, que je ne peux pas ou ne veux pas faire dans mon atelier.
Votre peinture a de toute évidence à voir avec l’abstraction, mais, d’une certaine façon, elle représente aussi des paysages, l’horizon, le soleil couchant ou le soleil levant…
On peut y voir de nombreuses choses, en effet. J’ai commencé à peindre ces tableaux en m’inspirant des graffitis et des tags réalisés par les gangs à proximité de mon domicile et de mon atelier. Mais on peut également y voir des lignes d’horizon. Elles correspondent à ma manière de peindre… de gauche à droite et de droite à gauche. À Los Angeles, nous pouvons observer de fabuleux levers et couchers de soleil qui transforment les zones urbaines en espaces de méditation. Et puis j’envisage aussi mes tableaux sous un angle cinématographique… Je pense par exemple à Un chien andalou de Luis Buñuel, à cette scène où l’œil coupé, tranché d’un plan à l’autre, est la création formelle d’un paysage.
Peut-on revenir un moment à votre travail sur les textiles ?
Au début, je décolorais et je teignais les tissus dans l’atelier pour réaliser des sculptures molles. Je conservais les chutes que je trouvais particulièrement intéressantes. Puis j’ai commencé à en faire des vêtements. J’ai réalisé ainsi une série de collages de tissus. Je les considérais comme des patchworks, dans l’esprit de ceux réalisés par les amish que j’avais vus enfant. Par la suite, j’ai également été influencé par les patchworks de Gee’s Bend [communauté afro-américaine de l’Alabama] et par les boro japonais [art japonais réalisé à partir de lambeaux de textile]. J’ai réfléchi au contexte de la fabrication des patchworks, aux rituels de leur production. Les boro étaient d’abord des vêtements de travail. Lorsqu’ils étaient trop usés pour être portés, on les transformait en magnifiques couvertures, en édredons. Les couturières métamorphosaient ces matériaux utilitaires en matériaux esthétiques.
Au fil du temps, la taille de mes patchworks n’a cessé d’augmenter. Alors ils sont devenus des drapeaux, des tapisseries ou des fonds de décor. Je pensais aux troupes de théâtre qui voyageaient autrefois avec leurs décors. Je les assemble de la même façon que lorsque je travaille sur un collage. Je choisis les
éléments dans des piles de chutes de tissus cousus, décolorés ou teints à la main. La seule vraie différence entre le travail sur les drapeaux et les collages en papier, c’est une différence d’échelle : les drapeaux sont si grands que, pour les disposer dans l’espace, je dois monter sur un chariot élévateur.
Vous vous êtes toujours intéressé aux vêtements. Vous fabriquez depuis longtemps des vêtements de travail que vous portez dans votre atelier. Récemment, cet intérêt a donné lieu à une collection que vous avez conçue avec Raf Simons. En quoi consistait ce projet ?
Quand j’avais 13 ans, ma mère m’a donné une machine à coudre. J’étais content d’être autonome, de pouvoir fabriquer mes propres affaires. À l’époque, les tenues que je faisais n’étaient pas du tout “couture”. Elles avaient un aspect brut, voire punk. Raf est un ami personnel. Il m’était facile de travailler avec lui. Il avait déjà intégré mes tableaux à sa première collection de haute couture chez Dior. En venant à l’atelier, Raf a découvert les vêtements de travail que j’avais réalisés pour moi. De là est née cette idée de créer ensemble une ligne de vêtements pour hommes, en denim. Nous l’avons présentée l’an dernier, à Paris. Pour moi, c’est très libérateur d’avoir maintenant une partie du studio exclusivement consacrée à la production vestimentaire.
Vous donnez souvent des titres assez énigmatiques à vos expositions, comme DROPPA BLOCKA, CHRON, EXHM ou BC RIPS, pour ne citer que ceux-là. Comment choisissez-vous ces titres ?
L’attribution des titres est une obsession chez moi. Je m’intéresse particulièrement aux codes et aux acronymes. CHRON est une partie du mot “chronologie”, Exhm vient du mot “exhumation”. J’ai lu des documents sur le phénomène aéronautique appelé “graveyard spin”, quand un pilote perd ses repères dans l’espace. Cette idée de titre a généré tout un nouveau corpus d’œuvres. Il y a un site de tchat en ligne où des toxicomanes parlent des associations entre diverses drogues. Ils donnent les noms qu’ils ont inventés pour leurs concoctions en fonction du trip qu’elles ont suscité. Ils se réfèrent souvent au code couleur du test réactif Marquis utilisé par la police pour détecter la consommation de stupéfiants. Ce code se fonde sur un système hermétique et alchimique. J’ai utilisé ce langage pour choisir les titres de nombreux bassins en céramique. J’utilise la terminologie de la science, de la médecine, de l’archéologie, de la prison ou de la drogue en altérant le sens originel. Je dissocie le sens tout en maintenant la référence de départ. Parfois, je veux qu’un titre soit visuel. Alors je tape des listes de mots, de noms, et je regarde ces mots sur l’écran de mon ordinateur, affichés en lettres capitales, dans une police d’écriture sans empâtements, pour ne plus en voir que la forme, le design. Du pur graphisme.
En octobre, vous serez présent à Paris pour la première fois, avec deux grandes expositions à la Gagosian Gallery, et quelques pièces au musée de la Chasse et de la Nature. Comme envisagez-vous ces expositions ?
Lorsque j’expose dans une galerie, je crée toujours de nouvelles œuvres, et, à cette occasion, je me dois de répondre à un certain nombre de questions. Où est situé cet espace ? Dans quelle ville ? Dans quel pays ? Quelle est l’architecture de cet espace, sa lumière, la hauteur sous plafond ? En quoi est le sol ? Dans quel contexte seront exposées les œuvres et quels seront les paramètres d’installation ? J’ai du mal à travailler à partir de modèles ou d’images 3D. J’aime me confronter physiquement avec les choses dans l’espace. Mettre en place une exposition, c’est passer son temps à régler des problèmes. J’ai besoin de déplacer les œuvres, encore et encore, et je fais de multiples essais d’accrochage. Ces deux derniers mois, grâce à des marques faites sur le sol de mon atelier, j’ai reconstitué la disposition des espaces du Bourget et de la rue de Ponthieu. J’ai arpenté chaque niveau et chaque salle dans tous les sens. J’étais très séduit par l’idée d’utiliser en même temps les deux adresses parisiennes de la Gagosian Gallery. Le Bourget est un vaste espace. Les sculptures que j’avais dans mon atelier depuis un an vont trouver leur place dans cet immense hangar, à côté de grands drapeaux de tissu délavé. Et dans la galerie plus intime de Paris intra-muros, je vais accrocher un nouvel ensemble de tableaux. Quant au musée de la Chasse et de la Nature, un groupe de quatre poêles monumentaux, inspirés des vieux poêles campagnards en fonte, prendront place dans la cour du musée. On y brûlera du bois. J’aime ce rituel.
Pouvez-vous nous parler de vos nouvelles sculptures en métal et de leur rapport avec les sous-marins ?
J’ai passé trois ans à restaurer un bâtiment pour y faire mon nouvel atelier. J’ai emménagé cette année. Cet atelier se trouve à deux pas de l’ancien, à Vernon, une zone industrielle située à dix minutes du centre de Los Angeles. En faisant des allers-retours entre les deux, je passais devant un immense chantier où des équipes de démolisseurs découpaient des pièces de métal grosses comme des camions. Un jour, je me suis arrêté pour voir ce qu’ils faisaient. C’était une société qui avait pour mission de démanteler et de mettre au rebut des sous-marins américains désarmés. J’ai passé un marché avec le patron de la société et j’ai acheté de grands morceaux de ces sous-marins. À l’époque, j’ignorais ce que j’allais en faire, mais je savais qu’ils avaient de la puissance en eux. Ces énormes pièces de métal qu’on m’a livrées à l’atelier semblaient tellement abstraites, incongrues ! Le terrain autour de l’atelier ressemblait à un vaste cimetière d’engins militaires. J’ai assemblé ces bouts de sous-marins avec des moteurs de voiture et des tuyaux industriels, histoire de créer une nouvelle forme de sculpture évolutive et monumentale. Pour moi, c’est une sorte de processus de récupération qui consiste à sortir des objets de l’océan pour les apporter sur terre. Il s’agit d’une transformation ou d’une mutation de formes sculpturales antérieures qui donne de nouveaux hybrides.
Votre nouvel atelier à Los Angeles est assez impressionnant. Comment parvenez-vous à mener de front tous vos projets et à diriger cette importante équipe ?
Ce nouvel atelier est en effet un espace nettement plus vaste. J’ai de la place pour travailler en solitaire. En fait, j’ai l’impression d’être moins occuper à manager mon équipe qu’auparavant. Depuis quelques années, l’effectif est à peu près constant. J’ai dix employés à plein temps. Beaucoup d’entre eux travaillent pour moi depuis très longtemps. Je leur fais confiance pour gérer les opérations quotidiennes et la logistique. Ils me font gagner du temps et prennent de nombreuses décisions en mon nom, ce qui me permet de me concentrer sur le travail lui-même.
Expositions de Sterling Ruby : PARIS, Gagosian Gallery, 26, av. de l’Europe (Paris-Le Bourget), à partir du 18 octobre, et 4, rue de Ponthieu (Paris VIIIe), à partir du 21 octobre, jusqu’au 19 décembre. STOVES, musée de la Chasse et de la Nature, 62, rue des Archives, Paris IIIe, du 21 octobre au 14 février 2016.
Propos recueillis par Nicolas Trembley