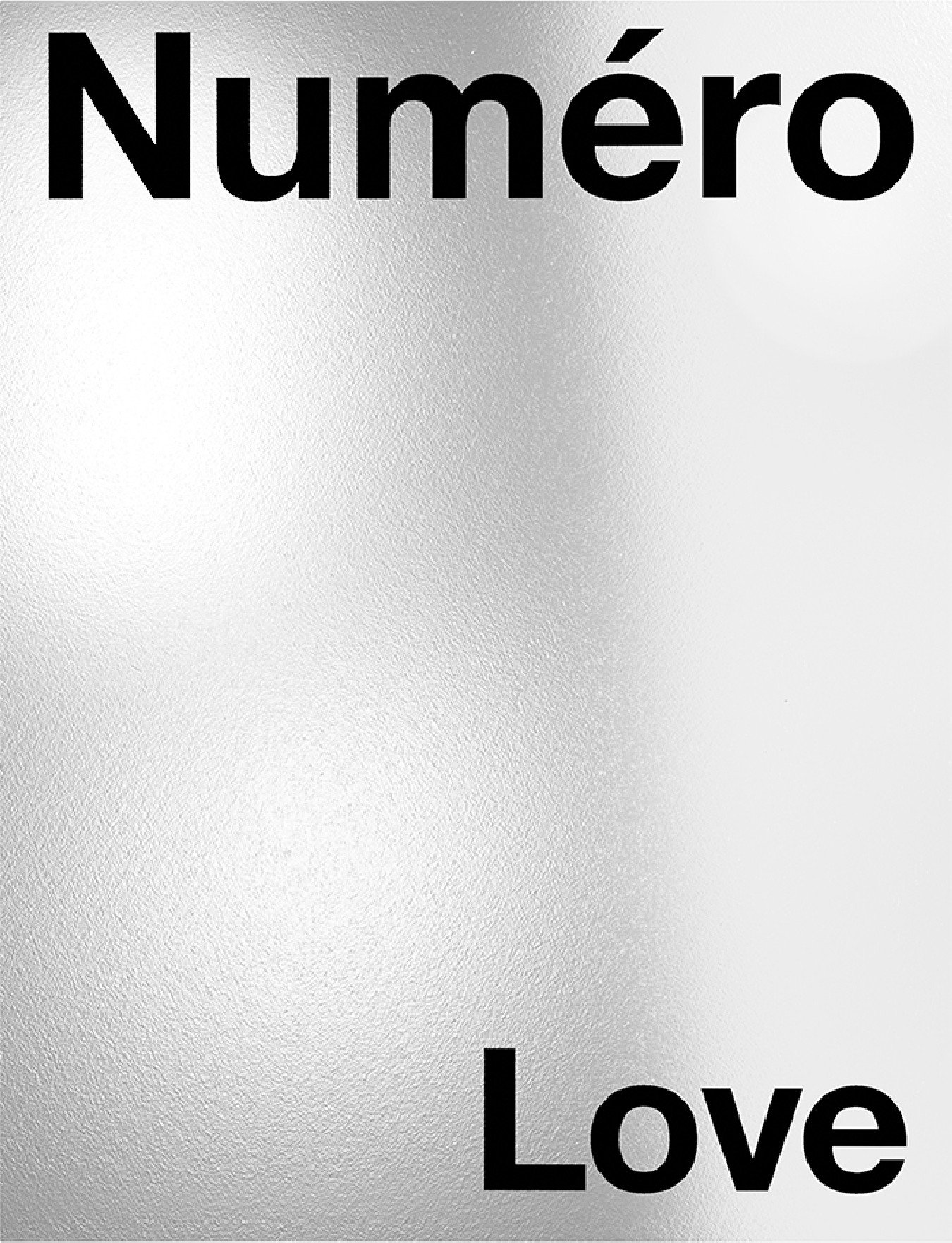Palme d’or 2010, Apichatpong Weerasethakul expose à Paris
Génie pour les uns (dont Numéro), cinéaste de l’ennui pour les autres (Le Figaro), le réalisateur et artiste expose de nouvelles photographies et vidéos à la galerie TORRI. Une plongée dans son intimité en Thaïlande, entre nature et rêveries oniriques.
Par Thibaut Wychowanok.
Faire l’expérience d’un film du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, c’est accepter d’entrer dans un autre monde, un pays où les fantômes sortent naturellement des bois la nuit et où la plus belle histoire d’amour se passe entre un soldat et une bête sauvage terrée dans la jungle. Le film qui a valu à Apichatpong Weerasethakul la Palme d’or en 2010, Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, se proposait ainsi de suivre un homme au seuil de sa vie, visité par les fantômes de ceux qu’il a aimés. On y flottait comme dans un rêve envoûtant, pris dans un sommeil sans fin. On s’y ennuyait aussi beaucoup rétorquaient ceux qui n’y étaient pas sensibles.
Mais dans les films du Thaïlandais, rien ne paraît jamais extra-ordinaire. Le repas familial ou l’apparition fantomatique, la banalité de la vie urbaine ou la bête de la jungle… tout appartient au même écosystème. Tout est filmé avec le même “réalisme”. C’est ce regard simple, voire naïf, sur son environnement et ses mystères – sans recherche du sensationnel – qui fascine ou exaspère. Weerasethakul propose une errance poétique dans un monde où s’entremêlent, sans qu’on puisse les dissocier, rêves et réalité. Il invite à en faire le tour du propriétaire. Ces films forment avant tout un voyage au cœur des lieux intimes de l’artiste en Thaïlande, son “chez soi” : la jungle, la maison à l’orée du bois, la clinique de son père…
L’exposition que lui consacre la galerie TORRI à Paris jusqu’au 28 mai repose sur le même principe de géographie de l’intime. Une photographie d’un homme allongé sur le lit d’une chambre d’hôtel accueille le visiteur. L’intime s’offre au regard extérieur, comme dans ses films, au moment où l’esprit est entre le réel et le songe. Puis le cliché d’un homme en train de prendre une photo face caméra joue d’une mise en abyme avec le spectateur, à la fois regardeur et regardé (par la photo). Un spot de lumière (les mêmes que Weerathetakul utilise dans ses films) installé dans la galerie pour éclairer la photo renforce l’effet de mise en scène. “L’usage que je fais de la lumière rend l’espace ‘actif’. On est comme au sein du décor d’un film : quelque chose est éclairé, quelque chose est en train d’arriver, explique l’artiste présent à Paris pour le vernissage. Vous pouvez passer devant cette lumière si bien que vous intégrez vous-même le dispositif.” Vous pénétrez son intimité.
Comme un artiste ambulant, Weerasethakul est venu poser à Paris son petit théâtre personnel, constitué des motifs récurrents qui forment la matrice de son cinéma. Sans doute une des photos les plus émouvantes, le cliché de la clinique où le père de l’artiste est mort renvoie au décor de son dernier film Cemetery of Spendour en 2015. Encore un lieu, comme le lit, à la frontière entre l’ici et l’au-delà. Aucun corps visible dans ce cliché, et pourtant la présence fantomatique apparaît comme une évidence. La magie du Thaïlandais opère : sa faculté à rendre présente une absence et inversement (lorsque les morts réapparaissent en spectres à l’écran).
Mais le voyage dans l’univers de l’artiste ne serait pas complet sans son obsession pour les éléments et une nature onirique. Une vidéo, filmée depuis la fenêtre de sa salle de bains, capture le vent traversant les bambous environnants. Le bruit en boucle est à la fois une berceuse calmante et un élément sourd et inquiétant. La nature chez Weerasethakul s’inscrit toujours dans cette dualité. Une autre vidéo, celle d’un lampion traditionnel thaïlandais s’élevant vers les étoiles comme un cerf-volant enflammé, fait écho à un cliché où une botte de paille en feu, en plein ciel, prend la forme d’une tête de cheval démoniaque. “Le feu, explique Weerasethakul, peut être interprété de multiples manières. C’est autant le feu du foyer réconfortant qu’un élément de danger et de destruction. Il en appelle à notre mémoire personnelle autant qu’à la mémoire collective et historique. Le feu a été utilisé pour torturer et mutiler…”
Le monde intime de Weerasethakul, pris au vent ou en feu, est loin d’être tranquille. Cette peur qui transparaît fait sans doute écho à l’inquiétude de l’artiste pour son pays marqué par un contexte politique difficile. Une explication sans doute au besoin d’Apichatpong Weerasethakul de poser ses bagages à Paris et d’y reconstruire un foyer galerie TORRI.
Fire Garden d’Apichatpong Weerasethakul, galerie TORRI, 7, rue Saint-Claude, Paris IIIe. Jusqu’au 28 mai 2016.