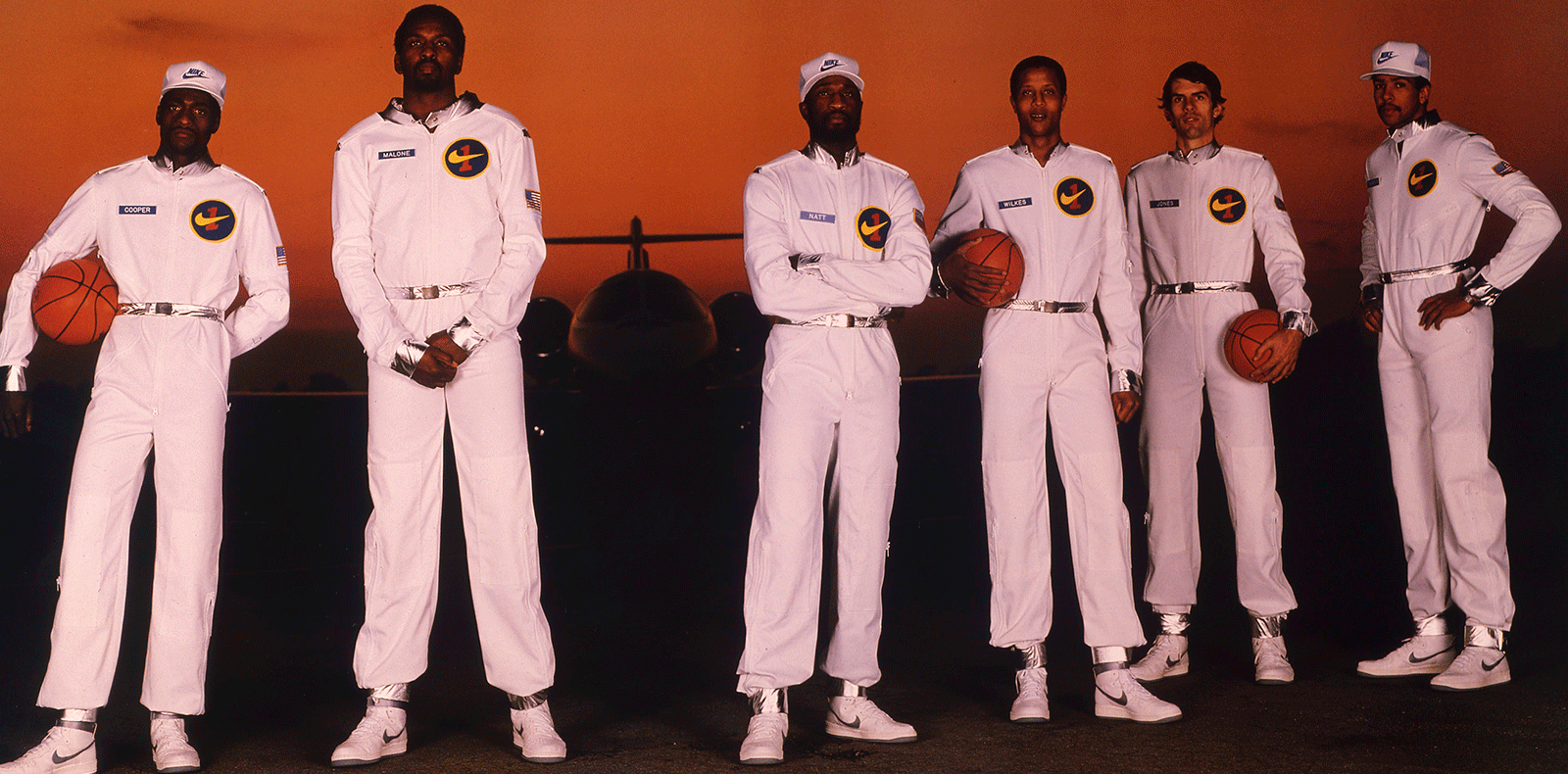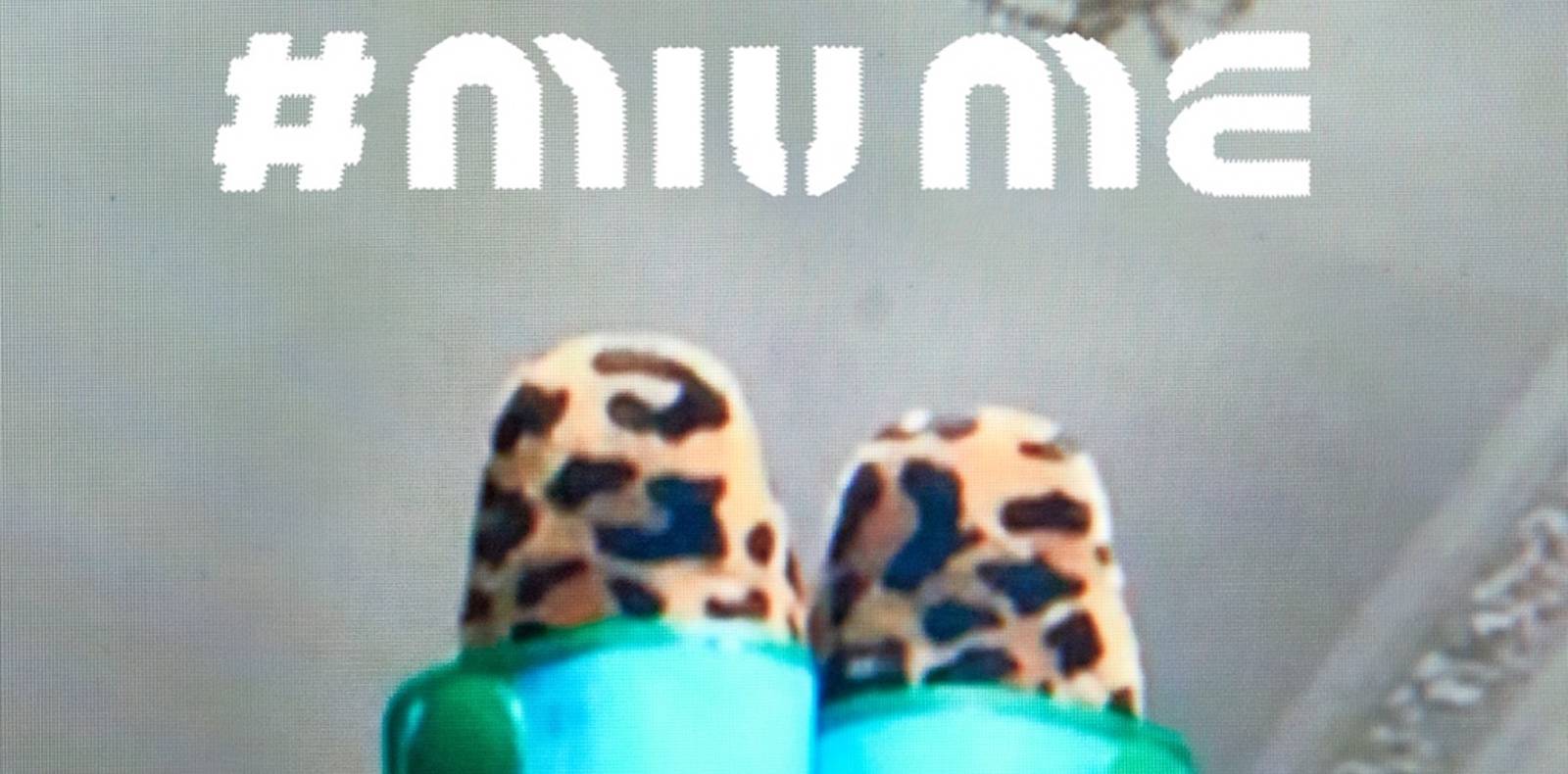24

24
“Je souhaite faire percevoir le charme du sentiment de malaise.” Rencontre avec Lisa Jo, artiste à la croisée des arts
Récemment exposée à Paris, cette jeune artiste californienne revendique sa double culture coréenne et américaine. Un mélange d’influences perceptible dans ses œuvres qui hybrident peinture, art digital, céramique, cinéma, dans un espace incertain entre abstraction et figuration.
Par Nicolas Trembley,
Portrait Reto Schmid.
Publié le 24 juillet 2018. Modifié le 18 avril 2025.

Alors qu’elle étudiait la photographie, Lisa Jo fut inspirée par ses lectures des Minor Histories de Mike Kelley sur les questions de l’informe et du biomorphisme, et de ce qu’il appelle la “matière grise” : l’espace qui existe entre les choses elles-mêmes et le pouvoir psychique et érotique que l’artiste crée. Aux yeux de Lisa Jo, il faut comprendre ces notions pour approcher son travail. Elle produit peu, lentement, et montre rarement ses œuvres, néanmoins tout le monde la connaît. Les trois longsmétrages qu’elle a réalisés ces dernières années n’existent que dans sa tête, et, au bout du compte, les bandesannonces (bien réelles) de ces films en deviennent les seuls résultats tangibles. Lisa Jo réfute les catégorisations et préfère se tenir “entre” les choses. Elle est entre les techniques – cinéma, photo, peinture ou céramique – comme elle vit entre deux cultures, celle de la Corée du Nord et celle de la Californie où elle a été éduquée, tout en vivant avec un artiste européen : Nikolas Gambaroff. Nous l’avons rencontrée alors qu’elle installait sa première exposition en France, au 45b rue Ramponeau, un espace indépendant géré par l’artiste Matthew Lutz-Kinoy et les curatrices Julie Boukobza et Stéphanie Moisdon. Elle y présente cinq petites peintures qu’elle conçoit d’abord sur un iPad, entre abstraction et figuration, avant de les retranscrire sur de la toile.
Numéro: Quel a été votre parcours et quelles études avez-vous suivies ?
Lisa Jo : J’ai grandi à Los Angeles. Mes parents étaient des immigrés d’origine coréenne. Ma mère s’est aperçue, lorsque j’avais environ 3 ans, que j’avais l’oreille absolue, et m’a fait étudier le violon et la harpe, le premier pendant treize ans, l’autre pendant huit ans, jusqu’à l’entrée au lycée. À l’adolescence, je suis entrée dans une longue période de rébellion, en réaction à la forte pression ressentie dans l’enfance, et j’ai exploré tout ce qui était subversif, underground : le street racing (courses de voitures en pleine ville) et la culture rave des années 90, deux phénomènes qui prenaient de l’ampleur dans les communautés asiatiques de Los Angeles. Mais j’ai pris conscience que c’était une voie sans issue et j’ai décidé de poursuivre mes études – mais en partant le plus loin possible afin de m’extraire, à la fois physiquement et psychologiquement, de la dichotomie qui définissait ma vie. J’ai déménagé à New York pour étudier la photographie. C’est ce mélange de culture classique et de culture de rue, allié à l’influence d’une grande sœur très créative issue de la “génération X”, qui m’a doucement poussée vers l’art contemporain.
Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?
C’est une histoire assez mémorable ! Ma sœur était partie étudier à Paris, le temps d’un été. Je l’avais rejointe, du haut de mes 11 ans. Elle m’a emmenée voir une exposition de Damien Hirst où il présentait Mother and Child (Divided), cette vache et son veau coupés en deux dans le sens de la longueur et exposés dans des aquariums remplis de formol bleuté. Je suis entrée dans la salle, passée entre les deux moitiés du corps de la mère, et j’ai immédiatement vomi partout sur le sol du musée.
“La peinture abstraite serait-elle redevenue une marque de radicalisme ? Je plaisante… Ou pas.”
Et aujourd’hui, à quoi êtes-vous attentive ?
Eh bien… pas tellement à Damien Hirst ! Je m’efforce de voir les expos ailleurs que sur Internet, et comme je n’ai ni Instagram, ni Facebook, ni même un iPhone, c’est plutôt facile… mais je vous jure que je ne suis pas technophobe pour autant, j’ai même le tout dernier Google phone ! Ces derniers temps, j’ai aussi regardé beaucoup de grands classiques hollywoodiens et de films noirs, par exemple toute la filmographie de réalisateurs comme Douglas Sirk ou Howard Hawks. Et lu pas mal de jeunes auteurs.
Les œuvres présentées lors de votre récente exposition parisienne débutent sur un iPad pour finir sur la toile. Pouvez-vous nous expliquer leur processus de production ?
Ce processus pose la question de la traduction, ou plutôt, de ce qui se perd dans une traduction. Commencer par le numérique est très naturel pour moi, très immédiat – vous voyez, je ne suis pas technophobe ! –, et les dessins figurant sur les toiles sont souvent entièrement résolus sur cette surface digitale plane. De subtiles distorsions apparaissent ensuite dans la tentative de reproduire à l’huile, et sur une toile, ces dessins à plat avec leurs couleurs numériques. Bien sûr, j’amplifie ce phénomène en n’utilisant pas l’image projetée. Souvent, je regarde l’iPad sous différents angles pour introduire des variations de perspective, de lumière, etc. À mesure que la toile progresse, il se produit, entre le numérique et l’analogique, une sorte d’effondrement : les deux extrémités du spectre se replient l’une sur l’autre, ou bien au milieu, dans un vide. C’est dans ce matériau gris que naissent la tension et l’étrangeté.

Vous vous appropriez différentes formes, tirées par exemple de magazines érotiques des années 70. Pourquoi ce choix ?
Je me suis penchée en particulier sur l’un d’entre eux, que j’ai connu par l’intermédiaire du travail de Mike Kelley. Cette publication, Sex to Sexty, déborde de l’humour intolérant et raciste que l’on pouvait rencontrer à l’époque, et les blagues semblent ne jamais contenir aucune forme de finesse ni de second degré. Pour prendre un exemple, il y a cette image d’un couple en train de faire l’amour dans une prairie d’alpage : on voit le mont Cervin au loin. L’homme porte un chapeau traditionnel orné d’une plume, et la femme, une robe agrémentée d’un petit tablier, retroussée jusqu’à la taille. La légende indique : “Arrête, ou je me mets à yodler !”
En quoi cette nouvelle série se distingue-t-elle de ce que vous faites habituellement ?
Elle constitue pour moi une progression, dans la mesure où les toiles ont commencé à prendre le dessus sur l’iPad. Auparavant, je reproduisais la platitude de l’espace digital en peignant sur de fins panneaux d’aluminium. Désormais, l’iPad quitte le statut d’élément intrinsèquement lié à l’œuvre pour devenir plus proche d’un outil d’esquisse. Cette série est aussi le premier ensemble d’œuvres que j’ai réalisées sans avoir à l’esprit mes installations habituelles et sans faire intervenir de céramique. De vraies peintures à l’huile ! Sur des toiles ! Pour moi, c’est très radical. La peinture abstraite serait-elle redevenue une marque de radicalisme ? Je plaisante… Ou pas.
Vous considérez-vous comme une peintre ?
Il y a une très forte idéalisation du peintre, qui a tendance à me faire fuir : cette attente que vous composiez chaque jour la partition d’un héroïsme de la peinture… Parfois ma journée d’atelier se passe à manger des chips et à feuilleter des bandes dessinées, à faire une sieste ou des parties d’échecs en ligne avec mes amis qui vivent à l’étranger. Toutefois, je pense majoritairement en termes picturaux. Si j’ai fait des céramiques par le passé, c’est parce que je recherchais un objet domestique en trois dimensions, parfaitement banal (des pichets à eau, essentiellement), dans le seul but de l’utiliser comme un nouveau type de surface à peindre. Mais j’ai aussi fait des films, ou plutôt, des bandes-annonces de films.
“Je souhaite faire percevoir le charme, non pas de la séduction, mais du sentiment de malaise.”
Vous exposez très peu vos œuvres, pourquoi ?
Je suis quelqu’un de très lent. Je suis aussi très prudente, peut-être à l’excès. La peinture abstraite est un genre difficile, qui peut facilement verser dans une catégorie un peu fourre-tout. Si elle est montrée dans un contexte mal adapté, ou aux mauvais endroits, elle peut aussi être perçue comme une mode, ou comme réactionnaire. Prendre le temps d’orchestrer une vraie progression de la nouveauté dans mon travail est quelque chose de très important pour moi, et c’est parfois difficile dans le cadre d’une carrière trop ambitieuse. Bien sûr, si on est trop lent, il y a toujours le risque d’être oublié, ou de se perdre dans la masse, mais je veux laisser une certaine part à l’intuition pour choisir où et quand exposer mes œuvres. La récente invitation qui m’a été faite d’exposer à Paris, c’était aux côtés d’un artiste que j’aime et que je respecte beaucoup, et qui a vu mon travail évoluer. J’ai senti que c’était le bon moment, et le bon contexte.
Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez faire prendre conscience au travers de votre pratique artistique ?
Je souhaite faire percevoir le charme, non pas de la séduction, mais du sentiment de malaise. La séduction peut vous conduire à aimer une œuvre d’art éperdument, aveuglément, et parfois sans réflexion. Le malaise, lui, vous contraint à réfléchir à ce que vous voyez, à vous projeter sur l’œuvre et à interagir avec elle. Je ne veux pas verser dans la psychanalyse, mais la gêne ressentie peut donner un coup d’accélérateur au cerveau. Elle vous fait passer par des processus qui vont inévitablement conduire vos neurones à s’activer de façons nouvelles et inattendues.
Quel sera votre prochain projet ?
Je travaille sur une nouvelle série d’œuvres sur carrelage, faisant intervenir des carreaux blancs de salle de bains, tout ce qu’il y a de plus ordinaires, pour créer un support sculptural à des pièces picturales. J’ai aussi deux films en préparation, notamment un porno soft que j’ai en tête depuis des années.