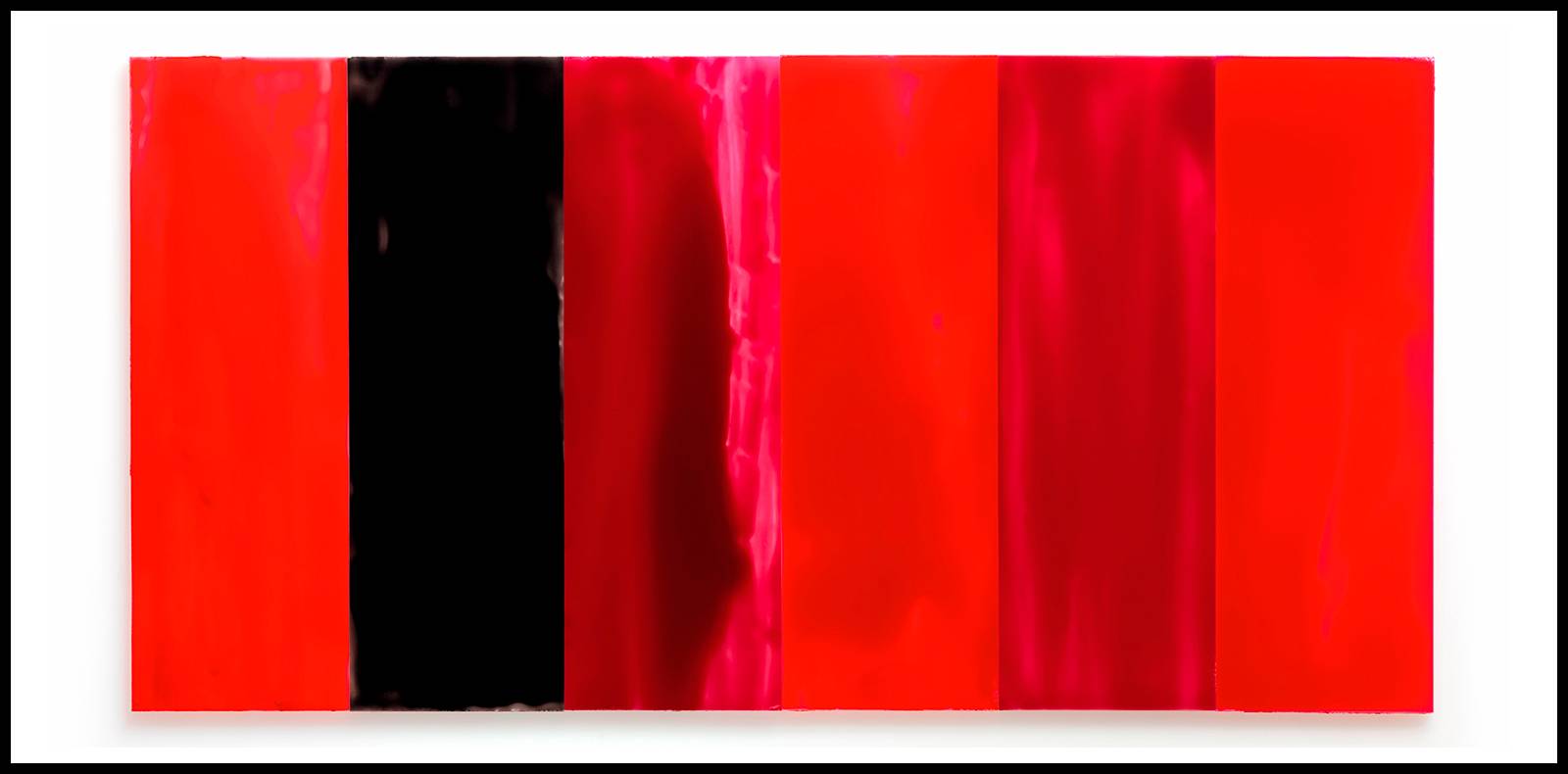19

19
“La nuit, je faisais surtout ce qu’il ne fallait pas faire”, rencontre avec Silvia Venturini Fendi
Durant son enfance, la directrice de la création de la ligne homme de Fendi, Silvia Venturini a pu côtoyer les cinéastes Luchino Visconti et Federico Fellini, grands amis de ses parents. Aujourd’hui encore, sous sa supervision, la maison reste une partenaire privilégiée du septième art. Rencontre.
Propos recueillis par Philip Utz,
Portraits Luca Guadagnino.

Numéro Homme : Vous savez ce que vous êtes, Silvia Venturini Fendi ?
Silvia Venturini Fendi : Non ?
Vous êtes l’incarnation du chic à l’italienne, rien de moins.
Si vous le dites. [Rires.] Je porte la même tenue – un cardigan, une chemise d’homme à manches courtes et un pantalon – depuis toujours. Cela vient sans doute de mon enfance : entre les uniformes stricts des gouvernantes qui m’ont élevée et ceux de l’internat catholique où j’ai été éduquée, cette idée de se lever le matin sans avoir à se soucier de ce que l’on va mettre m’a été insufflée dès le plus jeune âge. Ma grand-mère, une femme très chic, avait elle aussi adopté un code vestimentaire dont elle ne dérogeait jamais : elle portait toujours la même robe chemise bleu marine – que lui confectionnait un couturier français installé à Rome – avec une paire de souliers sur mesure de chez Petrocchi. Bref, c’est à force d’être biberonnée par tant de femmes fortes, à l’allure gravée dans le marbre, que très tôt je me suis résolue à ne jamais porter que la même chose.
On me fait savoir que vous n’aimez pas trop vous étaler dans la presse – et Dieu sait si l’on vous comprend ! Quelles sont les questions que l’on vous pose immanquablement et qui vous donnent envie d’achever le journaliste à coups de talon ?
La question “C’est quoi, pour vous, le luxe ?” m’ennuie à mourir. C’est le degré zéro du journalisme de mode. Celle qui me met hors de moi est : “Quelle est l’inspiration de la collection ?” Mamma mia ! Si les journalistes prêtaient un minimum d’attention aux collections et ne passaient pas le défilé scotchées à leurs portables, elles n’auraient pas à me la poser.
Ôtez-moi d’un doute : est-ce bien vous qui avez dessiné le sac Baguette de Fendi en 1997 ?
Absolument, c’est moi qui l’ai conçu avec l’aide de mon équipe. Vous savez, il ne faut pas croire tout ce que l’on dit. Lorsqu’un lancement de produit remporte un franc succès, il arrive souvent que de sombres individus cherchent à tirer la couverture à eux – même s’ils n’étaient impliqués que de très loin dans le projet. Ce qui est drôle, c’est qu’à l’inverse, lorsqu’un produit ne marche pas, là, il n’y a plus personne.
Comment l’idée vous en est-elle venue ? Vous êtes-vous réveillée un matin en voyant la Vierge et en vous disant : “Ce sera une Baguette et rien d’autre” ?
Non, lorsque vous travaillez sur un projet de cet ordre, ce n’est pas comme si vous faisiez trois croquis et que le sac vous tombait du ciel. Certains de ces lancements sont le fruit d’un an de développement, au cours duquel l’objet en question ne cesse d’évoluer, de muter, jusqu’à trouver sa forme définitive. C’est un travail de longue haleine.
“J’étais milliardaire avant le passage à l’euro, et maintenant je suis multimillionnaire. [Rires.]”
Vous êtes-vous rendu compte, lors de sa création, que le Baguette allait défrayer la chronique ? Ou son succès a-t-il surpris tout le monde ?
Je l’ai su tout de suite – certains objets vous procurent une émotion, une excitation –, mais ce n’était pas le cas de tout le monde. Nos boutiques japonaises, par exemple, n’y croyaient pas du tout et refusaient de passer commande. Ce qui n’était pas anodin, dans la mesure où à l’époque le Japon était comme la Chine aujourd’hui : il constituait notre plus grand marché.
Vos réseaux de production et de distribution étaient-ils suffisamment armés pour répondre à une telle demande ?
Non, nous n’avions pas anticipé le phénomène et nous n’étions absolument pas prêts, ce qui avait ses avantages et ses inconvénients. La demande surpassait l’offre ; du coup, il s’est produit comme un phénomène de pénurie. Les listes d’attente s’allongeaient, ainsi que les files devant les boutiques. Si nous avions inondé le marché, le Baguette ne serait pas devenu si iconique. Par la suite, d’autres maisons ont tenté de reproduire le succès de notre sac en lançant des it-bags à tire-larigot, tout en faisant croire à leurs clientes qu’elles n’avaient que très peu d’exemplaires en stock. Mais ces dernières ne sont pas dupes : il est impossible de leur faire avaler une stratégie marketing fondée sur la rareté si en réalité les usines regorgent de sacs.
À combien les recettes engendrées par cet engouement planétaire se sont-elles élevées ?
Je ne m’en souviens plus, je n’en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c’est que le sac Baguette a fait de Fendi une marque reconnue sur le plan international.
Dans quelle mesure le Baguette a-t-il pesé dans la balance lors du rachat de Fendi par le groupe de luxe LVMH en 2001 ?
Il y avait de très bonnes raisons de racheter Fendi, bien au-delà du sac Baguette. Bernard Arnault [P-DG de LVMH] a pressenti le potentiel de la maison en termes de fourrures et de bagages. Ce qui est certain, c’est que nous avons vendu l’affaire à point nommé. Le tout étant de vendre quand les choses vont bien, et pas quand elles vont mal.
La vente de la marque a-t-elle fait de vous une multimillionnaire, ou carrément une milliardaire ?
J’étais milliardaire avant le passage à l’euro, et maintenant je suis multimillionnaire. [Rires.] Bref, si cela peut vous rassurer, vous n’avez pas à vous inquiéter pour moi. Je suis une femme comblée.

Êtes-vous quelqu’un de plutôt généreux en règle générale ? Lorsque vous prenez un verre à la terrasse d’un café avec vos copines, par exemple, qui s’occupe de l’addition ?
Vous savez comment ça marche : c’est toujours la pauvre petite fille riche qui paie.
Qu’est-ce qui vous a décidée à lancer une ligne de haute fourrure en 2015 ?
C’était pour célébrer les 50 ans de création de Karl Lagerfeld chez Fendi, mais aussi pour mettre en avant tout le savoir-faire et l’expertise de la maison. Comme vous le savez, la fourrure est un sujet qui nourrit de vifs débats. Débats auxquels je ne suis pas insensible. En juillet dernier, par exemple, nous avons voulu montrer avec une collection de haute couture qu’il était parfaitement possible d’appliquer toutes nos techniques et notre savoir-faire à des matières autres que la fourrure.
Justement, comment fait-on pour parler de fourrure aux millennials friands d’écologie, de transparence et d’éthique ?
Chez Fendi, nous sommes très ouverts à la discussion, et nous l’avons toujours été. Nous utilisons déjà énormément de fourrure issue de la chaîne alimentaire…
Qu’entendez-vous par là ?
Il s’agit de fourrure provenant des mêmes élevages que le cuir. Aux dernières nouvelles, personne ne crie au scandale en s’asseyant sur un canapé en cuir, alors pourquoi s’offusquer à propos d’un manteau ? Je me rappelle que, lorsque les mouvements antifourrure ont pris de l’ampleur, dans les années 80, Karl avait signé une collection Fendi qui mêlait vraies et fausses fourrures. Ce qui prouve que nous avons l’esprit ouvert aux alternatives. Mais, sur le plan écologique, ces dernières sont souvent bien plus dévastatrices que la fourrure. Les fibres synthétiques telles que le Nylon, par exemple, ont un impact catastrophique sur l’environnement. La fourrure, après tout, est la matière la plus écologique du monde. Elle est totalement biodégradable, durable, recyclable et ne demande pas à être lavée…
Michael Burke, Pietro Beccari et Serge Brunschwig se sont succédé à la présidence de Fendi, et ils sont tous plutôt jolis garçons… Est-ce vous qui vous chargez du casting des P-DG ?
Non, c’est M. Arnault.
Et s’il ne restait que vous sur terre après l’apocalypse, avec lequel des trois préféreriez-vous refonder l’humanité et la civilisation ?
Ah, question délicate… Je ne voudrais pas faire de favoritisme.
Cela fait maintenant cinquante ans que Karl Lagerfeld est responsable des collections de prêtà-porter féminin de Fendi… Qui verriez-vous pour lui succéder à ce poste ?
Mamma mia ! Je préfère ne pas y penser.
Où avez-vous grandi ?
Chez Fendi.
“J’ai réservé un billet pour la destination la plus lointaine possible – à savoir le Brésil –, où je me suis beaucoup amusée, où j’ai beaucoup dansé, avant de rentrer à Rome à l’âge de 24 ans… enceinte jusqu’aux dents.”
Vos parents faisaient-ils partie de l’entreprise familiale fondée par vos grands-parents en 1925 ?
Oui, d’ailleurs je dis toujours que dans mon biberon il y avait du lait et un double F [le logo de la marque, dessiné par Karl Lagerfeld en 1965, figurant deux F tête-bêche].
Quels rôles tenaient votre mère, Anna, et ses quatre sœurs – Paola, Franca, Carla et Alda – au sein de la société ?
Ma mère était la créative, elle travaillait avec Karl et dirigeait le studio. Carla était la stratège – un vrai Machiavel –, elle s’occupait de l’image et de la communication. Paola était la technicienne, dotée d’une parfaite maîtrise de la fourrure. Franca s’occupait de la distribution et des boutiques, et Alda, quant à elle, était directrice des salons de couture de la fourrure. Aux débuts de la marque, d’ailleurs, Fendi ne réalisait que des pièces sur mesure. Le lancement de la haute couture, en 2015, a donc marqué un vrai retour aux sources.
Les cinq sœurs sont-elles toujours impliquées dans la marque depuis la vente à LVMH ?
Non. Petit à petit, elles ont toutes quitté la société.
Et que sont-elles devenues ? Passent-elles leurs vieux jours à se tartiner de risotto aux truffes au bord d’une piscine à Positano ?
Elles mènent des vies très différentes, mais elles étaient tellement habituées à travailler de longues journées qu’elles sont toutes restées très actives. Ma mère, par exemple, travaille plus que moi. Elle s’est chargée de la décoration de plusieurs petits hôtels que nous avons ouverts, elle produit du vin qu’elle vend dans le monde entier, et elle vient de concevoir le design intérieur et extérieur du yacht Invictus 370 GT…
Comment se fait-il que vous soyez le seul membre de la famille à avoir poursuivi vos activités au sein de la maison ?
Ah, ça, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à M. Arnault. Je crois que c’était un choix très précis de Karl.
“J’étais une vraie party girl. Les garçons, je les avais, et la nuit, faites-moi confiance, je faisais tout ce qu’il fallait faire… et surtout tout ce qu’il ne fallait pas faire.”
Lorsque vous étiez petite, votre avenir était-il tout tracé au sein de l’entreprise familiale ?
Oui, et j’ai donc tout fait pour reporter l’échéance. Je savais très bien qu’en travaillant pour Fendi j’allais me retrouver à travailler vingt-quatre heures par jour. Du coup, j’ai réservé un billet pour la destination la plus lointaine possible – à savoir le Brésil –, où je me suis beaucoup amusée, où j’ai beaucoup dansé, avant de rentrer à Rome à l’âge de 24 ans… enceinte jusqu’aux dents.
Étiez-vous une adolescente rebelle ? Fumiez-vous des joints derrière le garage à vélos en embrassant des garçons avec la langue ?
J’étais une vraie party girl. Les garçons, je les avais, et la nuit, faites-moi confiance, je faisais tout ce qu’il fallait faire… et surtout tout ce qu’il ne fallait pas faire.
Vous êtes directrice de la création des accessoires chez Fendi depuis 1994. Quand êtes-vous devenue responsable des collections masculines de la marque ?
En 2002.
À quoi ressemblait la ligne masculine lorsque vous l’avez reprise ?
Le pôle masculin était minuscule à l’époque. Il était piloté en licence et proposait essentiellement des costumes rigides pas très folichons, donc tout restait à faire.
En quoi les goûts et les habitudes des hommes en termes de mode ont-ils changé depuis que vous dirigez les collections masculines ?
Ils ont changé du tout au tout. Les hommes s’habillent maintenant en toute liberté. Je trouve ce pied de nez au politiquement correct et aux coutumes surannés à la fois magnifique et très excitant.
Quel est votre plus grand marché pour le pôle masculin de Fendi ?
L’Asie. Comme pour tout le monde.
“Je suis tellement accro à mon compte Instagram que je n’en dors plus de la nuit.”
Le numérique et les réseaux sociaux ont-ils affecté la façon dont les hommes s’habillent ?
Absolument. Aujourd’hui, ce sont les réseaux qui dictent les tendances, bien plus que les créateurs. La mode s’est démocratisée dans la mesure où ce sont maintenant les internautes qui tranchent : lorsqu’un produit leur plaît, il devient viral dans la seconde. Personnellement, j’adore ça, même si c’est un désastre : je suis tellement accro à mon compte Instagram que je n’en dors plus de la nuit.
Lorsque vous voyez un “influenceur” habillé comme une pute de carnaval au premier rang de votre défilé, vous n’avez pas envie de le gifler ?
Si. Et lorsque, sur le moniteur en backstage, j’en aperçois un dans la salle, je demande toujours : “Mais qui c’est qui l’a invité, celui-là encore ?”
D’ailleurs à quand remonte la dernière fois que vous avez eu envie de gifler quelqu’un ?
Au dernier show.
C’est quoi, pour vous, la vulgarité ?
Aïe, aïe, aïe ! Difficile d’être précise sur le sujet, vu qu’aujourd’hui la vulgarité est la nouvelle norme. Elle est partout où l’on pose les yeux, en commençant par Instagram.
En quoi Kris Jenner et Kim Kardashian, qui figurent dans la dernière campagne de publicité de la maison, incarnent-elles les valeurs et le savoir-faire de Fendi ?
J’adore cette question. Kris et Kim jouissent toutes deux d’un énorme pouvoir médiatique. Elles n’ont pas peur de le faire savoir ni de se servir de cette plateforme à bon escient. J’étais très admirative, par exemple, de la façon dont Kim s’est rendue à la Maison-Blanche pour convaincre le président américain de commuer la peine de cette détenue qui avait purgé vingt-deux années de prison pour un délit commis sans antécédents judiciaires.
Comme vous le savez sans doute, le thème de ce Numéro Homme est le cinéma, et l’on m’a vivement encouragé à vous poser quelques questions au sujet du septième art. Federico Fellini et Luchino Visconti étaient des inconditionnels de Fendi. Étaient-ils proches de vos parents ?
Oui, Federico venait d’ailleurs souvent dîner à la maison. Luchino et lui adoraient assister aux essayages, notamment lors des nombreux défilés que nous avons organisés à Cinecittà. Tous deux étaient des personnages plus grands que nature, très facétieux, aux univers très oniriques, et je pense que l’idée d’une affaire de famille gérée par cinq sœurs les faisait fantasmer.
“La vulgarité? Difficile d’être précise sur le sujet, vu qu’aujourd’hui elle est la nouvelle norme. Elle est partout où l’on pose les yeux, en commençant par Instagram.”
Si l’on portait votre vie à l’écran, quelle comédienne souhaiteriez-vous pour vous incarner ?
Bette Davis.
S’agirait-il plutôt d’un thriller, d’une comédie romantique ou d’un film d’horreur ?
Ce serait une comédie à l’italienne, avec une bonne dose de second degré, un soupçon de cynisme et un zeste d’horreur.
On vous imagine alanguie sur une méridienne, collant nonchalamment des Post-it sur les Francis Bacon d’un catalogue Sotheby’s pendant que le téléphone sonne, au loin, dans une autre aile du palazzo… Votre vie ressemble-t-elle à cela, ou ce scénario relève-t-il du pur fantasme ?
Vous savez, je suis une vraie mamma italienne, donc, au risque de vous décevoir, vous me trouverez soit en train de m’affairer en cuisine pour nourrir tout ce beau petit monde, soit affalée sur le canapé, exténuée.
Et si vous étiez un personnage de film, seriez-vous plutôt Sharon Stone dans Basic Instinct, Glenn Close dans Les 101 Dalmatiens ou Kim Kardashian dans sa sex tape ?
[Rires.] Bette Davis dans The Anniversary
Assistants photo : Andrea Citro et Cesare Maragnano. Équipement technique : Django Management