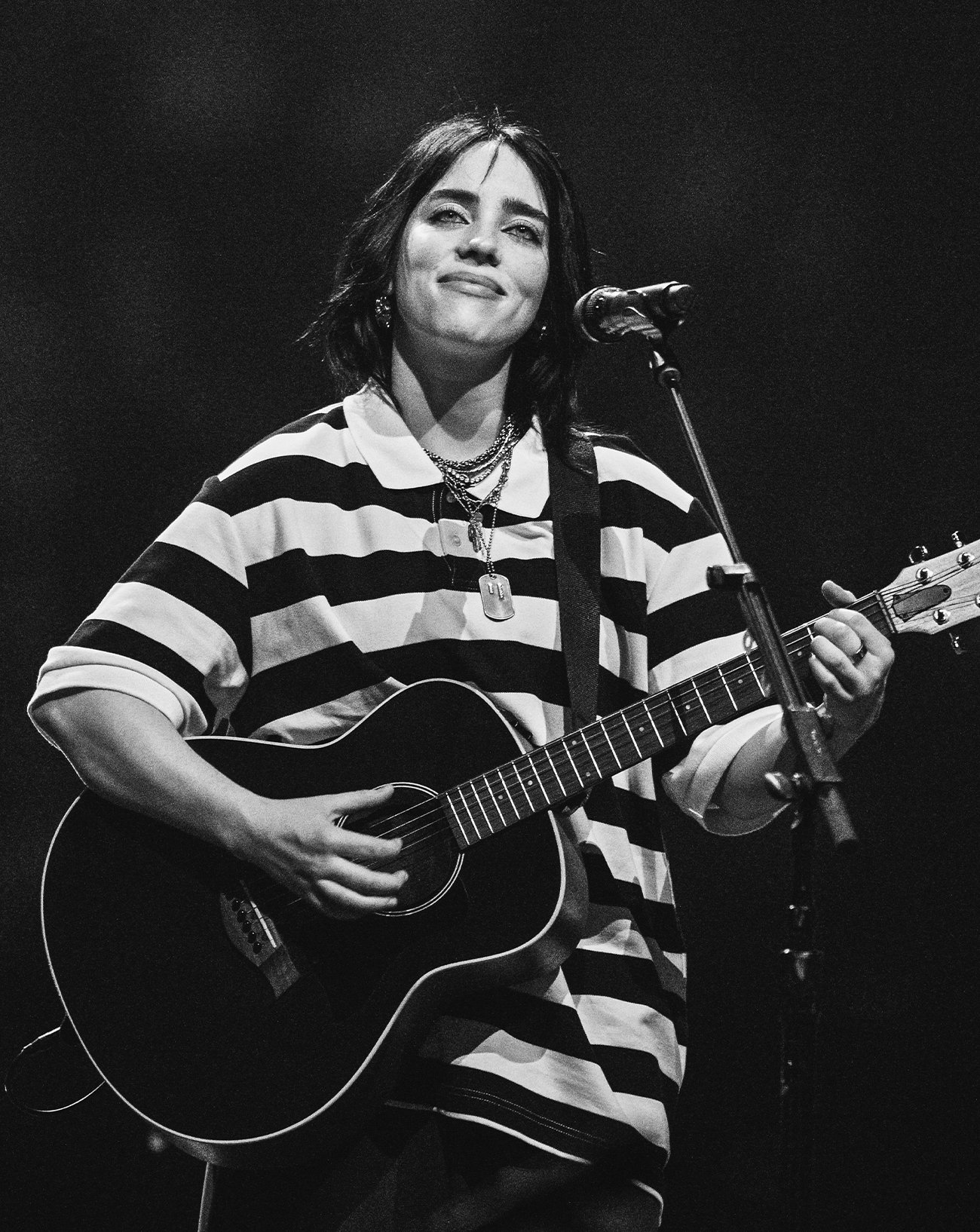11

11
Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, le premier grand film du Festival de Cannes 2018
Onzième film de Christophe Honoré, “Plaire, aimer et courir vite” raconte une histoire d’amour fiévreuse et peut-être impossible dans les années 1990. Pierre Deladonchamps campe un écrivain qui rencontre un jeune Rennais curieux de cinéma et de littérature incarné par Vincent Lacoste. L’épée de Damoclès qu’était alors le sida ajoute à la dimension mélodramatique de leur épopée intime. Entretien avec un réalisateur au sommet de son art.
Propos recueillis par Olivier Joyard.
Publié le 11 mai 2018. Modifié le 10 décembre 2025.

Après Les Chansons d’amour ou encore La Belle personne, le onzième film de Christophe Honoré en seize ans – une célérité rare dans le cinéma français – raconte une histoire d’amour fiévreuse et peut-être impossible dans les années 1990. Pierre Deladonchamps campe un écrivain qui rencontre un jeune Rennais curieux de cinéma et de littérature incarné par Vincent Lacoste. L’amour commun d’une pop music sophistiquée et d’un certain cinéma – de Fassbinder à Carax – donne une aura mélancolique et intense à leur relation. L’épée de Damoclès qu’était alors le sida ajoute à la dimension mélodramatique de leur épopée intime, car le début de leur histoire est peut-être aussi sa fin. En plongeant dans sa propre jeunesse et en rendant hommage aux grandes figures qui ont marqué sa formation artistique et intellectuelle, Christophe Honoré livre un film étonnamment lumineux, souvent léger et toujours surprenant. Plaire, aimer et courir vite est notre premier grand amour du Festival de Cannes 2018. Entretien avec un auteur au sommet de son art.
Numéro : D’où est venue l’idée de Plaire, aimer et courir vite, qui s’apparente à un bilan à la fois léger et profond de tous vos films précédents ?
Christophe Honoré : Après Métamorphoses et Les Malheurs de Sophie, j’avais envie de revenir à une œuvre originale et à des personnages que j’avais pu mettre en scène dans Les Chansons d’amour ou Dans Paris. Mais là où Dans Paris décrivait une sphère familiale, ce film échappe à la famille, pour offrir un tableau d’amitiés électives, amoureuses, sensuelles. Je dois bien admettre que je suis un cinéaste plus sentimental que ce que j’espérais…
Vous racontez une post-adolescence dans les années 90, qui est un peu la vôtre. Comme si on entrait dans votre chambre…
Il y a un mouvement personnel, à partir du moment où j’ai choisi de mettre en avant cette période. Dans le film, en 1993, un étudiant rennais désire venir à Paris. Moi-même, j’étais étudiant à Rennes dans les années 90… Via le personnage joué par Vincent Lacoste, j’interroge une mémoire très personnelle et subjective, pour la confronter à une autre figure – incarnée par Pierre Deladonchamps -, un intellectuel, un écrivain parisien dont la vie aurait pu être une vie souhaitée quand j’avais vingt ans. Mais il y a eu cette tragédie du sida. Rencontrer les gens appartenant à mon panthéon personnel était impossible. Ceux que je pouvais aimer, mes écrivains ou cinéastes élus, étaient morts. Hervé Guibert, Bernard-Marie Koltès, Jacques Demy, Cyrille Collard, le chorégraphe Dominique Bagouet…
A vos yeux, Paris était comme un cimetière quand vous y êtes arrivés ?
C’est l’impression que j’ai et que je partage avec beaucoup d’artistes de ma génération. Les personnes qui m’ont fait aimer le cinéma et la littérature, qui m’ont donné à un moment la volonté d’y croire alors que je venais d’un milieu qui ne me préparait pas à réaliser ce rêve, je n’ai jamais pu leur payer ma dette. Je le ressens encore aujourd’hui comme un manque. Quand j’ai écrit mes premiers romans et réalisé mes premiers films, c’est à eux que j’aurais voulu plaire, c’est aussi contre eux que j’aurais pu désirer me construire, parce qu’on peut se construire contre ses idoles. Peut-être que vingt-cinq ans après, ce film est une manière non pas seulement de me consoler, mais de mesurer le manque. Je ne me fais pas à l’idée de ne pas avoir vu d’autres films de Demy après Trois Places pour le 26, je ne me fais pas à l’idée de l’inachèvement des œuvres de Collard, Lagarce, Koltès ou Guibert, et je ne me fais pas à l’idée – même s’il aurait pu écrire des papiers incroyablement durs sur mes films – que Serge Daney ne les ait jamais vus. Je vois bien comment ces gens sont présents. L’œuvre de maturité de Guibert serait celle de Christine Angot. Le théâtre de Lagarce réapparait alors que lui-même était peu monté de son vivant et avait énormément de difficultés à vivre de son écriture. Ce n’est pas un hasard si notre époque semble éprouver la nécessité de dire qu’ils nous manquent et qu’on a besoin d’eux pour comprendre vers quoi on va. J’arrive à un âge où je deviens celui dont on attend qu’il transmette.
“Le parti pris est de raconter une histoire d’amour sans mettre les personnages qui sont censés être amoureux dans des scènes ensemble…”

L’épidémie de sida a frappé les années 90 et notamment la communauté homosexuelle. Comment la mettre en scène ?
Le film travaille sur une idée que l’on retrouve dans les récits de Lagarce et de Guibert : les malades du sida voyaient leur destin quand ils croisaient d’autres malades à un stade plus avancé. C’est Guibert parlant de la mort de Foucault et disant : “J’ai vu là ma propre mort”… A l’époque, il ne se savait même pas séropositif. La mort des autres était comme un augure. Dans le film, le personnage de Denis Podalydès, Mathieu, ressent comme une injustice le fait de voir son ami plus jeune partir avant lui. Le film s’inscrit juste avant l’arrivée des trithérapies. Cette circulation entre la vie et la mort a été étrange aussi pour ceux qui ont survécu. Ils se sont tellement préparés à mourir et ils ne sont pas morts… Je ne sais pas si cela implique un rapport de radicalité à la vie. J’avais vingt ans et je me demande si c’est l’époque ou simplement mon âge qui a fabriqué cette impression de vitesse, d’intensité, de précipitation, cette impatience que j’avais. Je m’ennuyais fermement à Rennes et pourtant Paris était bien sombre. Le film essaie d’évoquer ces deux vitesses-là, avec un personnage qui accélère, Arthur (Vincent Lacoste) et un autre qui décélère, Jacques (Pierre Deladonchamps).
“Pour la génération de mai 68, le risque était de la sexualité était d’avoir un enfant, un risque lié à la vie. Pour ma génération, le risque c’était la maladie et la mort.”
Un an après 120 battements par minute qui évoquait le sida du point de vue des militants, vous choisissez un angle plus romanesque.
Le projet du film n’est en rien d’être le mémorial d’une association ou une volonté de mise en lumière de personnages qui auraient existé.
L’intrigue se déroule de mai à septembre, en quelques mois. Tout va très vite, mais il n’y a pas de spectaculaire. Le parti pris est de raconter une histoire d’amour sans mettre les personnages qui sont censés être amoureux dans des scènes ensemble… J’ai construit leur histoire sur la distance… C’est par la conversation avec d’autres que nait le lien amoureux. Je trouvais cela intéressant d’un point de vue formel et cela me semblait correspondre à l’idée d’une transmission. Pour moi le sujet de Plaire, aimer et courir vite se situe là : un personnage passe le relais à un autre et lui laisse en héritage des références, notamment littéraires. Dans la dernière partie du film, le personnage d’Arthur a confiance en lui et se lance dans des monologues. Au fond, j’ai l’impression que Plaire, aimer et courir vite montre un homme à deux périodes différentes de la vie. L’un va prendre la place de l’autre et un seul le sait – le plus âgé. C’est peut-être là que se trouve le sens tragique et mélodramatique du film. Le personnage joué par Pierre Deladonchamps se rend compte qu’ils ne sont pas en train de vivre une histoire d’amour, mais de passation. Il doit disparaitre pour que l’autre existe.
Le film explore un sentiment, celui d’une génération traumatisée alors qu’elle entrait dans la sexualité.
Même si j’aurais adoré faire des films à une période un peu antérieure, je fais partie d’une génération sauvée par le fait d’avoir commencé sa sexualité après 1985, au moment où était identifiée la menace du sida. Dans nos lycées, il y avait des capotes et une injonction à la protection. Je l’ai suivie assez docilement, sans jamais me priver de vivre ma sexualité… de la manière dont ça pouvait se présenter. J’ai eu de la chance. Démarrer sa sexualité en 1980 pour un homosexuel a été beaucoup plus dramatique que de la démarrer en 1985. Evidemment, la question dépasse les homosexuels. Au moment où chacun se projetait dans des histoires d’amour, où on avait envie de coucher avec l’étranger, l’autre qu’on ne connaissait pas, on avait en tête qu’il pouvait être une menace. D’un point de vue psychologique, cela créée des traumatismes. Les homosexuels de ma génération ont un rapport à la prévention d’ordre dogmatique et dans l’incompréhension de se retrouver avec de jeunes amants pour qui cela ne semble pas aussi nécessaire. Il y a chez nous l’idée que la sexualité n’est pas sans risque. J’en avais déjà un peu parlé dans Les Biens Aimés. Pour la génération de mai 68, le risque était de la sexualité était d’avoir un enfant, un risque lié à la vie. Pour ma génération, le risque c’était la maladie et la mort.
Qu’est-ce que ce risque a changé ?
Cela donne une autre manière d’espérer quelque chose de la vie. Le sida nous a beaucoup construits, même idéologiquement. On n’oublie pas la saignée qu’il a produit, mais on oublie parfois qu’elle a des répercussions encore aujourd’hui, sur l’injonction qu’on a reçue à domestiquer notre sexualité. Ce n’est pas un hasard si le mariage pour tous est arrivé après l’épidémie, cette idée qu’il fallait limiter les partenaires, pour mener une vie de fidélité et d’exclusivité amoureuse. Ces combats comme le mariage pour tous ne viennent pas de nulle part.
La question des minorités est devenue centrale dans les revendications politiques contemporaines. Avez-vous l’impression de filmer du point de vue de la minorité homosexuelle ?
Evidemment que l’identité sexuelle est une identité marquante qui nous définit. Ce n’est pas pareil d’avoir vingt ans dans les années 90 et d’être homosexuel ou hétérosexuel – pareil en 2018. Après, ce qui est un peu énervant, c’est que sous prétexte qu’on est homosexuel on devrait ressembler à tous les homosexuels. J’ai toujours trouvé plus intéressant de ne pas prétendre faire partie de la minorité. Alors que le film dresse un tableau masculin où 80% des personnages sont homosexuels, je n’ai pas le sentiment de parler à la place d’une communauté. Ce qui m’intéresse, c’est toujours le subjectif, pas l’objectivité des récits. Je ne prétends à rien d’autre qu’à raconter l’intimité d’une histoire. Si après il y a une identification possible, ce n’est pas du tout parce que j’aurai mis en scène des archétypes. Je déteste ce qui est archétypal. On ne se fiche pas de qui on représente, on le fait pour une raison, mais c’est différent de le revendiquer. Le film est traversé par un nombre de livres, de films et de disques importants, cela créé un tissu culturel qui correspond à mes goûts quand j’avais vingt ans. J’étais et je suis encore le produit de mes désirs. Mais mes désirs ne m’enfermaient pas. Ce n’était pas une affiche d’un film de Téchiné qui était dans ma chambre. J’ai l’impression d’appartenir à plein d’autres groupes qu’au groupe homosexuel. Mais je suis vigilant à ne pas gommer cet aspect.
“Le milieu du cinéma français ne m’a jamais intéressé.”
Vous aviez écrit un texte remarqué dans les Cahiers du cinéma pendant les années 90, qui fustigeait une certaine tendance du cinéma d’auteur français. “Le cinéma français qui va bien m’emmerde”, écriviez-vous. Maintenant que vous êtes un réalisateur confirmé, comment vous sentez-vous par rapport à cette question ?
J’ai été sans doute un peu idiot d’avoir une parole assez libre. Comme j’étais cinéphile et que pour moi le cinéma est le lieu de la discussion, je trouvais intéressant d’assumer. Il y a toujours eu des films français qui me hérissent et d’autres qui me rassurent et me stimulent. J’ai réalisé une dizaine de films, je suis ravi d’être présent au Festival de Cannes cette année, car c’est important dans une carrière d’avoir la possibilité de représenter le cinéma français. Mais je ne me suis pas tellement créé d’amitiés. Le milieu du cinéma français ne m’a jamais intéressé. Cela vient sûrement du fait que je travaille aussi sur des mises en scène d’opéra, de théâtre, tout en publiant des romans. Même si je m’assume en tant que cinéaste, j’ai l’impression d’échapper à une étiquette.
Cela vous aide-t-il à ne pas être inquiet pour la situation du cinéma d’auteur ?
Certainement. J’ai beaucoup de mal à accepter l’intermittence du cinéma. A un moment, avec le producteur Paulo Branco, nous avons réussi à faire un film tous les ans et à courir devant la production classique pour tourner dans des conditions particulières. Parfois, nous démarrions un film avant d’avoir l’argent. Je serai toujours gré à Paulo Branco de m’avoir suivi sur Ma mère, Dans Paris et Les Chansons d’amour. Comme je suis entré maintenant dans un cadre plus classique de production, je vois bien qu’il est compliqué de réaliser plus d’un film tous les deux ou trois ans. Or, moi je ne sais pas ne rien faire. Ça m’angoisse. Avec le théâtre, le cinéma et l‘écriture, je continue ma réflexion et je m’ouvre ailleurs. Je ne crois pas que ça me disperse, au contraire ça me fixe. Sinon, je pourrais très facilement me dire que je n’ai pas besoin du film suivant. Si j’attendais deux ans avant de me remettre à un film, je crois que je ne le tournerais pas. Mais j’échappe à cela parce qu’en allant voir ailleurs, le cinéma me manque. Je suis toujours impatient de retrouver un plateau et de travailler avec de nouveaux acteurs comme ici Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps. C’est une perpétuelle régénération.