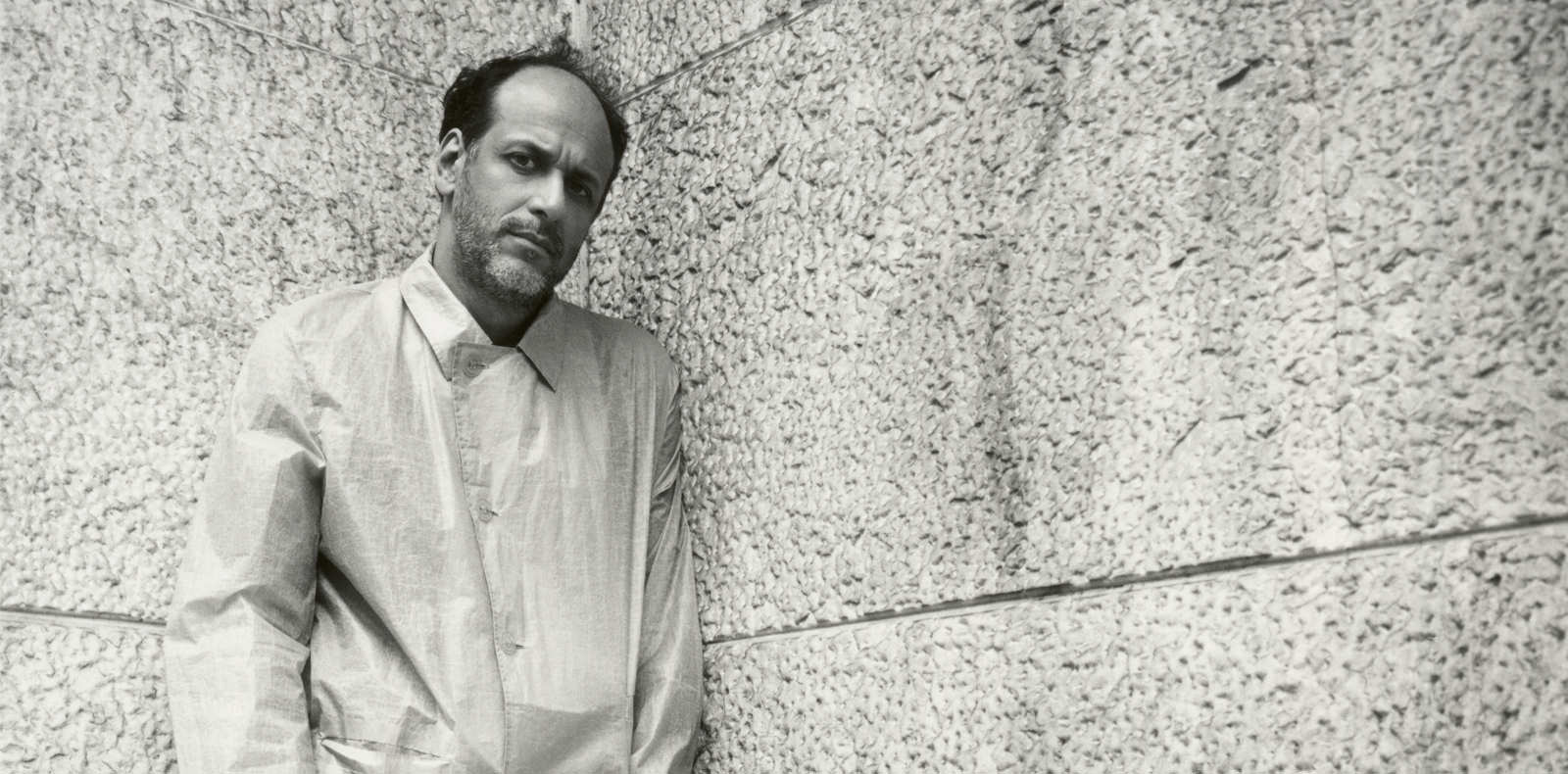31

31
Rencontre avec Gregory Crewdson, photographe de l’angoisse et de la solitude
Sa logique de production est celle du cinéma : des équipes de quarante personnes, des mois de préparation et de repérages… Réminiscences des films de David Lynch, les images ultra composées de Gregory Crewdson, baignées dans des clairs-obscurs mystérieux, saisissent des scènes de vie américaine ordinaire habitées par des personnages aux prises avec eux-mêmes, dans des moments de solitude où pointe l’angoisse. Alors qu’il se lance dans une toute nouvelle série, l’artiste se confie à Numéro Homme.
Par Thibaut Wychowanok.

Le photographe américain de 56 ans a remis en route la machine à fabriquer des images. En juillet dernier, Gregory Crewdson se lançait dans une nouvelle série à la production spectaculaire. Des mois de repérage, une équipe d’une quarantaine de personnes, deux jours pour réaliser une seule image… Ce n’est pas pour rien que Crewdson est l’un des représentants les plus reconnus de la staged photography, cette photographie de la mise en scène où chaque détail, accessoire, décor, personnage, lumière est pensé. Et si son style, entre artificialité inquiétante et documentation d’une Amérique middle class, le rapproche de la peinture réaliste américaine, Edward Hopper en tête, ses tableaux-opéras font tout autant penser aux univers fantastiques et schizophrènes d’un David Lynch.
Aujourd’hui, l’artiste, représenté par les plus grandes galeries – Daniel Templon à Paris, Gagosian dans le monde –, est devenu lui-même une référence pour nombre de réalisateurs de films et de séries. Les couleurs bleutées, électriques et flamboyantes de sa série Twilight (1998–2002) pourraient très bien être la matrice visuelle de la série Stranger Things. Sur l’une des images emblématiques, un personnage, figé au milieu de la rue, est pris dans une lumière mystérieuse venue du ciel. Un projecteur de stade ou un vaisseau spatial ? Cette vision nocturne au cœur d’une banlieue résidentielle américaine est d’une efficacité redoutable. Le moment figé demeure énigmatique, pris dans un entre-deux, au milieu d’une scène de film dont on ne connaît ni l’avant ni l’après. Car Crewdson est depuis longtemps passé maître dans l’installation d’une tension dramatique et psychologique ambiguë.

Dans sa dernière série, réalisée entre 2013 et 2014, Cathedral of the Pines, Crewdson quittait pour la première fois les décors citadins au profit d’une nature brumeuse, plus douce, mais encore plus solitaire et mélancolique. L’artiste sortait d’un divorce douloureux et s’était offert pour refuge une église désaffectée du Massachusetts. Il s’adonne alors à de longues balades dans les Appalaches, nage dans le lac Upper Goose, et se met au ski de fond avec Juliane Hiam, sa nouvelle compagne (et aussi son bras droit). Il tombe sur une pancarte “Cathedral of the Pines” – “La cathédrale des pins”. C’est une révélation. La vision de la série de photos s’impose à son esprit. Pour la première fois, des membres de sa famille et sa compagne posent pour lui. Sur ses grands formats, de près d’un mètre à plus de deux mètres de largeur, les forêts se font majestueusement inquiétantes, des femmes nues aux corps blanchâtres se dressent devant une rivière… Le désespoir déjà prégnant dans son œuvre y prend une dimension plus intime.
Près de cinq ans plus tard, Gregory Crewdson est enfin sur le point de passer à une autre étape. Une nouvelle série. Rencontre, à la veille de la prise de vue avec l’un des plus grands faiseurs d’images de l’Amérique.

Numéro Homme : Vous commencez dès demain la production d’une nouvelle série de photos, la première depuis Cathedral of the Pines. De quoi s’agit-il ?
Gregory Crewdson : Cette nouvelle série constitue un contrepoint à Cathedral of the Pines. Elle la complète en quelque sorte. En 2013-2014, l’ensemble des photographies s’articulaient autour d’un lieu – essentiel –, Becket, dans le Massachusetts. Mes parents y avaient une petite maison en bois. Ma nouvelle compagne y avait grandi. Je parcourais souvent les environs. C’était un retour à l’enfance, à quelque chose de primitif. Il était question de désir. On y voyait beaucoup de corps nus, ou partiellement vêtus. La chair, la peau, les corps… La nature et la relation que les sujets entretenaient avec elle jouaient un rôle primordial. A contrario, j’ai choisi un environnement urbain pour ce nouveau projet. Moins intime… Enfin, nous verrons bien.
Comment se prépare une telle série ?
Il y a un peu plus d’un an, j’ai commencé à traverser la région en voiture, sans but. Je revenais encore et toujours vers certains lieux, si bien qu’ils ont commencé à prendre une place prééminente dans mon esprit. Des histoires ont émergé. Je dis souvent qu’imaginer une nouvelle série revient un peu à partir
à la chasse aux champignons. Savez-vous comment les gens s’y prennent ? Ils ont leurs spots, leurs lieux de prédilection, où ils se rendent chaque semaine ou chaque mois. Je retourne sur mes spots tous les ans, les examinant sous un nouvel angle, à une nouvelle période de l’année, à une heure différente.
Je reste dans ma voiture à écouter des podcasts (oui, je suis totalement accro aux podcasts). Et puis un jour, sans vraiment savoir pourquoi, je sens qu’un lieu est le bon. Il est prêt pour la photo.
“Dans mes œuvres, la fenêtre et la porte rappellent que l’image est une construction. Une composition. Elles créent un sentiment de voyeurisme.”
Comment préparez-vous vos shootings ? Prenez-vous des photos de repérage ou réalisez-vous des croquis ?
Non, jamais. La production de la nouvelle série commence demain, mais j’y travaille depuis des mois. Avec ma partenaire, Juliane, nous travaillons la description de chaque image dans les moindres détails. Tout tient sur une demi-page. Et puis nous contactons notre producteur, nous définissons le budget, le nombre de jours de shooting – en général, deux jours par image. Nous lançons le casting. Je discute avec mon directeur de la photographie, Rick Sands. Nous travaillons ensemble depuis vingt ans déjà. Quelques jours avant la prise de vue, nous définissons sur place les lumières. Au final, nous serons une quarantaine demain. L’équipe était plus réduite pour la sérieBeneath the Roses : entre quinze et vingt personnes. Mais une cinquantaine pour Cathedral of the Pines.
Le mystère et l’étrange hantent vos images. On y décèle ce que Freud nommait “l’inquiétante étrangeté”, ce malaise qui naît d’une rupture dans la rationalité rassurante du quotidien. Votre père n’était-il pas psychanalyste ?
En effet. Je ne m’y connais pas trop en psychanalyse, même si j’ai souvent dit que j’écoutais les conversations entre mon père et ses patients. Il a eu une grande influence sur moi en me faisant prendre conscience qu’il existe un monde sous la surface des choses… un monde secret qui se cache derrière les apparences d’une vie ordinaire. L’étrangeté dont parle Freud correspond bien à mon travail : ce moment où le sentiment de familiarité, très en surface, se transforme en un sentiment de terreur car des connexions se sont faites avec un événement refoulé.

Y a-t-il une part d’autobiographie dans votre œuvre ?
Mes images reflètent certains aspects de moi, mes peurs, mes désirs, mes obsessions. Cependant, elles ne les expriment jamais entièrement. Elles les effleurent. Tout demeure finalement assez mystérieux… [Silence.] Je crois que tous les photographes font, d’une manière ou d’une autre, l’expérience du sentiment d’être séparé du monde. L’acte de prendre une photo est lui-même un acte de séparation d’avec le monde. Le viseur vous met à distance. Alors, même si certains thèmes ou sentiments très personnels sont présents dans mes images, il demeure une légère réserve jusque dans les clichés les plus intimes.
Parmi les obsessions qui traversent votre œuvre, on peut citer la nudité, le thème de la femme enceinte ou encore celui de la fenêtre et de la porte. Que représentent-ils ?
Les fenêtres et les portes sont des cadres, par essence. Elles forment au sein de l’image un cadre dans le cadre et rappellent que cette image est une construction. Une composition. Elles créent aussi un sentiment de voyeurisme. La fenêtre est un point de séparation non seulement entre l’espace intérieur et l’espace extérieur, mais aussi entre le familier ou le domestique et l’inconnu ou le mystère. C’est une manière de séparer les gens du monde qui les entoure…
“Mes images disent quelque chose de notre époque, et j’espère qu’elles ont une certaine pertinence de ce point de vue.”
… Et d’évoquer ce sentiment de solitude caractéristique de vos images.
Une tension entre une forme d’aliénation et une volonté de créer du lien est toujours présente. Créer un lien avec un autre corps, un paysage, ou quelque chose de plus grand que soi.
Vos images représentent toujours des moments suspendus, comme avant ou après l’orage. Les visages sont peu expressifs. Que racontent-ils ?
Je n’essaie jamais de suggérer un avant ou un après. L’histoire n’est jamais explicite. Le récit est ouvert. Cela correspond aussi à la nature de la photographie – capturer un moment – et à la manière dont fonctionne mon esprit. J’imagine toujours des images figées. Je ne vois jamais une scène dans son entièreté, avec un début et une fin.

Vous parliez de voyeurisme. On ne peut s’empêcher de faire le lien entre votre travail et le cinéma “voyeuriste” de Brian De Palma.
J’ai été particulièrement influencé par la série de films que Brian De Palma a réalisés dans les années 80 : Dressed to Kill, Body Double… Je pense à sa sensibilité évidente au cinéma d’Alfred Hitchcock, à son usage extrême de la couleur, du sexe et de la violence. Au voyeurisme bien sûr. Et à sa tendance à
la mise en abyme : Brian De Palma crée toujours des films au sein de ses films – la ligne demeure floue entre les différents niveaux de fiction. Et puis c’est un génie du cinéma de genre.
Jusqu’où va votre voyeurisme ? Vous contentez-vous de rester dans votre voiture ou observez-vous les gens chez eux, pendant vos virées ?
C’est tout l’intérêt de travailler dans un vrai quartier. Vous apprenez à connaître les gens. Ils deviennent des personnages. Vous commencez à les appeler par leur nom. Cette alliance entre la vraie vie et la fiction est magnifique.
La dimension esthétique de vos photographies est davantage soulignée que leur aspect documentaire…
… Qui, pourtant, est essentiel. Ce sont de vraies gens – je ne fais pas appel à des acteurs, je préfère, autant que possible, montrer des gens du quartier, de vrais lieux, la vraie vie dans mes images. La photographie offre une approche privilégiée du monde. Elle l’enregistre et le documente. C’est la base de mon travail. Construisant là-dessus, je peux apporter une sensibilité plus picturale ou cinématographique à l’image. Mais, à la fin, il y a toujours une personne qui est prise en photo, et une autre qui prend la photo. Il y a toujours un certain détachement, un voyeurisme que l’on ne trouvera jamais dans une peinture.
À travers vos images, vous témoignez d’une Amérique profonde. Quel regard portez-vous sur votre pays ?
Évidemment, mes images disent quelque chose de notre époque, et j’espère qu’elles ont une certaine pertinence de ce point de vue. Mais elles ne sont jamais politiques au sens littéral. J’évite soigneusement tout discours explicite.