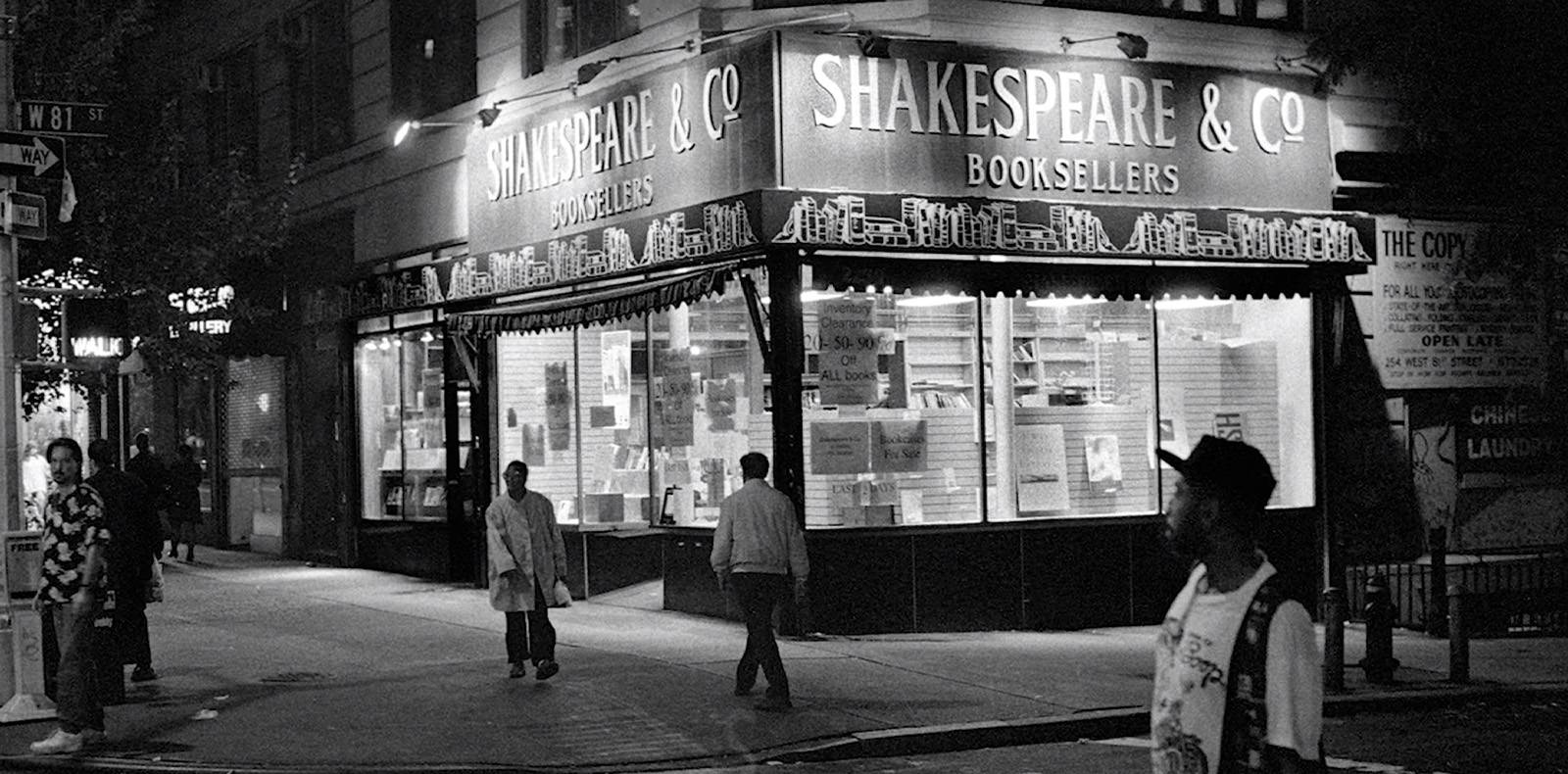11

11
Quand les galeristes parlent de leurs artistes : Douglas Gordon vu par Kamel Mennour
L’ex-enfant terrible de l’art britannique et immense artiste conceptuel, Douglas Gordon, a rejoint Kamel Mennour en 2018. À l'occasion de notre série d'été revenant sur les histoires exceptionnelles entre les artistes et leurs galeristes, le célèbre galeriste parisien en dresse un portrait sincère, entre amitié et admiration.
Propos recueillis par Thibaut Wychowanok.

Numéro art : Quel genre d’homme est Douglas Gordon ? À quoi peut-on s’attendre de la part d’un artiste devenu une star à 30 ans seulement, au cœur des turbulentes années 90 au Royaume-Uni ? Il gagnait alors le prestigieux Turner Prize (en 1996) et était invité l’année suivante à la Biennale de Venise…
Kamel Mennour : Douglas est un funambule. À la fois puissant et vulnérable. Cette position d’équilibriste, cette fragilité lui permettent de s’offrir totalement dans son art. À la manière d’un anthropologue, il navigue autour de son sujet, l’explore, l’approfondit. Ma première rencontre avec l’une de ses œuvres s’est faite avec 24 Hour Psycho en 1993. La vidéo est une version ralentie de Psychose d’Alfred Hitchcock. Pas moins de vingt-quatre heures sont nécessaires pour regarder dans son intégralité le film initial de 109 minutes. Tout était là : Douglas analyse et dissèque. Ce qui lui permet de voir ce que nous, nous ne voyons pas, et ensuite de nous le donner à voir. C’est un art conceptuel, parfois abstrait, mais extrêmement généreux dès que l’on fait l’effort de s’y abandonner. Douglas impose toujours un tempo très particulier. Il digresse ou divague parfois, fait des détours mais retombe toujours sur ses pieds. Plus pertinent que jamais. Il faut accepter son rythme pour aboutir à l’exceptionnel.
À quoi ressemble ce tempo : lento, moderato ou prestissimo ?
Je pourrais vous parler de notre première exposition avec lui à la galerie, fin 2018. Nous devions installer au sein de l’espace avenue Matignon une immense plaque de marbre de plusieurs tonnes. Rendez-vous est pris le mercredi à midi. On avait loué une chèvre [appareil de levage], payé deux régisseurs… À 18 heures, toujours pas de Douglas. C’est un insomniaque, alors rien n’est sûr quant à l’heure à laquelle il se lèvera. Il est dans sa temporalité. Le rendez-vous est reporté au lendemain à 10 heures. Toujours pas de Douglas. Et puis le voilà qui débarque en fin d’après-midi, en combinaison fluo improbable, l’hymne écossais à fond sur son téléphone portable. L’équipe a éclaté de rire. C’est ça, Douglas Gordon. Il me vient une autre anecdote : quand la Fondation Giacometti l’a invité pour une exposition qui devait à l’origine avoir lieu ce printemps [The Morning After, à l’Institut Giacometti], Douglas s’est immédiatement rendu sur place. Il y a dormi pendant quatre heures ! Puis il a installé, au sein de l’exposition en cours sur le marquis de Sade, une main qu’il avait sculptée. Elle est toujours nichée sur l’une des balustrades, et y restera jusqu’au printemps 2021. Douglas avait en réalité commencé son travail d’insémination de l’espace et de questionnement sur le sens que pouvait revêtir son intervention au sein d’une telle institution : que peut dire un artiste face au double monument que forment la fondation et l’artiste Giacometti ? Comment l’artiste va-t-il entrer en dialogue, voire en confrontation, avec ce monument jusqu’à le faire tomber ? Lorsque son exposition a été annulée en raison du confinement, le directeur de l’Institut Giacometti Christian Alendente lui a envoyé un message : “The exhibition is postponed.” Douglas lui a aussitôt répondu : “je déteste ce mot de ‘postponed’, ‘remise à plus tard’. L’exposition n’est pas postponed, elle est ‘delayed’.” C’est-à-dire qu’elle était étirée. Douglas réalise désormais non pas une exposition, mais une résidence qui durera un an. Comme pour 24 Hour Psycho. Douglas est l’artiste de l’étirement des choses. On le voit aussi, il adore jouer avec l’étymologie des mots.
“Douglas analyse et dissèque. Ce qui lui permet de voir ce que nous, nous ne voyons pas, et ensuite de nous le donner à voir.”
Douglas Gordon a été représenté à Paris par la galerie Yvon Lambert jusqu’à sa fermeture en 2014. Il n’a intégré votre pro- grammation qu’en 2018. Pourquoi à ce moment précis ? Et en quoi consistait cette première exposition chez vous, avenue Matignon, et la suivante, rue du Pont-de-Lodi ?
Cela s’est fait très naturellement. J’ai retrouvé Douglas par hasard chez Philippe Parreno. Douglas et Philippe se connaissent depuis longtemps, ils avaient réalisé ensemble Zidane, un portrait du XXie siècle en 2006. Le film suivait Zinedine Zidane pendant les 90 minutes d’un match ! J’étais impressionné, mais Douglas n’est pas un de ces artistes prétentieux et égotistes. Il sait vous mettre à l’aise. La complicité s’est tissée, sur l’amour de l’art bien sûr, et du foot. Nos deux passions communes ! Et très vite s’est imposée l’idée de faire ensemble une double exposition : la première, L’Inventaire de mon désir, avenue Matignon, revenait sur son appétence pour le surréalisme, Claude Cahun, Man Ray… Douglas est doté d’une culture encyclopédique et a une connaissance exhaustive de l’art, de Marcel Duchamp à Ed Ruscha, du cinéma à l’art contemporain.
La deuxième exposition, L’Anatomie de mon désir, rue du Pont-de-Lodi, était inspirée du film Le Ballon rouge d’Albert Lamorisse. Énorme succès de 1956 qui raconte l’amitié entre un petit garçon et un gros ballon qui le suit dans les rues de Paris…
Douglas racontait pour la première fois son arrivée à Paris pour intégrer les Beaux-Arts, alors qu’il n’avait pas 20 ans et qu’il dormait dans des petits hôtels non loin de la galerie – un hasard. Il déambulait dans les rues. Cette exposition autobiographique est un hymne à l’art, à l’amour, à l’enfant qu’il était. Au-dessus de la verrière de la galerie, un ballon rouge flottait… avec une corde qui pouvait aussi faire penser à celle des suicidés. Douglas était sans doute, à cette période, complètement asséché. Ces deux expositions étaient pour lui un retour aux sources pour pouvoir aller de l’avant, à nouveau.