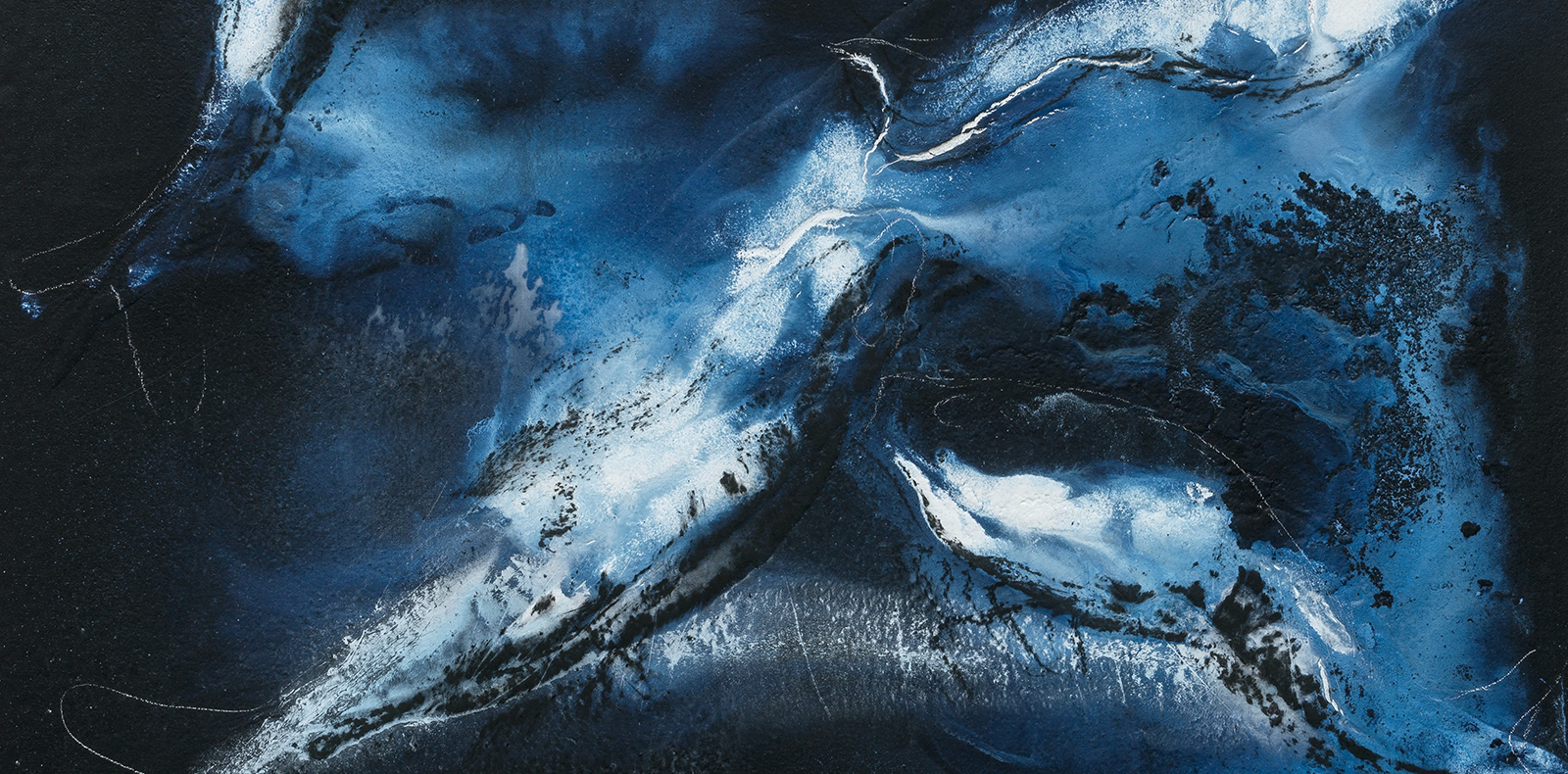
20
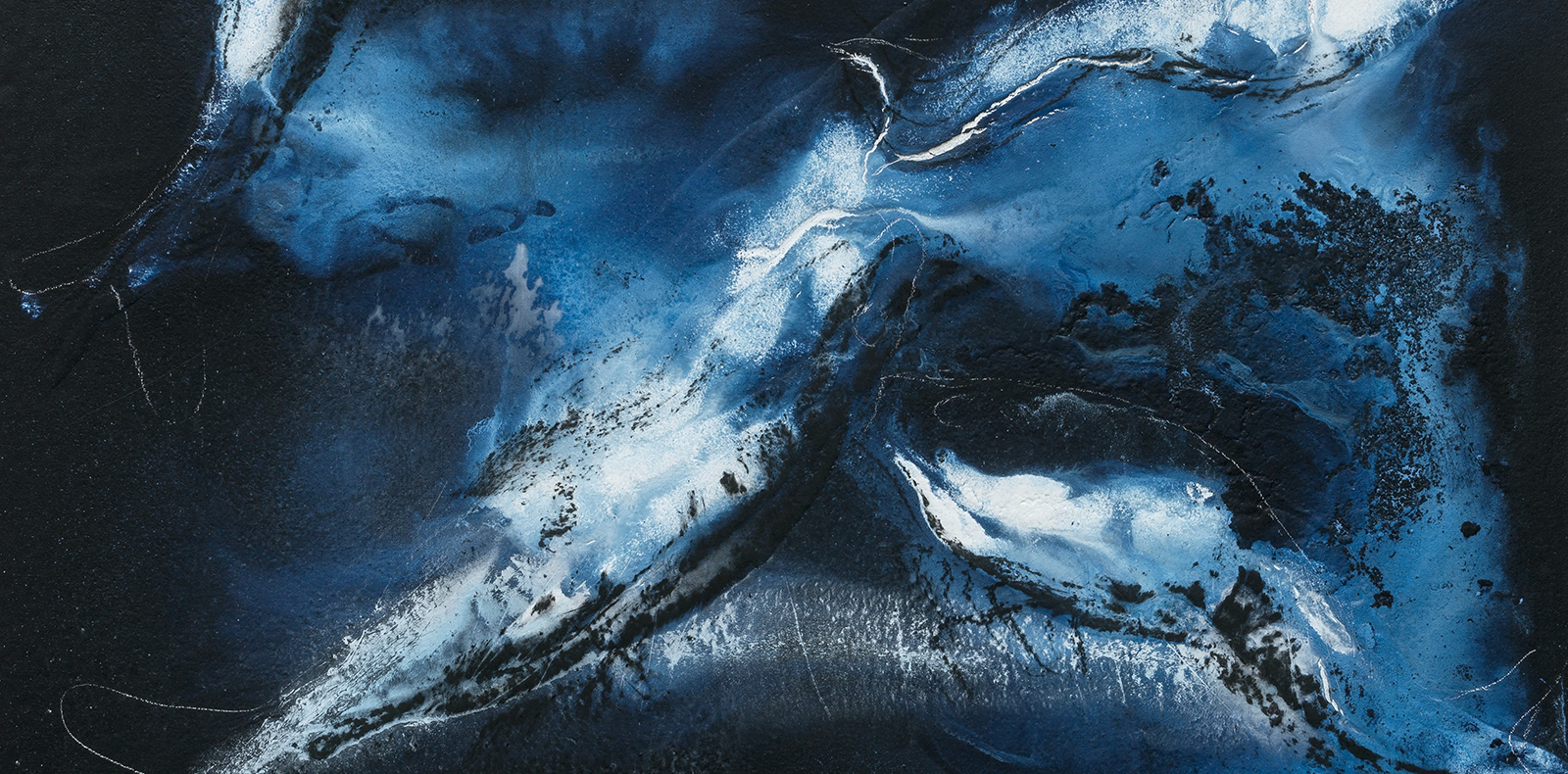
20
Du Mali à Majorque, voyage avec l’artiste Miquel Barceló
Grand admirateur de l’artisanat, cet artiste a beaucoup travaillé auprès des Dogons, en Afrique. À travers la peinture, la sculpture, le dessin, la céramique, il explore le lien mystérieux qui unit l’esprit et la main de l’homme depuis les temps préhistoriques pour donner naissance aux œuvres d’art.
Propos recueillis par Nicolas Trembley.

Miquel Barceló traverse l’art du XXe siècle depuis plus de soixante ans. Révélé très jeune au sein de la “nouvelle figuration”, il échappe néanmoins à toute catégorisation. Proche des écrivains-voyageurs infatigables, parcourant la planète du Mali aux États-Unis, il travaille entre Paris et l’île de son enfance, Majorque. Peinture, dessin, céramique ou sculpture, tout intéresse cet artiste qui a développé une relation intime avec ses matériaux : pigments introuvables, argile de tel endroit, etc. Processus de création, altération et destruction constituent le cœur de son œuvre qui se renouvelle sans cesse, telle une parabole de notre existence. Nous l’avons rencontré lors de sa dernière exposition à la Galerie Almine Rech de Bruxelles. Il est également représenté par Thaddaeus Ropac à Paris.
Numéro : Quelle formation avez- vous suivie ?
Miquel Barcelo : Entre 16 et 17 ans, j’ai suivi des cours à l’École des arts et métiers de Paris pour préparer l’examen d’entrée aux beaux-arts de Barcelone. J’y ai été admis, mais je n’y suis pas resté plus d’une semaine ! J’ai quand même appris pas mal de choses en dessinant des nus et des statues. Puis, toute ma vie, je me suis intéressé aux techniques de la peinture, de la sculpture et de la céramique. Quand j’étais très jeune, ma mère avait pour habitude de peindre des paysages, en plein air. Alors à 8 ou 9 ans, j’avais déjà moi aussi mon chevalet et de la peinture à l’huile. On pourrait donc dire que je pratique depuis ma plus tendre enfance.
De quelle manière votre environnement familial a-t-il influencé votre parcours ?
Ma mère faisait de la peinture que je qualifierais de postimpressionniste. Moi, j’appelais ça “pastel [“gâteau”, en espagnol] impressionniste” parce que c’était un peu comme faire de la pâtisserie, et que j’aimais bien ça. Chez moi, il y avait aussi des livres de peinture. Comme j’ai vécu avant la fièvre touristique qui s’est emparée de l’île de Majorque et de la Méditerranée, j’ai eu beaucoup d’espace pendant toute mon enfance. J’ai toujours pu travailler dans les centres historiques, dans de grands ateliers, à Barcelone, à Palma et même à Paris. Quand on souhaite peindre, on a besoin d’espace, et désormais on doit aller au fin fond de la campagne.
Quel a été votre premier choc artistique ?
Je me souviens d’une exposition qui rendait hommage à Jean Paulhan, que j’ai vue à Paris lorsque j’avais 14 ans, et des œuvres de Beuys, de Dubuffet et de Klee qui y étaient présentées. Les voir en vrai m’avait subjugué. En regardant un Jackson Pollock, j’ai ressenti une émotion physique, très proche d’une découverte sexuelle, une puissance sensorielle de la peinture.

Quels artistes vous ont influencé ?
Picasso, sans doute. À 12 ou 13 ans, j’avais déjà tout lu sur lui. À Paris, j’avais visité toutes les rues où je savais qu’il avait habité. J’ai peut-être développé à l’égard de cet artiste et du Tintoret un fétichisme extrême. Ils peuplent mon imaginaire depuis mon plus jeune âge. Cela est peut-être dû au fait que j’habitais Palma, dans la même ville que Joan Miró, dont j’ai vu les œuvres et que j’ai pu également rencontrer. J’imaginais l’île comme une petite boîte sombre avec une lumière, et c’était Miró. Bon, peut-être que j’exagère un peu… Quand j’ai découvert Beuys, ce fut aussi un grand moment pour moi. Aujourd’hui, les artistes qui m’influencent sont peut-être ceux dont on ne connaît pas le nom, et qui ont orné la grotte Chauvet, celle de Lascaux ou celle d’El Castillo. Ce sont les artistes avec lesquels je parle tous les jours.
Vous sentez-vous proche d’un mouvement artistique ?
Quand j’avais 20 ans, on m’avait catalogué comme post-punk, nouveau sauvage. Je répliquais : “Mais pas du tout. Je lis beaucoup, je suis un intellectuel, je ne suis pas un punk illettré qui peint des graffitis.” Et mes amis, dans les années 80, c’étaient des gens comme George Condo, des artistes avec lesquels je sortais le soir à New York, à Paris et à Madrid. Maintenant, mon insularité me coupe un peu des autres. Je trouve compliqué de me rattacher à un mouvement. Je me sens bien dans la mouvance de la grotte Chauvet.
Vous utilisez de nombreuses techniques : peinture, dessin, sculpture, performance, etc. Quel médium préférez-vous ?
Il y a longtemps, je disais déjà que chaque artiste, chaque peintre doit inventer sa propre matière. J’avais d’ailleurs du mal à acheter les tubes de peinture que vendaient les boutiques près des beaux-arts, mais d’abord parce que j’étais trop pauvre. J’ai donc commencé à fabriquer ma peinture pour des raisons économiques. Et j’ai tout de suite compris que, comme ça, je faisais quelque chose de différent, d’un peu raté. J’aime bien les ratages et les accidents. Le jaune que je fais pour peindre un citron doit être différent du jaune que j’utilise pour peindre une guêpe. Ce n’est pas la même matière. J’aime cette relation animiste avec la matière picturale. Cela s’applique aussi aux autres médiums. Même les aquarelles, je les fabrique moi- même. Je suis captivé par l’origine des pigments. Je fais des découvertes, comme celle du bleu égyptien, par exemple, ou de l’azurite, un pigment plus difficile à trouver que de la cocaïne, et qui coûte aussi beaucoup plus cher ! On ne le trouve qu’au fin fond de l’Iran. J’ai trouvé des pigments que les Mayas utilisaient il y a un millénaire et je les utilise également. Des pigments qui ne sont plus employés aujourd’hui nulle part dans le monde. J’ai du jaune qui provient d’une usine qui a fermé il y a vingt ans. Par chance, j’ai pu acheter une cinquantaine de kilos de ce pigment qui n’existera plus jamais.
J’ai fait des tableaux intitulés In extremis avec ce jaune-là. C’est un jaune soufre qui n’est ni le jaune de Naples ni l’ocre. J’ai une relation très charnelle avec cette matière. Et avec l’argile, n’en parlons pas ! L’argile fraîche produit le même son que lorsqu’on tape sur de la chair. Pour moi, c’est aussi une forme de peinture. Travailler l’argile me permet de changer d’atelier et de regarder les choses d’une manière différente. Et parfois, en jonglant entre aquarelle, peinture, croquis, bronze, sculpture et céramique, j’ai la sensation qu’il y a toujours quelque chose qui avance un peu dans ma recherche, une énergie, comme un souffle d’avant-garde.

Vous avez beaucoup voyagé, notamment en Afrique, au Mali. Quelle influence ce continent a-t-il eu sur votre pratique ?
Le Mali, c’est toute une histoire… J’y suis allé pour la première fois en 1987, et ensuite, j’y suis retourné tous les ans, pour y rester parfois jusqu’à sept mois. Ça a perduré jusqu’en 2012, ensuite c’est devenu trop dangereux. Avec Isaki Lacuesta, on y a tourné un film intitulé Los Pasos Dobles, puis on a dû arrêter. Au Mali, je possède un atelier dans la falaise où j’ai appris à peu près tout ce que je sais. Pour moi, c’était l’endroit où faire une tabula rasa. Ma peinture s’est complètement transformée, elle est devenue rugueuse au lieu d’être plate, mes dernières céramiques, je les ai faites au Mali, avec des techniques d’il y a vingt millénaires, et j’ai progressé petit à petit vers le XXIe siècle. Un artiste, chaque matin, se sent un peu comme un homme
des cavernes, et parfois, avec un peu de chance, tard dans la nuit, il se sent comme Vélasquez. Mais on remonte chaque jour toute l’histoire de l’art.
Vous portez un grand intérêt à l’artisanat…
Souvent, je n’arrive pas à faire la différence entre l’art et l’artisanat. Un mauvais art, très souvent, n’est même pas de l’artisanat. Alors que souvent le très bon artisanat est une œuvre d’art. J’apprends beaucoup de tous ces savoirs : de la façon dont on tresse un panier, dont on fabrique un piège à lapins… Pétrir la terre, la faire fermenter, la mélanger avec des tessons cassés ou de la paille, de la bouse de vache ou de chameau… J’ai appris ça avec les Dogons et c’est ce que j’utilise dans ma céramique. Et puis, avec cette terre très peu plastique, très différente de l’argile de chez nous, on les tourne à la main et ensuite on les fait cuire dans des petits fours. Cette terre, j’ai appris à la cuire et à la travailler après cuisson, et je fais à peu près la même chose que nos vénérables ancêtres, en un peu plus grand, peut-être.
Beaucoup de vos œuvres s’altèrent ou évoluent avec le temps…
Désormais, j’espère qu’elles ne s’altéreront pas trop ! Mais quand j’avais 18 ans, j’ai fait une œuvre qui s’appelait Cadaverina 15, tirant son nom du composé chimique produit par la décomposition de la chair animale. Cette œuvre se présentait sous forme de petites boîtes : quinze séries de quinze éléments qui pourrissaient dans une exposition pendant quinze jours. Il y avait quinze cœurs de bœuf, l’un était frais et un autre avait quinze jours. J’ai appris beaucoup de choses, c’était comme avoir une porte ouverte sur la beauté de la charogne. J’ai souvent cité cette œuvre comme étant le début de mon curriculum vitae. Je la regarde encore, elle se transforme beaucoup plus lentement désormais. Car c’est vrai que tout se transforme, nous les premiers. Mais mes tableaux auront encore très bonne mine quand mes ossements seront poussière. Je travaille avec des pigments et des matières très robustes, mais j’ai souvent réalisé des œuvres éphémères. J’aime que de grandes œuvres monumentales ne durent que quelques jours, heures ou instants. Les plus belles œuvres ne durent qu’un instant. Après, il faut croire sur parole qu’elles ont existé. C’est comme un petit poème qui a été récité avant d’être oublié.
Vous considérez-vous comme un artiste engagé ?
Je me sens proche des causes écologiques. Je fais ce que je peux, parfois pour des campagnes précises. Je soutiens Greenpeace et quelques autres mouvements. C’est presque une question de bon sens. C’est choquant de voir que les partis conservateurs sont contre l’idée de conserver quoi que ce soit. En même temps, j’aime la tauromachie, que tous mes amis écologistes détestent. Je suis en pleine contradiction. Mais mon art est profondément politique, comme toute forme d’art, je crois.



















