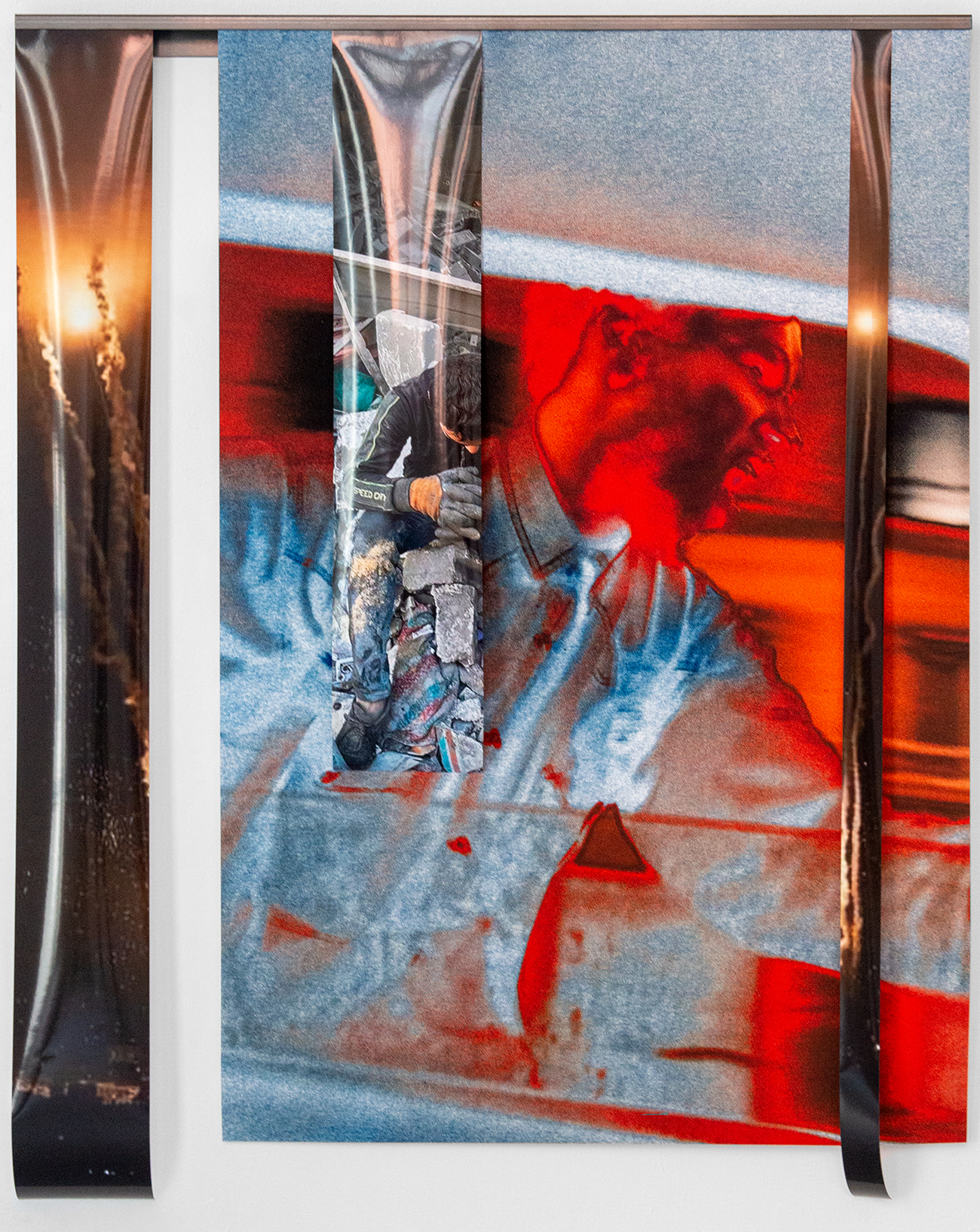8

8
Ymane Chabi-Gara, the painter who depicts modern solitude in colorful canvases
Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2020, la jeune peintre française a immédiatement fait sensation avec ses toiles à la composition recherchée. Chaque détail et chaque couleur y sont pensés avec une attention extrême. Lauréate du prix Sisley l’année dernière, elle vient de rejoindre la programmation de la galerie Kamel Mennour qui lui consacrera bientôt une exposition.
Portraits par Lee Wei Swee,
Texte par Anaël Pigeat.

D’une matérialité qui force à s’en approcher pour les regarder de près, les œuvres d’Ymane Chabi-Gara ont des couleurs pastel dont la douceur contraste avec le trouble qui s’en dégage. Cette jeune artiste est l’une des peintres très remarquées à Paris ces derniers mois et vient d’entrer à la galerie Kamel Mennour.
Dans ses œuvres récentes, elle peint des hikikomoris, ces jeunes gens – des garçons pour la plupart – qui restent enfermés dans leur chambre, en retrait de la société nipponne. Ymane Chabi-Gara s’intéresse à ce pays et à sa culture depuis plusieurs années, en particulier à la musique punk de Tokyo. Au fil des mois, elle avait accumulé des images d’hikikomoris trouvées sur Internet, auxquelles elle a recommencé à s’intéresser à son retour d’une résidence de six mois au Japon, pendant son cursus à l’École des beaux-arts de Paris. C’est pendant ce séjour qu’elle a découvert les gestes du butô qui l’ont si profondément marquée. Ses personnages ont, en général, le visage lisse, les paupières baissées, parfois les pupilles blanches comme celles des statues grecques. Dans ses premières œuvres, on la reconnaissait souvent, comme réincarnée en hikikomori. Passages de genres, passages du monde réel au monde imaginaire… Ce sont des autoportraits qui n’en sont pas complètement, une façon, peut- être, de faire siens ces espaces, en ajoutant quelques objets personnels à ses compositions. Dans ses dernières peintures, elle se représente de moins en moins régulièrement, laissant la place aux sensations colorées que créent ses personnages. En général, elle ne peint pas les regards, une façon d’éviter de figer ses compositions, de nous renvoyer, et de se renvoyer, à des questions de formes, et à la matérialité de la peinture.

Dans ses œuvres récentes, elle peint des hikikomoris, ces jeunes gens – des garçons pour la plupart – qui restent enfermés dans leur chambre, en retrait de la société nipponne. Ymane Chabi-Gara s’intéresse à ce pays et à sa culture depuis plusieurs années, en particulier à la musique punk de Tokyo. Au fil des mois, elle avait accumulé des images d’hikikomoris trouvées sur Internet, auxquelles elle a recommencé à s’intéresser à son retour d’une résidence de six mois au Japon, pendant son cursus à l’École des beaux-arts de Paris. C’est pendant ce séjour qu’elle a découvert les gestes du butô qui l’ont si profondément marquée. Ses personnages ont, en général, le visage lisse, les paupières baissées, parfois les pupilles blanches comme celles des statues grecques. Dans ses premières œuvres, on la reconnaissait souvent, comme réincarnée en hikikomori. Passages de genres, passages du monde réel au monde imaginaire… Ce sont des autoportraits qui n’en sont pas complètement, une façon, peut- être, de faire siens ces espaces, en ajoutant quelques objets personnels à ses compositions. Dans ses dernières peintures, elle se représente de moins en moins régulièrement, laissant la place aux sensations colorées que créent ses personnages. En général, elle ne peint pas les regards, une façon d’éviter de figer ses compositions, de nous renvoyer, et de se renvoyer, à des questions de formes, et à la matérialité de la peinture.

Enfant, dans une famille où l’on ne s’intéressait guère à l’art, Ymane Chabi-Gara voulait être illustratrice. C’est un professeur de l’enseignement secondaire qui lui a fait préparer le concours d’entrée de l’École des beaux-arts, au lycée Pablo-Picasso de Fontenay-sous-Bois. Son premier choc artistique s’est produit au musée d’Art moderne de Paris, lors de l’exposition de Matthew Barney, The Cremaster Cycle (2002), une référence qui résonne avec son goût pour l’exposition des corps, la façon dont elle mêle la violence de ses sujets et la douceur de ses couleurs, et son intérêt pour la musique. Membre d’un groupe, à la guitare et au piano, elle hésitait alors entre l’art et la musique – elle était venue au musée parce que Matthew Barney était alors le compagnon de Björk, à qui elle s’intéressait. Puis le choix de la peinture s’est imposé. Il lui était impossible de faire autre chose de sa vie.
Ymane Chabi-Gara raconte volontiers l’isolement dans lequel elle s’est trouvée à certains moments de sa vie, ces états d’extrême solitude dont la peinture semble en quelque sorte l’avoir sauvée. Et ces états d’obsession, elle les traduit exactement dans ses tableaux, travaillant sans relâche des premières aux dernières heures du jour, dans son atelier situé en bordure de Paris, dans un quartier calme, pris entre des architectures du XVIIIe siècle et d’anciennes usines désaffectées. À l’intérieur, peu d’objets – comme chez elle, raconte-t-elle, car elle a peu de besoins. C’est un curieux contraste avec ses peintures qui foisonnent comme les chambres des hikikomoris ou comme les friperies japonaises saturées jusqu’à l’étouffement dont elle s’inspire également.
Ces états d’obsession, elle les traduit exactement dans ses tableaux, travaillant sans relâche des premières aux dernières heures du jour.
Sur une étagère sont posés des ouvrages consultés récemment : une monographie de David Hockney, un livre sur Alice Neel… Elle dit aussi son intérêt pour l’œuvre de Marc Desgrandchamp, qui a été son professeur à l’École des beaux-arts de Paris, pour les tensions qu’il crée entre une douceur romanesque et une dureté sourde. Elle a le goût des spectacles et des sculptures grinçantes de Gisèle Vienne, et des environnements immersifs des peintures de Katharina Grosse. Aux murs, quelques œuvres, parmi lesquelles une petite cigogne qui provient d’un centre pour personnes handicapées du côté de Glasgow. Son intérêt pour l’art brut résonne lui aussi avec ses obsessions.
Ces états d’obsession, elle les traduit exactement dans ses tableaux, travaillant sans relâche des premières aux dernières heures du jour.
Sur une étagère sont posés des ouvrages consultés récemment : une monographie de David Hockney, un livre sur Alice Neel… Elle dit aussi son intérêt pour l’œuvre de Marc Desgrandchamp, qui a été son professeur à l’École des beaux-arts de Paris, pour les tensions qu’il crée entre une douceur romanesque et une dureté sourde. Elle a le goût des spectacles et des sculptures grinçantes de Gisèle Vienne, et des environnements immersifs des peintures de Katharina Grosse. Aux murs, quelques œuvres, parmi lesquelles une petite cigogne qui provient d’un centre pour personnes handicapées du côté de Glasgow. Son intérêt pour l’art brut résonne lui aussi avec ses obsessions.

Chez elle, le travail est lent et précis, et les décisions sont prises après de longues heures passées à observer ses peintures. Quelques essais sur de grandes toiles l’ont conduite à utiliser des planches de contreplaqué collées sur des châssis, parce que sa matière est épaisse, et qu’elle ne tenait pas sur la toile. Ce sont presque toujours de grands formats, qui permettent de peindre des personnages à taille réelle. En premier lieu, elle pose une préparation faite d’opulentes couches de gesso. Il lui arrive aussi d’utiliser le contenu de ses vieux pots de peinture sèche afin de créer de la matière, ou bien de réemployer d’anciennes peintures pour les recouvrir. Puis vient le moment de passer un jus sur la surface, en général un mélange irrégulier de rose et de jaune, et depuis peu, de différents bleus, dont elle badigeonne aussi la préparation. Le dessin inspiré d’une image source est alors reporté par une mise au carreau très précise – “la seule façon de s’en échapper par la suite”, dit-elle. Pas de dessins préparatoires donc. Mais ces grands dessins, elle imagine les exposer comme tels dans les mois à venir.

Elle n’a jamais été attirée par la peinture à l’huile, mais joue abondamment des degrés de dilution ou d’épaisseur des matières, et du nombre de couches passées sur la planche.
Vient enfin le moment de la peinture même, et de l’évolution de la composition en fonction de décisions formelles qui se suivent pendant des heures de concentration et de délectation. Un petit meuble disparaît, un livre ou un disque est ajouté. Elle travaille différentes sortes de peinture : de la laque acrylique dont la brillance contraste avec des peintures mates, des peintures satinées, et des réserves à travers lesquelles apparaissent la préparation couverte de jus colorés. Elle n’a jamais été attirée par la peinture à l’huile, mais joue abondamment des degrés de dilution ou d’épaisseur des matières, et du nombre de couches passées sur la planche. Les sujets des tableaux, les vertiges de l’espace, les formes de narration que l’on pouvait imaginer s’effacent alors devant la matérialité de la peinture.
Sur sa table, quelques petits panneaux sont en train d’être préparés. Ce sont les futurs supports des petites peintures qu’elle réalise en parallèle de ses grands formats. Celles-ci sont presque abstraites, en général inspirées par des fragments devenus presque illisibles de ses grands tableaux. Ils sont réalisés en une journée. Le jeu des couleurs et des matières tourne à plein. C’est peut-être l’une des directions qu’elle s’apprête à explorer, dans la suite de ses recherches.
Les œuvres d’Ymane Chabi-Gara ont été présentées au sein de l’expositon Des Corps Libres – Une jeune scène française, Studio des Acacias, Paris, du 5 au 28 mai. Elle est représentée par la galerie Kamel Mennour.