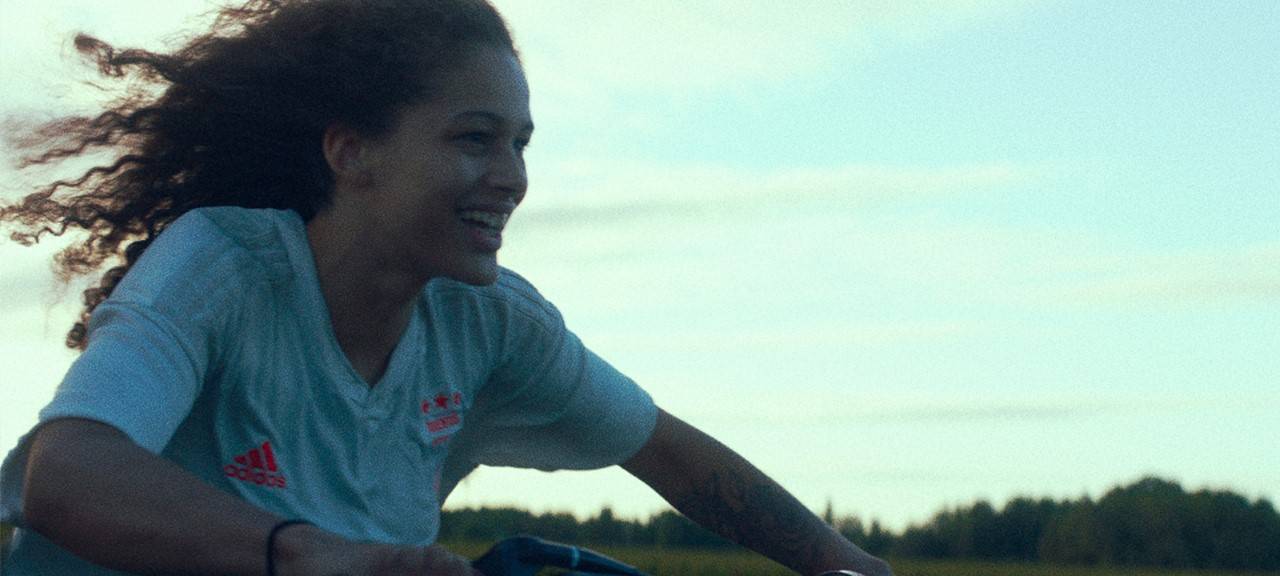18

18
Paris+ par Art Basel : les 10 stands à visiter absolument
Point d’orgue de la semaine de l’art à Paris, la foire Paris+ par Art Basel donnait aujourd’hui le coup d’envoi de sa deuxième édition au Grand Palais Ephémère. Un rendez-vous incontournable de l’art contemporain comptant sur la présence de 154 galeries pointues et audacieuses. Tour d’horizon en 10 stands à ne pas manquer.
Par Matthieu Jacquet.
Publié le 18 octobre 2023. Modifié le 20 novembre 2024.

1. Luisa Strina : vers l’essence de la forme
À quelques pas de l’entrée du Grand Palais Ephémère, le stand de la galerie Luisa Strina incite le visiteur à respirer avant le parcours qui l’attend. Disposés au sol ou accrochés au mur, les dizaines de dessins, peintures et sculptures déroulent une réflexion plastique autour de l’abstraction avec, selon la directrice de la galerie brésilienne, quelques “accents surréalistes”. Ce que l’on retrouve dans les toiles de l’artiste argentine Magadela Jitrik et leurs formes abstraites colorées, qui rappellent aussi bien les œuvres de Joan Miró que la culture précolombienne, ou dans la grande peinture écarlate d’Alexandre da Cunha, qu’un chapeau de paille fixée au centre d’un relief saisissant – presque érotique.
D’autres sculptures présentées sur le stand vont elles aussi vers une essence de la forme et une pureté de la ligne, entre une récente pièce de Leonor Antunes agrémentée de perles de couleur, des structures ultra légères de Jorge Macchi, réalisées avec des cordes de piano, jusqu’au chef d’œuvre historique de Cildo Meireles (Rodos, 1978-1981) : une raclette à vitres en bois décomposée, dont les parties séparées dessinent sur le mur une véritable composition géométrique.
Stand de la galerie Luisa Strina, D1.

2. Anne Barrault : l’avenir de la scène française
Si les stands de Paris+ regorgent de grands noms de l’art contemporain international, il est également possible d’y découvrir les nouveaux talents de la scène française. La galerie Anne Barrault en présente trois cette année, développant tous respectivement une pratique “néo-autobiographique” où se mêlent récits réels et imaginaires. À l’instar de Neïla Czermak Ichti, dont les dessins au stylo à bille sur papier et sur tissu, mais aussi les peintures à l’acrylique dépeignent un univers “alien” aux portes du fantastique. De Rayan Mcirdi, dont les deux films présentés ici mettent en scène des membres de la famille – notamment ses tantes et la mère de l’artiste qui, assises dans un parc ensoleillé, se remémorent le jour où elles quittèrent la banlieue de Sartrouville.
Et enfin d’Ibrahim Maïté Sikely, jeune peintre également présenté au Salon de Montrouge, dont les toiles foisonnantes croisent l’expérience personnelle d’homme noir en France, la culture populaire et les mangas. Une approche particulièrement saillante dans WHAT YA HOOD LIKE IS IT ROHFF??, large peinture représentant un conflit entre policiers et civils, où un géant à l’effigie du rappeur Rohff surgit des flammes pour empoigner les assaillants.
Stand de la galerie Anne Barrault, E11.

3. Layr : les doppelgängers de Lili Reynaud-Dewar
Ce mercredi 18 octobre, Lili Reynaud-Dewar inaugurait une grande exposition au Palais de Tokyo, odyssée dans des chambres à coucher où se croisent notamment des récits de masculinités contemporaines. Une belle actualité à laquelle fait écho parallèlement la galerie Layr à Paris+, en présentant six sculptures anthropomorphes hyperréalistes à l’effigie de l’artiste française. Réalisées en aluminium, ces œuvres à taille humaine la dévoilent assise dans diverses positions, le nez rivé sur son téléphone, et forment un contrepoint aux fameuses performances filmées de la quadragénaire qui s’y met en scène en train de danser, nue, dans des musées et espaces d’exposition.
Derrière elles, on découvre un large panneau où l’artiste a transposé ses correspondances journalières avec des curateurs et directeurs d’institutions, dont on trouvera d’autres extraits au Palais de Tokyo. Un corpus qui témoigne de son regard mordant sur le monde de l’art, ses institutions et la place — souvent fragile — que peut y trouver l’artiste.
Stand de la galerie Layr, E4.

4. Dvir Gallery : Douglas Gordon en majesté
Sculptures de chevaux décapités au sol, toiles écrues trouées par l’action du feu au mur : le stand de la Dvir Gallery semble tout droit sorti d’une maison abandonnée, abîmée par le passage du temps. Derrière les dizaines de compositions textiles aux formats divers qui tapissent ses trois cimaises, ponctuées de cire fondue et partiellement carbonisées pour y dévoiler des miroirs, on reconnaît le geste caractéristique du Britannique Douglas Gordon, qu’il avait déjà appliqué à des reproductions des sérigraphies d’Andy Warhol ou encore des photographies d’archives, comme pour détruire l’histoire visuelle qui imbibe notre inconscient collectif.
En plein confinement, alors qu’il se trouve soudainement seul dans son atelier berlinois, l’artiste entame une nouvelle série où il imprime cette fois-ci sur des toiles des extraits des premiers numéros du magazine Playboy, mêlés des à des textes de la Bible qu’il étudiait dans sa jeunesse. Une passion pour la collection et la mémoire que partage la jeune artiste Bri Williams, dont on découvre à côté les chevaux de carrousel, disloqués et écaillés pour devenir les reliques d’une enfance dissolue.
Stand de la Dvir Gallery, E27.

5. Allen : la tempête de Jason Dodge
Une tempête semble être passée sur le stand de la galerie Allen. Au sol, la moquette grise disparaît sous des centaines de bouts de papier, de mousse, de foin et autres miettes en tous genres. L’installation de Jason Dodge ne manque pas d’interpeler : habitué à réaliser des œuvres in situ, l’artiste américain matérialise ici l’absence, d’un événement passé dont ne subsistent que quelques traces éphémères sur le présent.
Les autres œuvres présentées par la galerie parisienne semblent elles aussi, pour la plupart, maintenu dans un temps suspendu où la nature s’invite dans l’univers domestique : on découvre par exemple les mobiles aux airs de griffes suspendus à des chaînes en métal de Tarek Lakhrissi, qui s’inspire ici d’une nouvelle de Jean Genet, des macrophotographies de fleurs de Laetititia Badaut Haussmann, une pièce en acier brûlé semblable à une fenêtre opaque signée Maurice Blaussyld, ou encore un pachira en pot, plante d’intérieur accrochée à la cimaise par des harnais de l’artiste chinois Trevor Yeung.
Stand de la galerie Allen, F21.

6. Seventeen : l’écologie queer et cryptique de Joey Holder
Dans une foire d’art contemporain, il est généralement rare de croiser des œuvres sonores, d’autant plus de les entendre dans le brouhaha ambiant. C’est pourtant le cas dans le secteur des galeries émergentes, où un beat techno retentit depuis le stand de la galerie Seventeen. Dans une grande structure noire, six écrans projettent diffusent des images de manière stroboscopique, quelque part entre des symboles ésotériques, spectacle psychédélique et plongée dans un monde microscopique.
Passionnée de science et d’art numérique, l’artiste britannique Joey Holder s’intéresse ici au plancton dont elle souligne les pouvoirs magiques – du changement de genre à l’absorption du carbone – et les cryptides, ces êtres vivants inconnus des humains. Cette exploration du monde de l’invisible corrobore sa théorie de la queer ecology : une écologie alternative dépassant les dichotomies entre vivant et non vivant, réel et imaginaire, naturel et non naturel, pour envisager la nature comme un flux éternel, à l’encontre de nos conceptions anthropocentrées.
Stand de la galerie Seventeen, C14.

7. Marfa’ : les archives queer et factices de Mohamad Abdouni
Tremplin pour la jeune scène artistique contemporaine et partenaire de Paris+, la fondation Lafayette Anticipations récompense lors de chaque édition l’un des artistes présentés dans le secteur des galeries émergentes. Pour la deuxième édition de la foire, le choix de l’institution s’est porté sur Mohamad Abdouni et son projet exposé par la galerie Marfa’ Projects. Depuis quatre ans, le jeune Libanais a entamé un ambitieux travail d’archivage de témoignages des personnes queer et transgenres du monde arabe afin de transmettre leur vécu souvent invisibilisé.
À partir des 400 photos recueillies par l’artiste, ainsi que des souvenirs transmis oralement par celles et ceux qu’il a croisées sur sa route – récits, par exemple, de soirées cachées dans un club queer dans les années 80 –, Abdouni a utilisé l’intelligence artificielle pour générer des images plus vraies que nature qui composeront une mémoire fictive. L’artiste appuie d’ailleurs cette ambiguïté visuelle en présentant certaines de ces images sur des diapositives aux formats minuscules. Et comble ainsi les lacunes d’une histoire fatalement parcellaire.
Stand de la galerie Marfa Projects, C5.

8. Galerie Neu : l’art du détournement
Posés contre les cimaises du stand de la Galerie Neu, des sacs à main légèrement dorés intriguent : sont-ils des accessoires oubliés par les visiteurs ? Si ces cabas paraissent somme toute assez ordinaires, il s’agit en réalité de sculptures en acier dans lesquelles leur auteur, SoiL Thornton, a murmuré des “souhaits” avant de contenir son souffle dans l’emballage plastique scellé qui les entoure. Tel est un premier aperçu de la pratique conceptuelle du jeune plasticien new-yorkais, dont les œuvres aux portes de l’absurde explorent régulièrement les questions de genre, de politique et d’identité.
En atteste son autre sculpture, composition en bois plaquée contre le mur, dont chaque latte se voit ponctuée d’une étiquette qui rappelle le bétail – symbole de la violence liée aux catégorisations sociales. À leurs côtés, la galerie berlinoise présente d’autres œuvres jouant sur le détournement, à l’instar d’une sculpture lumineuse argentée réalisée par Klara Lidén à base d’un présentoir de carte de restaurant, ainsi qu’un miroir en forme de homard signé Cosima Von Bonin. On découvre également une peinture onirique de Jill Mulleady, invitation dans l’intimité d’une chambre rouge où se prélassent deux femmes nues sur des lits.
Stand de la galerie Neu, A1.

9. Karma : la peinture mélancolique
Du stand de la galerie Karma émane une certaine mélancolie qui se déploie de toile en toile. Dans les peintures de Gertrude Abercrombie (1909-1977), d’abord, petits formats encadrés en masonite où l’artiste américaine surréaliste dépeint des paysages nocturnes mystérieux et invraisemblables où se croisent au clair de lune porte et rocher, coquillage et draps tendus, ou bien apparaît une église dans un pré dépouillé.
Dans les toiles d’Andrew Cranston, ensuite, représentant dans des couleurs vives mais diluées des décors urbains et intérieurs souvent dépeuplés dans lesquels les rares personnages se fondent telles des présences spectrales. Tandis que les tableaux sombres de Reggie Burrows Hodges, où des cyclistes sillonnent les routes semblables à des ombres inquiétantes, parachèvent cette immersion dans des mondes aux portes du surnaturel.
Stand de la galerie Karma, E25.

10. Emalin : Karol Palczak, un autre visage de la Pologne
Habituée à présenter des installations, sculptures et vidéos, la pointue galerie londonienne Emalin est moins connue pour défendre la peinture figurative. Il est donc d’autant plus surprenant de découvrir sur son stand le travail d’un peintre rarement montré en France : Karol Palczak. Dans ses toiles exposées à Paris+, toutefois, toutes les scènes sont issues d’un film diffusé sur un écran vertical au centre.
Réalisée dans son village d’enfance au sud-est de la Pologne, près de la frontière ukrainienne, cette vidéo dépeint un environnement rural triste si ce n’est angoissant, assombri par la crise économique et la militarisation de la région. L’ami pompier filmé par l’artiste, seule personne du village à avoir aujourd’hui un emploi, incarne l’espoir d’une population exsangue encore très attachées à sa terre. Un contexte poétique que Karol Palczak décline ensuite à l’huile sur des toiles petits formats, où l’expression de la solitude dans le silence d’une nature enneigée rencontre des flammes dévorantes. Celles d’une hypothétique révolte ?
Stand de la galerie Emalin, C2.
Paris+ par Art Basel, du 19 au 22 octobre 2023 au Grand Palais Éphémère, Paris 7e.