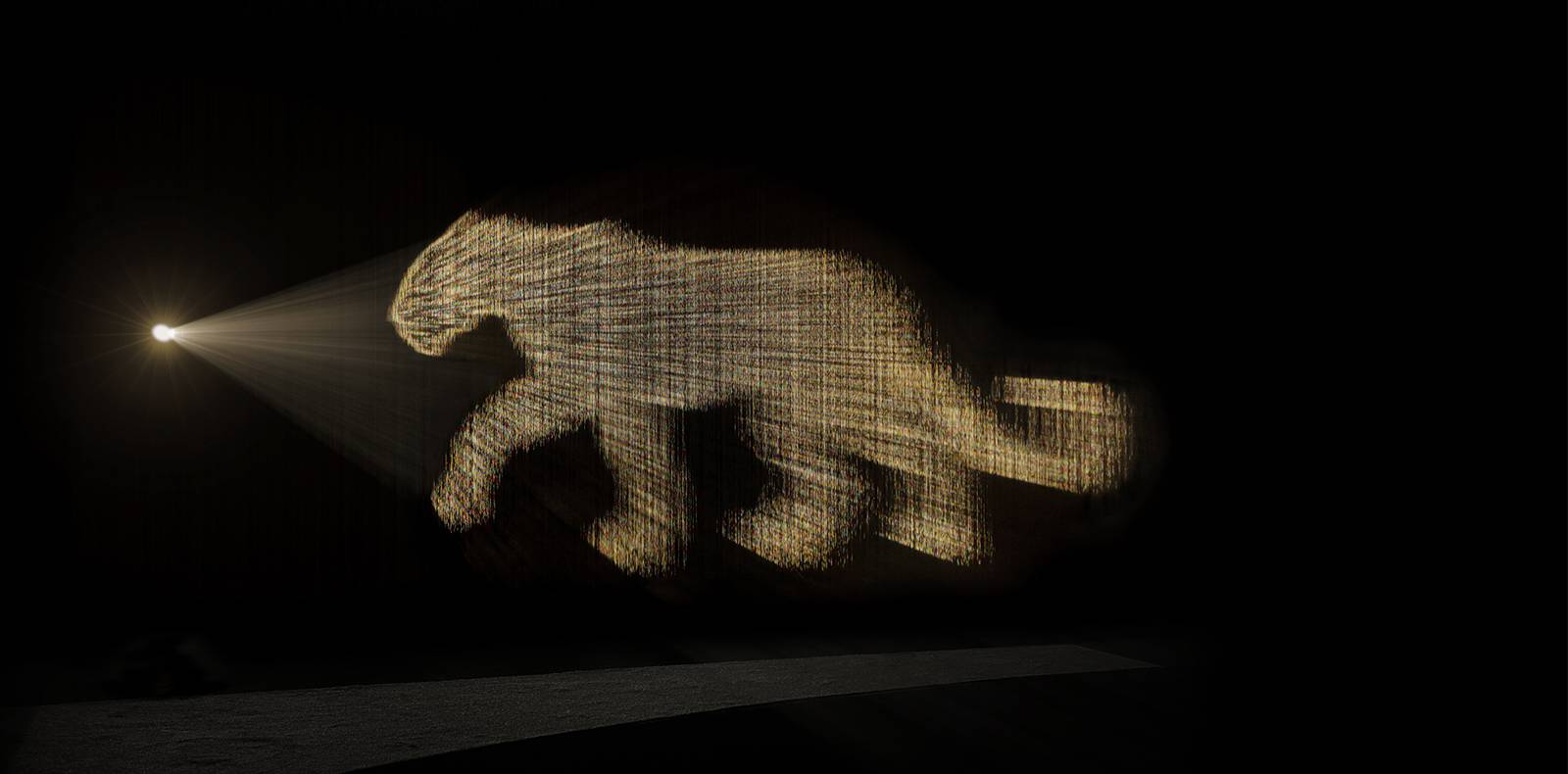26

26
John Currin : peinture classique pour toiles obscènes
Dans son œuvre maniériste, le grotesque se mêle intimement à la beauté. S’inspirant du style des grands maîtres flamands, John Currin a appliqué le même traitement des peaux, des lumières et des textures à des sujets aussi divers que des images pornographiques, des nus aux proportions étranges ou des portraits presque comiques. Pour Numéro Homme, l’artiste américain aujourd’hui célèbre évoque l’évolution de sa peinture, et celle de son processus de travail.
Propos recueillis par Hans Ulrich Obrist,
Portraits Jason Schmidt.

Numéro Homme : Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
John Currin : Actuellement, je travaille sur une série de toiles représentant ce que l’on pourrait décrire comme des Marie Madeleine heureuses. Elles semblent toutes plongées dans le bonheur. Donc, pour résumer, des figures religieuses, attablées, nues et souriantes. [Rires.] Pour l’instant, je m’occupe principalement de l’harmonie des tons.
Quel a été le déclencheur de cette série ? Une rencontre avec un tableau, une intuition soudaine, une épiphanie ?
J’avais peint ma femme, Rachel [l’artiste Rachel Feinstein], assise à une table, ainsi que quelques sujets derrière des sortes de plateformes. Pour être honnête, ce choix était aussi un prétexte à mettre en scène un personnage comme s’il s’agissait d’une nature morte, sur un élément plan, parce que je trouvais intéressante la façon dont cela structure le tableau en rectangles. Peut-être y a-t-il d’autres dimensions qui m’attirent dans la figure de Marie Madeleine, mais je ne les connais pas encore. Je découvre ce genre de choses au fur et à mesure que mon travail avance ; je ne les recherche pas avant de commencer à peindre.
“Très souvent – pour les visages par exemple –, j’ai recours à des sources publicitaires, parfois il m’arrive aussi de faire poser un modèle, puis je combine les deux…”
Quel rôle joue la notion de bonheur dans ce travail ?
Il me semble que, lorsque je représente le bonheur sur une toile, c’est aussi une forme de projection imaginaire, un moyen de combattre cette tendance chez moi à me sentir malheureux, déprimé. [Rires.]
Quand la vie apporte son lot de problèmes, je me rends compte que j’ai envie de faire exactement le contraire dans ma peinture.
Quelle est l’influence de votre épouse Rachel dans l’évolution de votre peinture ?
Disons que, lorsque vous tombez amoureux, vous vous ouvrez entièrement à l’autre… Et cet autre que vous aimez, vous le laissez vous soulager de la part malheureuse de votre être. J’essaie d’ailleurs de faire de même avec mes enfants – même si je n’y parviens pas toujours. En fin de compte, ce que je veux dire, c’est qu’en représentant le bonheur, j’ai sans doute l’espoir de faire advenir ce bonheur. Je n’ai jamais voulu changer le monde, mais moi, je veux me changer ! C’est un peu ma méthode Michael Jackson.
“Lorsque je représente le bonheur sur une toile, c’est aussi une forme de projection imaginaire, un moyen de combattre cette tendance chez moi à me sentir malheureux, déprimé. Quand la vie apporte son lot de problèmes, je me rends compte que j’ai envie de faire exactement le contraire dans ma peinture.”

Chez vous, tout commence-t-il toujours par un dessin ? Et si oui, comment se traduit-il ensuite dans une première toile ?
Lorsque nous avions évoqué cela il y a quelques années, j’étais très préoccupé par la médiocrité du dessin, la Mauvaise Peinture – avec un grand M et un grand P. Je crois que, pour moi, il s’agit surtout de m’accepter tel que je suis, avec mes défauts, et le dessin est parfois une sorte de métaphore de cette réalité-là. Je m’attache ensuite à rester fidèle à ma manière un peu bizarre de dessiner ou à une erreur pure et simple – puis à conserver cette fidélité dans la peinture. Cela veut dire que je fais un dessin plutôt rapide, je le mets sur la toile, et ensuite je dois épouser ce dessin, rester à ses côtés. À partir de là, j’ai beaucoup de réticence à apporter le moindre changement.
La photographie peut-elle jouer un rôle dans ce processus, ou pas du tout ?
Je ne prends des photos que si une scène ou une situation est vraiment compliquée et difficile à mettre en place. J’aime beaucoup utiliser des images que je trouve dans des publicités, ou bien la photographie commerciale. Ce sont en général des choses que je ne peux pas imiter ou reproduire moi-même. Donc, très souvent – pour les visages par exemple –, j’ai recours à des sources publicitaires, parfois il m’arrive aussi de faire poser un modèle, puis je combine les deux…
Vous travaillez souvent en réaction à votre précédente exposition pour combler une sorte de lacune. Est-ce encore le cas cette fois-ci ?
Dans le cas particulier de la série actuelle, il s’agit moins d’une réaction à mon dernier travail que le fait que mes deux parents soient décédés au cours des dix-huit derniers mois.
Je suis désolé.
Ça été un peu difficile… J’avais peint quelques toiles avant leur décès qui, je crois, parlaient déjà de la possibilité de leur disparition. J’ai exposé ces œuvres à Londres en 2016. Mon père est mort juste après. J’ai d’abord voulu continuer ce travail, mais, sur le plan émotionnel, son décès me rendait la chose impossible. J’étais dans une sorte d’impasse, alors j’ai choisi de faire une pause. Je n’arrivais pas à travailler. Puis ma mère est morte, et, d’une certaine façon, ça m’a libéré et permis de peindre ces toiles-ci, ces Marie Madeleine.
“Vous êtes bien supérieur quand vous faites semblant, lorsque vous n’avez rien à raconter, qu’au moment où vous croyez avoir quelque chose à dire.”
Vous avez déclaré qu’il vous arrivait de travailler sur une œuvre pendant des années : quand décidez-vous qu’une toile est finie ?
Aujourd’hui, je ne me laisse plus la possibilité de trop m’attarder sur un seul tableau. Cela limite le risque de travailler dessus pendant des années, et de peindre une seule toile là où j’aurais pu en peindre cinq – ce que je ne veux plus faire, même si cela n’a rien à voir avec un quelconque enjeu financier. Donc les toiles sur lesquelles je travaille, je les imagine finies, et je me résous aussi à les accepter avec leurs imperfections. Je dois donc admettre aussi l’éventualité que certaines seront mauvaises. Le travail est fini lorsque les contours me semblent bons, de même que les bordures, la température, les couleurs, quand je sens que tout est en place et qu’il y a assez d’ornementation. La question est de savoir quel supplément de complication, d’élaboration, de décoration aléatoire et de fantaisie capricieuse vous allez ajouter à une base – je l’espère – solide, ainsi qu’aux éléments très robustes qui sont au cœur de la toile. J’ai donc commencé ces dernières œuvres avec des dessins denses, des traits sombres. Ces lignes très épaisses, foncées, il est difficile de s’en départir ensuite, précisément pour cette raison. De cette façon, je m’engage sur une forme très basique, que je peux ensuite enrichir autant que je le souhaite.

Gerhard Richter considère que la peinture est une “forme supérieure d’espoir”. Que vous inspire cette définition ?
Pour ma part, j’aurais peut-être parlé d’une forme supérieure de désir ou de libido, mais “espoir”, c’est sans doute mieux. Cela convient davantage aussi au travail de Richter. Pour moi, il ne s’agirait pas de désir sexuel au sens littéral, mais la peinture canalise tout de même une forme de rage, des émotions quotidiennes comme celles que j’évoquais ici, pour les transformer en quelque chose de plus grand et de plus noble. Elle véhicule aussi l’excitation charnelle, le regret, la colère – peut-être la malhonnêteté aussi… Une malhonnêteté qu’elle transformerait en honnêteté. Cette beauté-là, c’est celle qui entre en jeu lorsque je réussis une toile.
Quel rapport entretenez-vous aujourd’hui avec le jeune artiste que vous avez été ?
Lorsque des événements nouveaux se présentent dans votre vie, des choses difficiles – quand vos enfants sont malades, ou se blessent (toutes ces choses qui n’étaient pas même concevables pour moi à l’époque) –, ça vous apporte une sorte d’intensité dramatique que vous n’aviez pas jusque-là. Il serait tentant de penser alors que cette intensité rend votre travail intéressant, mais c’est faux, ce n’est pas le cas. Vous êtes bien supérieur quand vous faites semblant, lorsque vous n’avez rien à raconter, qu’au moment où vous croyez avoir quelque chose à dire. Votre art est bien meilleur lorsque vous jouez un personnage que quand vous êtes véritablement ce personnage. Ma vie a sans doute gagné en intensité dramatique, mais j’essaie surtout de ne pas l’investir dans mon travail. Je pense que vous êtes plus fort quand vous êtes jeune, en partie parce que vous avez une forme de naïveté qui vous permet de comprendre que l’art est sa propre réalité, et non le reflet d’une réalité qui pourait être celle de votre existence.
Quelle importance revêt pour vous le fait de ne pas perdre sa capacité d’invention et d’illusion ?
J’aime les peintres qui font l’incroyable effort de s’éloigner d’une certaine forme de réalité. J’en suis venu à aimer les peintres rococo, et Poussin, pour cette raison. J’avais toujours détesté ce dernier, et puis un jour j’ai enfin pris conscience que toute cette artificialité de l’émotion des visages, cette fausseté étaient nécessaires pour que quelque chose d’énorme, de plus grand que la vie, se produise dans ses tableaux. Je les trouve incroyablement émouvants, dans leur ironie et leur nostalgie.
“La peinture canalise une forme de rage, des émotions quotidiennes pour les transformer en quelque chose de plus grand et de plus noble. Elle véhicule aussi l’excitation charnelle, le regret, la colère – peut-être la malhonnêteté aussi… Une malhonnêteté qu’elle transformerait en honnêteté. Cette beauté-là, c’est celle qui entre en jeu lorsque je réussis une toile.”

Dans quelle mesure le cinéma a-t-il influencé votre œuvre ?
La première chose qui m’a véritablement libéré dans mon travail, ça a été le cinéma de Fassbinder. En 1991, j’ai vu Les Larmes amères de Petra von Kant (1972), et tout de suite après, j’ai réalisé, je crois, de très bonnes toiles. Ce film a véritablement changé ma vie. Tout à coup, j’avais envie de peindre ces femmes, les femmes du film, leur allure, et de restituer l’effet de cette immense toile de Poussin derrière elles [une reproduction de Midas et Bacchus, en décor, sur tout un mur de la chambre]. Je voulais reproduire la structure dans sa totalité, représenter cet imaginaire. Après ça, j’ai vu Le Marchand des quatre-saisons, qui m’a aussi beaucoup marqué. En dehors de ces œuvres de Fassbinder, il s’agira surtout de films plus anciens.Noblesse oblige [de Robert Hamer, 1949] a été un film capital pour moi, mais aussi La Dame de Shanghai(1948) d’Orson Welles – où les hommes sont absolument grotesques, et les femmes follement belles. Tout cela, j’en suis sûr, s’est très largement invité dans ma peinture.
“Je ne suis pas chrétien, mais je crois que j’aimerais bien m’atteler à un tableau de ce genre. J’imagine que pour peindre une image pieuse, il faudrait d’abord que je devienne croyant moi-même !”

Dans un entretien, vous évoquiez un rêve que vous avez fait : vous vous trouviez dans une pièce, au milieu de personnages grotesques, en train de forniquer, et vous aviez la vague sensation que vos enfants assistaient à la scène. Pouvez-vous nous parler de vos rêves les plus récents ?
Aujourd’hui, mes rêves parlent surtout de mes inquiétudes par rapport à mes enfants, ou à l’amour – suis-je aimé ? Par conséquent, ce sont des choses que je n’aborde que très indirectement dans mon travail. Mais puisque vous évoquez ce rêve vaguement pornographique dont j’avais parlé, je me souviens qu’il comportait un élément très troublant : une sorte de madone furieusement kitsch qui flottait dans une bulle comme la Gentille Sorcière du Sud dans Le Magicien d’Oz. Il y a peut être un rapport avec les toiles que je réalise en ce moment, un même lien avec l’imagerie religieuse. Je ne suis pas chrétien, mais je crois que j’aimerais bien m’atteler à un tableau de ce genre. J’imagine que pour peindre une image pieuse, il faudrait d’abord que je devienne croyant moi-même ! Un peu déroutant, mais je crois que ça m’attire. En tout cas, mes rêves n’ont pas beaucoup servi ma peinture ces derniers temps. Ils sont plutôt des sortes de prémonitions, et j’en viens à les détester pour cette raison.
Avez-vous déjà envisagé de peindre des fresques comme celles de la chapelle de Rothko, par exemple, ou simplement de peindre sur un mur ?
Je me souviens d’avoir vu ce type de choses chez Jay Jopling [marchand d’art et galeriste] – vous les avez probablement vues, vous aussi. Dans sa demeure de style géorgien, les papillons de Damien Hirst revêtaient tous les murs de la salle à manger. J’avais trouvé ça vraiment merveilleux. Je me rappelle aussi, chez quelqu’un d’autre, une pièce dont les murs étaient entièrement couverts de Richter – c’était très beau également. Pour ma part, je dois dire que l’idée m’a déjà effleuré. J’avais envisagé de réaliser des toiles très étroites et hautes qui auraient pu trouver leur place entre deux fenêtres, dans un appartement ou un hôtel particulier new-yorkais. Je voyais cela dans un esprit plutôt décoratif, un peu comme les Fragonard de la Frick Collection. Mais s’il fallait concevoir un grand projet “architectural”, je ne crois pas que ma peinture conviendrait.
Gagosian Genève présente une exposition de peintures et travaux sur papier de John Currin, réalisés entre 1989 et 2014. Jusqu’au 12 avril.