
25

25
La mode : tabou ou atout pour les artistes contemporains ?
Si les artistes cherchent, par essence, à capter le regard du public, quel rapport entretiennent-ils avec l’image qu’ils renvoient à travers leur allure même, leur apparence personnelle ? Scrutés en permanence par une société toujours plus avide de contenus visuels, courtisés par le monde la mode, comment maîtrisent-ils cet enjeu symbolique du vêtement ? Enquête.
Par Alice Pfeiffer ,
Illustrations par Ilias Walchshofer .
Publié le 25 juillet 2025. Modifié le 5 septembre 2025.

L’enjeu du vêtement dans l’art contemporain
En 2024, le label de prêt-à-porter Études Studio dédiait une collection aux vestiaires d’artistes, citant Jean-Michel Basquiat – à qui il avait déjà dédié des capsules – et Andy Warhol. La maison Balenciaga présentait quant à elle un vestiaire très artist-coded, dans lequel Camille Henrot voit une référence directe au studio : “Les vêtements usés, abîmés, sales rappellent le quotidien des artistes – le noir, le blouson en cuir oversized, le sweat à capuche, les Crocs qui sont les chaussures d’atelier sur lesquelles la peinture ne reste pas.” Mais pour l’artiste française partageant sa vie entre Paris et New York, l’enjeu du vêtement et de l’apparence se situe en dehors du studio. Il s’impose, tout au long de sa carrière, comme un intermédiaire essentiel entre elle et la sociabilité de son milieu.
“Une image, c’est fixe, c’est dupliqué, c’est mis en rapport de son travail…” – Camille Henrot.
Elle commence à collaborer avec la styliste Laëtitia Gimenez autour de tenues qui agissent tel “un bouclier pour pallier [son] anxiété sociale, une façon de détourner l’attention”, et qui lui permettent de prendre la main sur la visibilité induite par son travail : “Une image, c’est fixe, c’est dupliqué, c’est mis en rapport de son travail… Pour être soi en photo, il faut construire cette image de soi.”
La tenue portée est aussi parfois l’amorce d’une conversation, qui en dit long sur les mutations du milieu : “J’ai rencontré une collectionneuse qui est devenue amie, et le point de départ était une discussion sur nos tenues Courrèges. Classiquement, la relation au vêtement a été modelée par l’homme cisgenre, mais l’arrivée de femmes et de minorités de genre et raciales à des postes de pouvoir, ces dernières années, a fait bouger ces standards. Si les directeurs de musée constituent l’aristocratie du milieu, alors, ce qu’ils portent et le rapport aux vêtements aussi changent”, ajoute Camille Henrot notant que la stigmatisation des minorités sur les critères de soin et d’apparence semble moins forte qu’auparavant.

Jeu de rôle et évènements mondains
Si l’image personnelle se construit, les interactions sociales, quant à elles, sont codifiées et normatives au point de devenir parfois pesantes. À la commissaire Martha Kirszenbaum de raconter qu’elle voit des artistes appréhender ou fuir les événements mondains en raison du manque de naturel de ces situations : “Je pense, par exemple, à l’inauguration d’Art Basel, qui ne met pas forcément les artistes à l’aise, car ces derniers doivent alors performer, parler de leur travail avec une foule de collectionneurs ou de curateurs. Et j’ai l’impression qu’ils sont plus à l’aise dans l’intimité ou en petit comité.”
Mais ce jeu de rôle peut également s’apprendre et devenir une arme dont on peut jouer : “Je pense qu’il est bien vu que l’artiste soit à la fois présent et un peu absent – soit iel arrive en retard, soit iel se cache au fond de la cour pour fumer une cigarette… dosant un savant équilibre entre mise en lumière et timidité” ou, dans d’autres cas, “qu’il se déplace avec tout son crew, sa communauté artistique, ami·es, amant·es, allié·es”. C’est entre distance et proximité, montrer et cacher, que se joue cette présence – un jeu d’“extimité” (la mise en scène de son intimité), qui est demandée dans l’incarnation du mythe de l’artiste et la lecture induite de son travail.

La mode, une notion enclavante ?
Pourtant, la continuité entre image de l’artiste et son œuvre peut être “enclavante”, particulièrement pour des artistes minorés. Alors qu’il y a des volontés – sincères, mais aussi alignées sur des débats d’époque et des publics visés – de diversifier le contenu d’institutions, le poids peut être le sentiment d’avoir à “bien” performer sa minorité. L’artiste Cécile B. Evans s’interroge pour sa part sur l’attention portée à l’inclusivité qu’iel juge à double tranchant : “Je suis un·e artiste queer non binaire trans, mais je suis lu·e comme une personne hétéronormée, et je ressens souvent le fait de ne pas rentrer dans le moule performatif de ce qu’on attend de mon identité, alors qu’elle n’apparaît nulle part dans mon travail.”
“Je ressens souvent le fait de ne pas rentrer dans le moule performatif de ce qu’on attend de mon identité” – Cécile B. Evans
Le monde de l’art irait-il alors vers une forme de “normativité queer”, d’un milieu qui soutient et dicte simultanément ? “Aujourd’hui, ‘queer’ est devenu une catégorie ; or le travail des personnes concernées ne traite pas forcément de ça. La catégorisation se fait donc autour de la personne et non du contenu. Tout est affaire de visibilité, mais le propos était initialement juste de donner accès à des personnes minorées et non faire des shows sur le thème de l’identité”, ajoute Cécile B. Evans.
Cette attitude limite aussi la notion même de queer, voire en fait un exotisme et un exutoire : “En tant que personne queer, je sens bien qu’on peut utiliser mon image pour faire valoir une certaine ‘ouverture d’esprit’. C’est OK, plus je représente la communauté, mieux c’est ! De la même manière que je le fais dans mon travail sur l’abstraction queer, je veux mettre en avant une autre facette de la queerness, plus secrète, plus introvertie, peut-être plus sombre aussi. Je pense que c’est important pour les personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans l’exubérance ou l’hypersexualisation du milieu artistique queer”, renchérit l’artiste Lux Miranda.

“On demande désormais à l’artiste d’être influenceur, CEO de sa propre identité” – Neïl Beloufa.
L’idée de performance de toute identité repose sur la répétition de gestes stylisés, codifiés et identifiables – rituel qui active en retour la croyance d’une essence ou authenticité. Paradoxe de la performance du naturel, l’artiste se doit donc de se montrer authentique… selon les attentes de son industrie. “Je m’en suis longtemps sorti en faisant timide et crade ; c’était romantisé, grunge, je jouais ce jeu plus ou moins consciemment”, se souvient Neïl Beloufa qui voit les attentes et même le mythe de l’artiste évoluer au gré des mutations économiques.
“Avec le Covid, il y a eu une accélération de ouf, on demande désormais à l’artiste d’être influenceur, CEO de sa propre identité, le détenteur de la legacy du 21e siècle. Donald Trump est devenu président en adoptant les stratégies de communication d’Andy Warhol, Elon Musk reprend les stratégies des artistes conceptuels : ’j’ai une idée, cela a de la valeur.’ C’est le chaman-showman de Joseph Beuys”, analyse-t-il, ajoutant que le système actuel est en dissonance avec les valeurs de l’artiste.
“Alors que les trois quarts des gens de ce milieu ont un affect lié à la gauche, on fonctionne sur l’un des systèmes de valeur ajoutée les plus centralisés, et hyper individualiste… Le cynisme de l’artiste, c’est de faire comme s’il ne savait pas que c’était de la politique.” Aujourd’hui, estime-t-il, “la chose la plus subversive que je peux dire, c’est : ‘Je travaille pour qui me paye.’ Avant, il y avait cette idée que l’artiste ne devait pas faire de compromis avec le marché. Peu d’industries se permettent de véhiculer cette idée, c’est extrêmement aristocratique”, note Neïl Beloufa.

Un art world gaze omniprésent
Chaque artiste est ainsi soumis à un art world gaze omniprésent, que chacun affronte et négocie à sa manière. “J’adorerais porter des bijoux, mais je me sentirais ridicule dans le monde de l’art, c’est une sorte de no-go zone, c’est considéré trop flashy. Un jour, je sortirai peut-être de mon placard ‘bijou’”, plaisante l’artiste Francesco Vezzoli, qui a senti tôt que son intérêt pour les vêtements et la préciosité pouvait agir contre lui. “Quand je suis devenu artiste, j’ai pris conscience que j’avais une profonde fascination pour la mode qui n’était pas la bienvenue. C’était il y a vingt-cinq ans, et je me souviens d’élèves, au Central Saint Martins, qui se moquaient de moi, trouvant que je m’habillais comme un bourgeois italien.”
Pourtant, l’artiste, travaillant avec son apparence, “l’intègre au propos, et alors, c’est un acte conceptuel”, souligne ce proche de Miuccia Prada, qui a collaboré avec la maison – mais aussi avec les Archives Valentino – et n’hésite pas à se mettre en scène dans des projets pastichant les codes de la mode et du glamour. Dès lors, il semblerait que, face au regard externe et à la fatalité d’être perçu, lu et catalogué, le glissement pourrait être la clé : “J’ai déjà observé un artiste – que je ne nommerai pas – se ‘surlooker’ pour un vernissage dans une institution importante, si bien qu’on avait l’impression qu’il était déguisé. C’était d’autant plus gênant que son travail est très radical et politique, et que cela créait ainsi un troublant décalage entre, d’un côté, le message véhiculé par ses œuvres et, de l’autre, son allure”, se souvient Martha Kirszenbaum – une fuite du monde des apparences… par l’apparence.











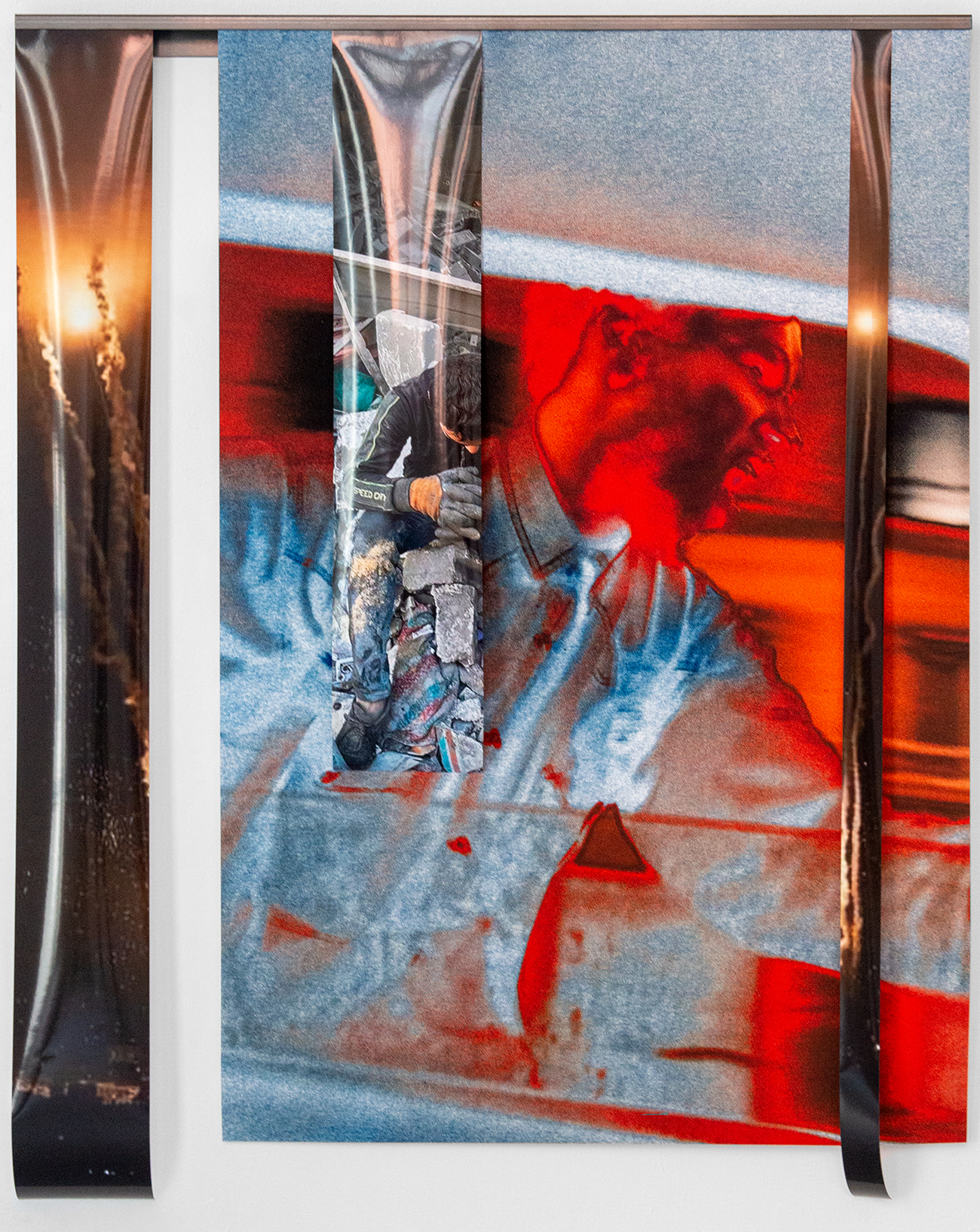
![Amigo de El Friki y pared rosa (série Bravo) [2021-2024]. © Courtesy of Felipe Romero Beltrán, Hatch Gallery & Klemm’s Berlin.](https://numero.com/wp-content/uploads/2025/11/thumb-felipe-romero-beltran-numero-art.jpg)

