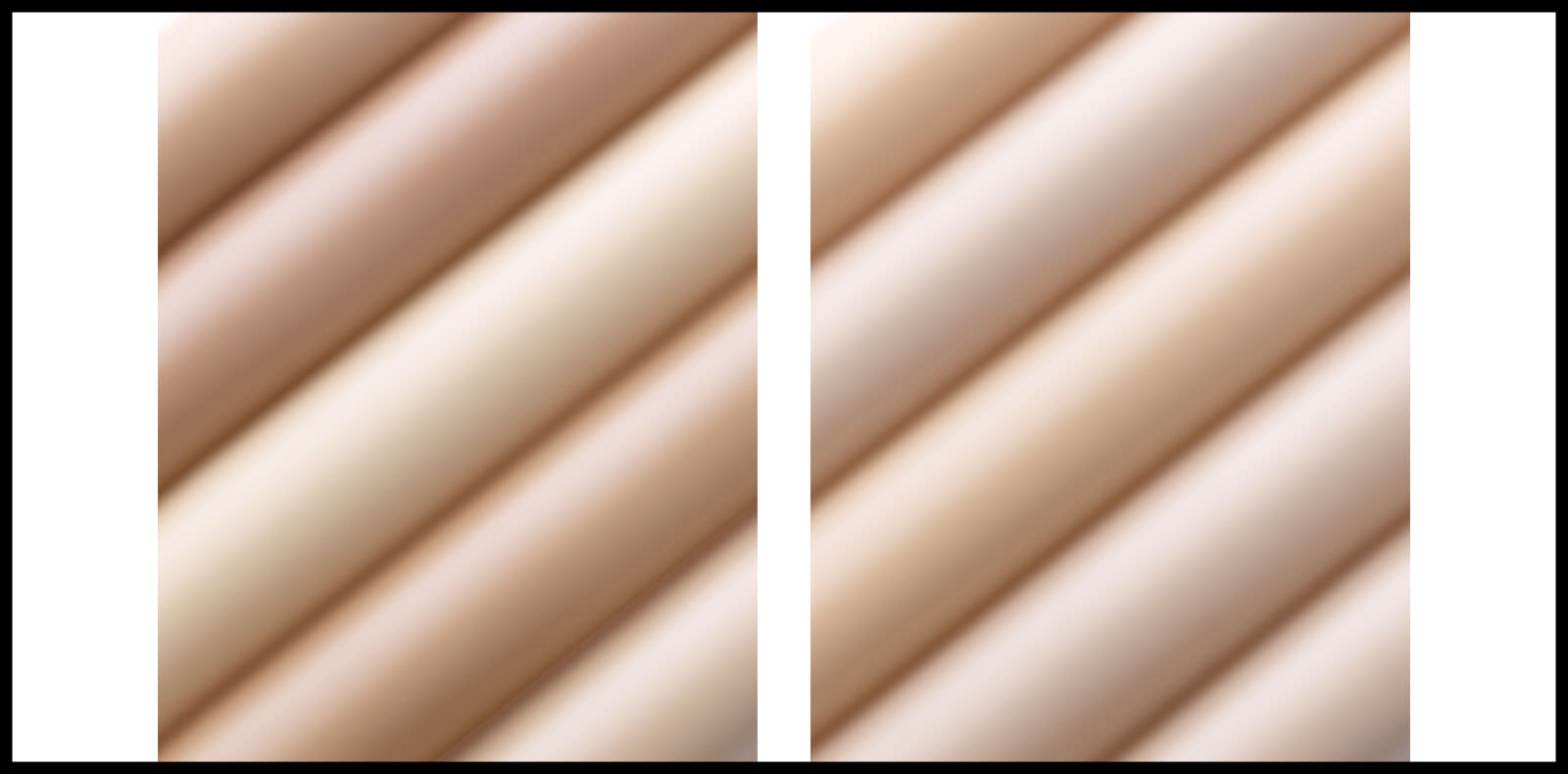22

22
Mimosa Echard à la Galerie Chantal Crousel : tableaux vivants et cœurs en fusion
La trentenaire lauréate du prix Marcel-Duchamp en 2022 présente une exposition à Paris intitulée “Lies”, jusqu’au 16 novembre 2024 à la Galerie Chantal Crousel. Un mot qui reflète son travail mêlant sculpture, photographie, installation, qui aime jouer sur les doubles sens et évoque la futilité du langage face aux œuvres d’art.
Propos recueillis par Nicolas Trembley.

Mimosa Echard, révélation du prix Marchel-Duchamp en 2022
Un large public avait fait la découverte de Mimosa Echard lorsqu’elle avait remporté le prix Marcel-Duchamp au Centre Pompidou en 2022. Élevée dans les Cévennes, elle porte un prénom prédestiné pour une artiste qui met au centre de son travail… les plantes, et qui cultive un jardin devant son atelier. Le végétal sert aux teintures des tissus qui lui permettent de fabriquer ses œuvres, appelons-les “peintures”, qui en réalité s’apparentent davantage à des collages, des reliefs dans lesquels on retrouve aussi bien des objets que de la photographie. Ces peintures rappellent peut-être des fonds marins et leur cohorte de coraux, ou au contraire de nouvelles textures de reliefs futuristes et artificiels.
Pour Mimosa Echard, les plantes ne sont pas simplement un médium qui sert à “faire”, non, ce médium sert à penser et à élaborer une réflexion sur les différences, les tensions entre l’organique et le synthétique. Comme par exemple ces tissus artificiels qui ne laissent pas passer les ondes et qu’elle utilise dans ses tableaux, ou encore ces cœurs en métal suspendus, présentés dans son exposition personnelle à la Galerie Chantal Crousel pendant Art Basel Paris. Lies, “mensonges”, c’est le titre qu’elle a voulu donner à son exposition et elle nous explique pourquoi.

Rencontre avec l’artiste Mimosa Echard, exposée à la galerie Chantal Crousel
Numéro : Quel est votre parcours ?
Mimosa Echard : Je suis née à Alès dans les Cévennes. J’ai grandi dans un hameau a la frontière du Gard, de l’Ardèche et de la Lozère. Plus tard, je suis allée au lycée dans les quartiers nord de Marseille et je suis montée à Paris pour faire l’École des arts décoratifs, dans le département “art-espace”. J’ai toujours gardé un lien fort avec les Cévennes, j’y fais des choses, j’y filme, j’y prends des photos. C’est aux antipodes de ma pratique dans les grandes mégapoles comme New York ou Paris.
Comment avez-vous compris que vous vouliez devenir artiste ?
Adolescente, j’ai découvert, dans des livres de la bibliothèque de Saint-Antoine, à Marseille, des artistes qui utilisaient leur corps, et ensuite cela m’a obsédée. Le travail de Michel Journiac, de Gina Pane, de Paul McCarthy ou d’Ana Mendieta…
Vous puisez vos inspirations principalement dans la nature, l’écologie, l’organique. Quel rapport vos œuvres entretiennent-elles avec l’environnement?
C’est vrai que je m’inspire souvent des organismes vivants, les plantes en particulier. C’est ce que je connais le mieux, c’est là où je me sens nerdy [absorbée dans son monde]. À vrai dire, pour moi, ce sont moins des sources d’inspiration que des sources de questionnement. Qu’est-ce que la nature ? Qu’est-ce qui différencie vraiment l’organique du synthétique ? Par exemple, en ce moment, je prends beaucoup de photos aux arcades des Champs-Elysées [galerie marchande], qui ont été construites dans les années 20.
Cela ressemble à un bateau échoué avec ses marchandises de seconde zone, un non-lieu, un portail vers le vieux monde morne. Dans mes recherches, je suis tombée sur cette idée de Walter Benjamin selon laquelle la mode “accouple le corps vivant au monde inorganique. Vis-à-vis du vivant, elle défend les droits du cadavre”. Avant de lire ces phrases, je n’avais jamais réfléchi au rapport entre la mode, les cadavres et l’organique.

Courtesy de l’artiste et Galerie Chantal Crousel, Paris. © Mimosa Echard / ADAGP, Paris, 2024
Photo: Aurélien Mole.
Vous avez différentes pratiques, peinture, vidéo, sculpture, collage, etc. Comment naviguez-vous entre elles ? Une pratique est-elle plus importante qu’une autre ?
Finalement, dans mon travail, la pratique la plus récurrente et la plus importante est la photographie. Je possède un appareil photo depuis mes 10 ans et je photographie en permanence. Ce médium se situe en quelque sorte dans un interstice entre les autres, dans une zone grise où on ne peut pas vraiment dire ce que c’est. Depuis un peu plus d’un an, j’ai entamé une série dans laquelle je recouvre des toiles de tissu anti-ondes – un matériau utilisé pour bloquer les ondes électromagnétiques – et de feuilles d’aluminium. Ils sont à la fois image et objet, bouclier et espace virtuel. Cette ambiguité m’excite beaucoup.
“Mon atelier donne aussi sur un jardin, dans lequel je passe beaucoup de temps.”
Mimosa Echard
Quelle est l’importance de l’atelier pour vous ? Avez-vous une routine? Comment organisez-vous votre travail ?
Je suis très nulle pour tout ce qui est routine et je n’ai pas une grande discipline. Ça ne m’intéresse pas vraiment. Mais je vais quasiment tous les jours à l’atelier. Parfois, pour ne rien y faire. Le simple fait de bouger des choses, de ranger mes collections d’images ou des objets peut créer de nouvelles correspondances, qui sont ensuite importantes dans les processus liés à de nouveaux projets. Mon atelier donne aussi sur un jardin, dans lequel je passe beaucoup de temps.
Vous présentez une nouvelle exposition personnelle à la Galerie Chantal Crousel, à Paris. En quoi consiste ce projet ?
L’exposition est une rencontre entre deux séries d’œuvres : les tableaux que j’ai décrits plus haut, composés, entre autres, de tissu anti-ondes et de feuilles d’aluminium, et des photographies prises dans ces arcades aux Champs-Élysées. Tout y est mangé par un acide invisible. Il y a une vague ambiance des années 20. Je présente également de nouvelles sculptures-colliers.
Pourquoi ce titre, Lies ?
J’ai choisi ce titre – qui signifie “mensonges” en anglais – pour son côté théâtral et pour, en quelque sorte, faire surgir un barrage. Mais le mot est également très vulnérable. C’est cette tension qui m’intéressait. Je trouve aussi que le titre parle de la futilité du langage face à des œuvres d’art qui résistent, qui échappent aux catégories de la pensée. Il y a aussi un jeu esthétique autour du double, de l’artifice et de la construction matérielle et historique des images photographiques dans l’exposition. Et c’est aussi un mot qui a plusieurs sens, comme “s’allonger”. J’aime l’état d’inertie que cela implique. En français, le mot “lie” véhicule l’idée de dépôt et de rebut. Cela décrit bien l’ambiance désuète des arcades commerciales des Champs-Élysées.

Comment savez-vous qu’une œuvre est terminée ?
Ça peut paraître assez romantique, mais je dirais qu’une œuvre est terminée quand elle le décide. Disons que c’est une décision que je ne prends pas seule. C’est très complexe comme processus, parce qu’il y a aussi des œuvres qui, en quelque sorte, refusent, qui deviennent des séries… J’aime l’idée que les œuvres deviennent d’autres œuvres, qu’il y a une sorte de continuité et de logique souterraine qui m’échappent.
Vous donnez des titres très particuliers à vos œuvres. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Souvent, je m’inspire d’un détail faisant partie d’une œuvre, ou de mots pris sur un emballage, par exemple. Le titre de mon installation Escape More renvoie à une phrase que j’ai tirée d’une publicité d’American Express sortie en 1994. On y voit une cascade qui ressemble à de l’urine. Elle date de la même année que la fameuse collection Golden Shower d’Alexander McQueen, financée par American Express.
J’imaginais déjà l’installation comme un espace clos, mais aussi comme une machine à pisse. Donc, ça m’intéressait de faire résonner ces mots publicitaires différemment. J’aime bien l’idée que le titre peut fonctionner comme un portail qui ouvre sur plusieurs possibilités d’interprétation, comme les tableaux Mostly Cloudy, ou la série Private Picture. La musicalité est importante aussi. J’aime bien les titres qui ressemblent à ceux des chansons.

Comment installez-vous vos pièces dans un espace de présentation ? Quelle est l’importance de la disposition et de l’architecture dans vos expositions ?
Je suis très sensible à l’espace et j’essaie toujours de le faire entrer en dialogue d’une manière ou d’une autre avec mon travail. Je cherche souvent une forme de frontalité. Je fais de la sculpture, mais je vois très plat. C’est pour cette raison que je n’ai pas mon permis de conduire et que les vitrines m’inspirent beaucoup. Je trouve que c’est ça qui est très fort chez Joseph Cornell, la manière dont il détourne le langage capitaliste des vitrines en espace ambigu et énigmatique. L’espace des rêves. Ça m’inspire beaucoup.
Dans quelle histoire aimeriez-vous inscrire votre travail ?
Je ne me pose vraiment pas cette question. De toute façon, je ne crois pas que l’on puisse décider ce genre de choses. L’idée d’inscription dans l’histoire est pour moi l’anti-désir total, ou la mort.
Vous placez-vous dans une communauté artistique ou un mouvement ?
Je vis et je travaille avec beaucoup de personnes: mes amis, mes étudiants, ma famille, etc. Mais l’idée de me situer ne me correspond pas. Et je ne sais pas si on peut réellement parler de “mouvements” aujourd’hui, d’un point de vue contemporain. Je citerais donc l’épitaphe de Guillaume Dustan, “J’ai toujours été pour tout être”.
“Mimosa Echard. Lies”, exposition jusqu’au 16 novembre 2024 à la Galerie Chantal Crousel, 10 rue Charlot, Paris 3e.