
16

16
Comment l’artiste Lili Reynaud-Dewar prend d’assaut le Palais de Tokyo
Artiste essentielle et rebelle de la scène française, Lili Reynaud-Dewar déjoue avec un humour incisif toutes les assignations, les dominations et les hiérarchisations. Performeuse, plasticienne, vidéaste et professeure, elle se confronte sans fard à la réalité pour l’exprimer avec puissance et sincérité tout en inventant de nouvelles sociabilités. Au Palais de Tokyo, cet automne, elle questionne notamment la fonction de l’artiste et la valeur de sa production. Voyage explosif au cœur de l’institution, en sa compagnie.
Par Lou Ferrand.
Publié le 16 octobre 2023. Modifié le 20 novembre 2024.

Lili Reynaud-Dewar, une artiste éclectique exposée au Palais de Tokyo
Parfois, quand je pense au travail de Lili Reynaud-Dewar, me vient en tête l’image de l’Encyclopédie – sans qu’il en ait pourtant ni l’exhaustivité ni la rigueur académique. Mais il me semble que c’est un travail qui déborde de mots, de voix, d’idées; par son intérêt pour la littérature, par le fait que l’écriture fasse à ce point partie de sa pratique artistique, par toutes les figures tutélaires qu’elle convoque et se réapproprie – Guillaume Dustan, Sun Ra, Joséphine Baker, Kathy Acker, Jean Genet ou, bien sûr, Pier Paolo Pasolini. Par son travail d’enseignante à la Haute École d’art et de design (HEAD) de Genève aussi : Lili Reynaud-Dewar a donné pendant plus de dix ans un séminaire mouvant appelé : “Enseigner comme des adolescent·x·es”, qui avait lieu dans sa chambre d’hôtel, et qui consistait à lire ensemble, parler ensemble, arpenter, interpréter, mettre en commun, peut-être même se quereller.
Lorsqu’elle m’a montré ce qui composerait son exposition personnelle présentée au Palais de Tokyo cet automne – “Salut, je m’appelle Lili et nous sommes plusieurs” –, elle m’a dit que personne n’aurait sûrement l’occasion de tout voir, de tout entendre, de tout appréhender. L’exposition, qui approfondit les thèmes présents depuis longtemps dans le travail de l’artiste – la domination, la subversion, l’entremêlement de l’intime et du politique, la pédagogie, la transformation des villes et des vies affectées par la modernité –, propose une quarantaine de films, multiplie les registres de langage et les énonciations, dilate le temps et pose surtout la question : peut-on tout dire, et comment le dit-on?

Une pluralité de regards sur la masculinité
Dans ce cadre, l’artiste a proposé à douze personnes s’identifiant comme hommes, ayant comme seul point commun le fait de faire partie de son entourage proche, de raconter leur vie à travers les prismes de la masculinité et de la propriété privée. Dans chacun de ces entretiens filmés, se déroulant là aussi dans des chambres d’hôtel cette fois tamisées de lumière rose, rouge ou orange, Lili Reynaud-Dewar a coupé ses questions au montage et n’apparaît jamais, comme si les interviewés monologuaient.
La méthode filmique et conversationnelle mise en place empêche une parole trop structurée et policée, se joue du début et de la fin convenue des narrations, s’“invertèbre” et s’oblique – les digressions, les manques ou les trop-pleins de la parole venant ainsi contrecarrer le discours parfois trop normé de la masculinité.
Racontant des histoires et des trajectoires très différentes, bien que toutes chargées – évoquant par exemple le sida, la transition de genre, la dépendance, les communautés choisies, le sexe et le travail du sexe, les discriminations… –, les interviewés laissent transparaître les échos des événements et des crises sociopolitiques qui se jouent en hors champ. Ces douze entretiens permettent d’établir ensemble l’échantillon ou le portrait d’un temps et d’un espace rendus communs par les narrations de celleux qui le peuplent.


Alors où est Lili ? Ainsi réunis, peut-être ces entretiens esquissent-ils également un portrait en creux de l’artiste, à partir de celleux qui l’entourent, de celleux à qui elle se lie – comme lorsqu’elle écrit que “je suis Lili et nous sommes plusieurs”, le “je” entretenant une relation toujours étroite et ambiguë avec le “nous”. Ils racontent quelque chose des relations, des affects et de la confiance qui règnent entre deux personnes pour que la parole advienne, de comment prendre soin de la confession recueillie, de ce qu’on coupe au montage ou de ce qu’on laisse dire et résonner en public.
Dans une œuvre de 1994, l’artiste Lutz Bacher interviewait elle aussi tout son entourage, en posant à chacun·e de ses proches la question : “Do you love me?1 ” (“Est-ce que tu m’aimes?”) Même si Lili Reynaud-Dewar ne demande pas aux interviewés s’ils l’aiment, peut-être est-il là aussi question d’amour. Les vidéos sont à visionner dans des lits construits pour l’occasion, les chambres d’hôtel dans lesquelles elles ont été tournées ayant été reproduites à l’identique, faisant déborder le décor dans le réel. Ce faisant, l’artiste déjoue quelque chose de la lente disparition des petits hôtels parisiens et familiaux à l’aune du mouvement qui fait basculer les villes et l’industrie touristique par le processus, parfois furieux, de gentrification.

Une artiste passionnée par les mots, lauréate du Prix Marcel-Duchamp
Lors d’une précédente conversation, nous avions évoqué la notion de “gossip”, déjà en jeu dans l’installation qui lui a fait remporter le Prix Marcel-Duchamp2, dans laquelle étaient présentés des entretiens biographiques écrits avec les vingt-quatre comédien·nes qui rejouaient chacun·e les moments précédant l’assassinat de Pasolini et menant vers le drame. Ils évoquaient des histoires d’amour, de conflit, ou encore les conditions de travail s’exerçant dans l’art, sujets normalement échangés dans les fêtes, les cafés ou pourquoi pas les chambres d’hôtel, à l’abri des oreilles institutionnelles.
Nous avions alors parlé des recherches de Ramaya Tegegne – artiste, organisatrice culturelle et proche collaboratrice de Lili Reynaud-Dewar – sur cette notion de “gossip” et l’importance de l’histoire orale, de la “rumeur” et du “ragot” comme véhicules politiques qui permettent d’ancrer l’anecdote au sein d’engrenages systémiques plus grands. Certain·es artistes l’ont intégrée comme matériau créatif et discursif; Dodie Bellamy, l’une des autrices les plus célèbres du mouvement littéraire expérimental New Narrative né à San Francisco à la fin des années 70, écrivait par exemple en 2006 que “les potins, comme outils de travail des subjectivités privées de leurs droits, sont productifs3.”


Le journal intime de Lili Reynaud-Dewar
Dans son ouvrage Video Green (2004), l’autrice Chris Kraus, elle aussi proche de New Narrative, raconte qu’elle enseignait à Los Angeles un cours de création littéraire sur la rédaction de journaux intimes, forme littéraire exacerbée du “gossip”. Elle remarque que c’est une pratique dévaluée, ou trop tempétueuse ou trop banale, qui ne permettrait pas de proposer une écriture fixée, réflexive et prestigieuse. Par conséquent, son cours attire principalement de jeunes artistes ayant renoncé à briller dans l’institution, et qui semblent pourtant être les personnes les plus conscientes de ses paradoxes et de ses failles.
Lili Reynaud-Dewar a tenu pendant ces deux dernières années un journal, difficilement qualifiable d’“intime” car exposé au grand jour sur les murs de l’exposition dont il relate, entre autres événements, la préparation. Elle prolonge une généalogie d’artistes “diaristes” – Adrian Piper, Derek Jarman, Lee Lozano… – qui, tout en embrassant des formes très diverses, se posent des questions similaires au moment de leur écriture, et surtout de leur publication : comment amplifier ce qui est habituellement chuchoté ? Quelle considération porter aux personnes citées ? Qu’est-ce qu’on dit et qu’est-ce qu’on tait ?


Danser dans l’espace d’exposition
Inventant un autre langage fait de gestes plutôt que de verbes, Lili Reynaud-Dewar danse dans le Palais de Tokyo vide4, ondulant face aux œuvres de ses contemporain·es, explorant les espaces que d’ordinaire on ne voit pas, entre nonchalance, grâce et vulnérabilité d’un corps qui contourne les manières habituelles de se mouvoir dans l’institution. Un autre volet de l’exposition, en accès libre, permet de consulter tous les épisodes de la série Gruppo Petrolio, forme d’arpentage collectif et filmé du tentaculaire ouvrage posthume Pétrole de Pasolini, lui aussi comparable à quelque chose de l’Encyclopédie.
Œuvre collaborative de Lili Reynaud-Dewar et de ses étudiant·es, la série évoque les grandes thématiques du livre de Pasolini : l’industrie pétrolière, les conflits sociopolitiques, mais aussi – comme dans les entretiens présentés – la masculinité et la propriété, ou encore – comme dans le journal exposé –, la création en train de se faire et les subterfuges possibles pour évoquer ou crypter ce que d’autres auraient préféré garder secret. Qu’elle danse en silence, qu’elle parle à travers de grandes figures ou des livres qu’elle se réapproprie, qu’elle tende le micro aux autres, son œuvre déborde d’énonciations, de récits, de pronoms, et invite à une circulation de la parole – une parole potentiellement tranchante, ironique, chorégraphiée, faite de bégaiements ou de frictions – comme outil émancipateur.

Lili Reynaud-Dewar, “Salut, je m’appelle Lili et nous sommes plusieurs”, du 19 octobre 2023 au 7 janvier 2024 au Palais de Tokyo, Paris 16e.
1 Exposée pour la première fois en France à Treize (Paris) en 2022 dans une exposition homonyme curatée par Julien Laugier.
2 Rome, 1er et 2 novembre 1975 (2019-2021), œuvre exposée pour la première fois lors du 21e prix Marcel-Duchamp au Centre Pompidou à l’automne 2021.
3 Academonia de Dodie Bellamy (2006), éd. Krupskaya Books. Traduit de l’anglais avec Ethan Assouline pour la revue Médiathèque #1.
4 Proposition artistique qu’elle met en pratique depuis une dizaine d’années, et qu’elle renouvelle presque à chaque invitation à exposer dans un centre d’art ou un musée. Pour Salut, je m’appelle Lili et nous sommes plusieurs, elle propose une nouvelle série de vidéos dansées dans les expositions des deux dernières années du Palais de Tokyo.










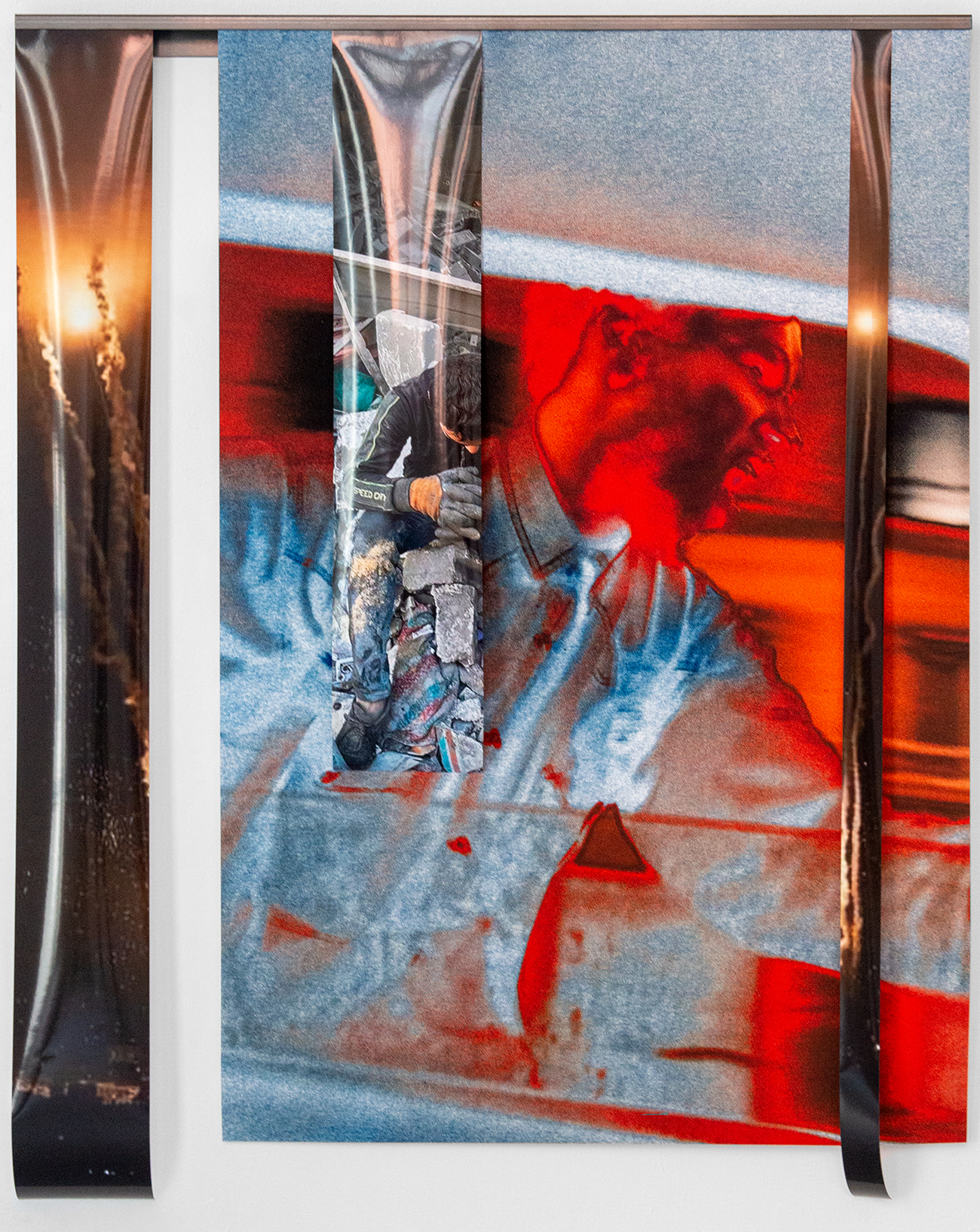
![Amigo de El Friki y pared rosa (série Bravo) [2021-2024]. © Courtesy of Felipe Romero Beltrán, Hatch Gallery & Klemm’s Berlin.](https://numero.com/wp-content/uploads/2025/11/thumb-felipe-romero-beltran-numero-art.jpg)


