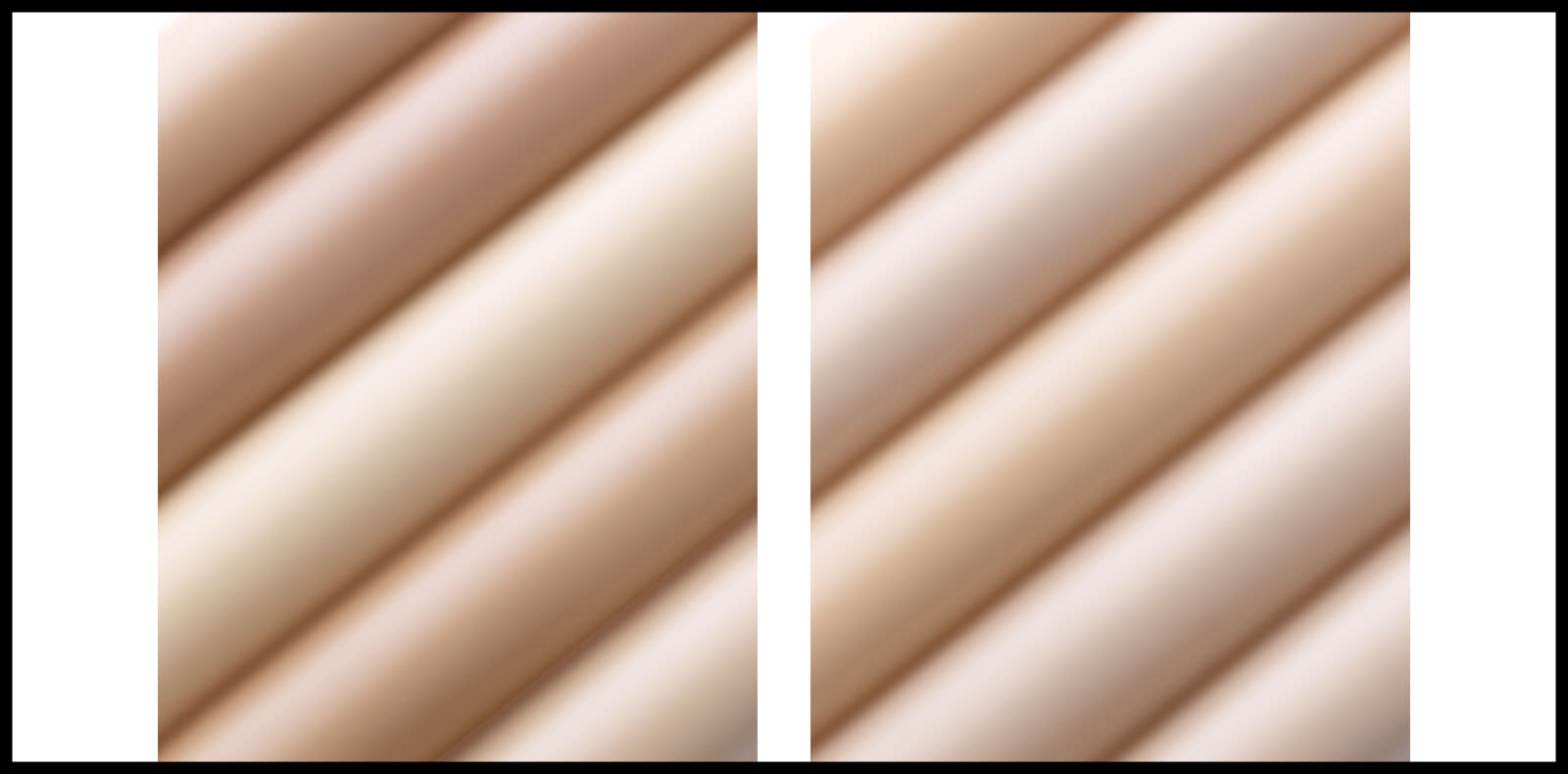9

9
À quoi ressemblent les inquiétantes créatures robotiques de Jordan Wolfson ?
Exposé au Schinkel Pavillon de Berlin jusqu’au 1er avril, l’artiste avait fait sensation à la Biennale du Whitney Museum il y a quelques années en présentant une œuvre vidéo en réalité virtuelle d’une grande violence. Un nouveau témoignage de la puissance de ses personnages animés et de son habile maîtrise des nouvelles technologies.
Par Éric Troncy.

En 2014, le vernissage de la Biennale du Whitney Museum of American Art n’avait pas encore eu lieu (il fut différé pour cause de chute de neige) que Jordan Wolfson avait déjà été consacré comme l’attraction majeure – révoltante ou enthousiasmante, c’était selon – de cette exposition considérée comme un moment culminant de la vie artistique contemporaine. Consacrée aux artistes américains jeunes ou méconnus, cette manifestation annuelle fondée en 1932, et baptisée Whitney Annual devint biennale à partir de 1973 et marqua un tournant dans la carrière de certains artistes. En 1989, le jeune Jeff Koons (il avait alors 34 ans) s’y fit ainsi fortement remarquer. Presque trente ans plus tard, c’est au tour de Jordan Wolfson, 37 ans, d’éclipser un peu les soixante-deux autres artistes qui exposent avec lui : il faut admettre qu’il emploie la manière forte.
Le second jeune homme est l’artiste lui-même. Muni d’une batte de base-ball, il frappe violemment la tête de celui qui, agenouillé, est ensuite traîné sur la chaussée puis brutalement tabassé dans des giclements de sang.
Au Whitney, c’est simplement avec des casques de réalité virtuelle que Jordan Wolfson attend les spectateurs, un équipement donnant accès au petit film (à peine deux minutes) qui, en quelques jours, est devenu le centre de toutes les conversations. Du New York Times au New Yorker (“Shocking Virtual-Reality Artwork”), la presse américaine prend acte des “réactions d’horreur suscitées par l’œuvre de réalité virtuelle ultra violente de Jordan Wolfson à la Biennale du Whitney” (“All the Horrified Reactions to Jordan Wolfson’s Ultraviolent VR Art at the Whitney Biennial”, titrait le magazine W), et restitue les commentaires des visiteurs. Instructifs, amusants parfois, ils ont finalement à peu près la même valeur que ceux laissés par les clients des hôtels et des restaurants sur le site TripAdvisor : ils en disent souvent plus sur leur auteur que sur ce dont il parle. Mais comme l’expliquait le critique littéraire Arnaud Viviant avec beaucoup d’à- propos : “Le ‘J’aime’ ou ‘Je n’aime pas’ n’est pas le problème du journaliste qui n’est pas dans la satisfaction mais dans la compréhension.”
Qu’y a-t-il donc à comprendre dans ce petit film dont on fait l’expérience grâce à l’utilisation d’une technologie sophistiquée ? À cette légitime interrogation, Wolfson a fait en sorte qu’il n’y ait pas de réponse unique, et laisse le visiteur aux prises avec le fardeau de ce qu’il vient de voir. Un ciel de printemps, tout d’abord et très brièvement, puis le trottoir d’une rue de New York sur lequel est agenouillé un jeune homme en jean et sweatshirt à capuche rouge : il a une curieuse expression. Le second jeune homme en tee-shirt gris qui s’approche de lui est l’artiste lui-même. Muni d’une batte de base-ball, il frappe alors violemment la tête de celui qui, agenouillé, est ensuite traîné sur la chaussée puis brutalement tabassé, toujours par l’artiste lui-même, dans des giclements de sang. Pendant toute la durée de la scène, on entend la voix de l’artiste qui lit les deux bénédictions hébraïques que les juifs récitent pendant Hanoukka.

En 2010, Pierre Huyghe avait convié non pas des spectateurs, mais des “témoins” – selon la terminologie qu’il employait lui-même sur l’invitation –, à assister à une performance de quatre heures au musée des Arts et Traditions populaires, à Paris. Avec Wolfson, cette fonction de “témoin” prend un sens exacerbé, parce que l’action à laquelle ce témoin assiste est criminelle. L’utilisation de la réalité virtuelle – qui place le spectateur au centre d’une situation semblant réelle – le rend contemporain de cette scène et, en l’occurrence, de sa violence réelle – Real Violence étant précisément le titre de l’œuvre.
“Je n’ai jamais été vraiment intéressé par les animatroniques. Et puis j’ai découvert ceux de Disney World présentées dans le hall des Présidents, en Floride…”
Ce n’est pas parce qu’il est impossible de définir les motivations de cette violence qu’elle est insupportable, mais sa manifeste gratuité prive en effet le spectateur – le témoin – de tout appui cognitif, tandis que la nature même du texte ajoute une complexité supplémentaire irrésolue. C’est l’une des particularités des œuvres de Jordan Wolfson : elles abordent de manière frontale des sujets traumatisants, y compris parfois de manière plus ludique ou désinvolte qu’en ce cas précis, sans délivrer de message ni d’indication de lecture. Pour l’artiste, cela ne relève en rien de ce qui s’apparenterait, justement, à de la désinvolture, mais d’une idée précise de ce que sont les œuvres d’art et de leur fonction. “Les grands artistes ne sont pas les transcripteurs du monde, ils en sont les rivaux”, écrivait Malraux. Avec cette œuvre, l’artiste se comporte vis-à-vis du monde comme un rival de la pire espèce : celui qui en exploite les faiblesses.
La réalisation du film de Wolfson n’a pas supposé le recours à un acteur qui aurait encaissé les coups exacerbés par des effets spéciaux : cette hypothèse, pourtant expérimentée par l’artiste, a été jugée trop factice, et c’est une animatronique qui endossa la lourde tâche de recevoir les beignes – le sang, entre autres, a été ajouté à la postproduction. Wolfson est un familier des animatroniques, ces robots dont l’apparence humaine est assez ressemblante et qui, surtout, sont équipés d’une mécanique sophistiquée permettant des mouvements extrêmement réalistes. “Je n’ai jamais été vraiment intéressé par les animatroniques. J’avais vu comment Paul McCarthy les utilisait dans son travail, et je trouvais ça intéressant, mais ce n’était pas pour moi. Et puis j’ai découvert les animatroniques de Disney World présentées dans le hall des Présidents, en Floride. Il y en avait une, celle de Barack Obama, qui parlait et remuait ses mains. C’était comme une sculpture, mais avec une présence qui m’a séduit. Cela m’a ému ; j’ai été davantage touché par cette présence que par l’animation elle-même, ou d’autres types de choses qui m’avaient inspiré précédemment. Cette présence m’a submergé, et, dès ce moment, j’ai été obsédé par l’idée de réaliser quelque chose qui posséderait cette présence”, confiait Jordan Wolfson à Beatrix Ruf, qui lui consacrait, de novembre 2016 à avril 2017, une grande exposition au Stedelijk Museum d’Amsterdam. Il eut recours à ces animatroniques en 2014, lorsqu’il présenta Female Figure, une œuvre qui, rétrospectivement, semble être la première d’une trilogie dont Real Violence serait la conclusion.
“J’essaie de créer quelque chose qui existe dans ce que l’on pourrait qualifier de présent infini.”

Wolfson appartient à une génération d’artistes qui a de quoi surprendre l’historien des arts : elle ne semble pas spécialement concernée, justement, par l’histoire de l’art et l’évolution de ses formes. Elle cherche ailleurs à quoi se mesurer, dans un monde où l’information circule en temps réel et où la technologie est aussi au service de l’entertainment, qui s’est imposé comme une valeur indiscutable. Le pouvoir onirique des animatroniques n’a d’ailleurs pas tardé à inspirer le cinéma : en juillet 2014, la chaîne de télévision CBS commençait la diffusion de la série télévisée Extant dont un personnage central, Ethan, était un robot humanoïde. En décembre 2016, c’est la chaîne HBO qui diffusait la série télévisée Westworld dans laquelle la quasi-totalité des personnages sont censés être des robots dont la forme humanoïde est à s’y méprendre. La Female Figure de Jordan Wolfson, elle, contemplait dans un miroir les ondulations de son corps tandis que, le visage recouvert d’un masque grotesque, elle semblait raconter tout un tas de choses sur sa biographie : “Ma mère est morte. Mon père est mort. Je suis gay. Je voudrais être poète. Ceci est ma maison.”
Conçue avec l’aide d’un studio d’effets spéciaux de Los Angeles, cette Female Figure était dotée d’une technologie complexe qui non seulement la faisait réagir à la présence d’un spectateur (l’œuvre n’était visible que pour deux personnes simultanément), mais lui permettait aussi de le suivre des yeux et de le regarder avec insistance.
Les œuvres de Wolfson constituent des propositions artistiques fascinantes. Elles semblent réaliser le rêve des Millennials : inventer de nouvelles règles du jeu.
C’est la même technologie qui fut encore utilisée en 2016 par Jordan Wolfson pour réaliser Colored Sculpture, le deuxième élément de cette vraisemblable trilogie : un dispositif de rails métalliques et de câbles orchestrant les déplacements, dans l’espace et en l’air, d’une sorte de Pinocchio géant et articulé, évoluant dans un bruit assourdissant de chaînes, qui, parfois, le soulevaient du sol pour le laisser ensuite s’écraser violemment à terre. Lui non plus ne vous quittait pas du regard et, informé par les logiciels de reconnaissance faciale de l’emplacement exact de votre visage, vous fixait de ses grands yeux électroniques : on pensait au O Superman (1981) de Laurie Anderson et à ses paroles quasi prémonitoires : “Tiens-moi, Maman, dans tes longs bras. Dans tes bras mécaniques. Tes bras électroniques.” Jordan Wolfson, quant à lui, souligne : “Je ne suis pas un artiste du récit. Et c’est amusant parce qu’habitant ici, à Los Angeles, les discussions tournent souvent autour de la réalisation de films ou de choses du même genre, mais je ne suis tout simplement pas quelqu’un qui raconte des histoires. Si, en effet, j’utilise des personnages, il n’y a pas à proprement parler d’histoires autour d’eux. J’essaie de créer quelque chose qui existe dans ce que l’on pourrait qualifier de présent infini.”
Sa précédente trilogie était composée de trois films d’animation digitale : Con Leche (2009), Animation Masks (2011) et Raspberry Poser (2012). Dans ce dernier, une modélisation du VIH sautille dans les espaces verts parisiens et les rues de SoHo, rebondissant sur les comptoirs hyper design des boutiques de luxe, sur une bande-son convoquant Beyoncé. “Le son doit être vraiment fort !” m’avait recommandé Jordan Wolfson lorsque j’avais exposé cette œuvre au Consortium en 2014.
On ne savait pas bien, déjà, comment interpréter ce scénario à la fois limpide et irrésolu, comme l’est aujourd’hui l’action de son film en réalité virtuelle. Ce n’est qu’un élément à ajouter à l’ensemble de ceux qui font des œuvres de Wolfson des propositions artistiques fascinantes. Elles semblent émancipées de l’histoire de l’art qu’elles évoquent pourtant parfois dans leur titre (Colored Sculpture ou Female Figure), mais ces évocations sont comme de vieilles photographies de famille sous cadre au beau milieu d’un intérieur ultra contemporain : des souvenirs affectifs et esthétiquement embarrassants. Car les œuvres de Jordan Wolfson ont réussi le pari des Millennials d’inventer d’autres règles du jeu, de concevoir autrement leur rapport à leur propre discipline et de se mesurer, justement, à d’autres disciplines. Au début des années 90, les planneurs stratégiques de la marque Nike expliquaient que son concurrent n’était pas Reebok mais les jeux vidéo. Nul doute que l’art de Wolfson entend se mesurer à autre chose qu’aux toiles de Matisse ou de Richard Prince. Peut-être à cause de cette ambition, ses expositions sont attendues comme l’épilogue d’une série télévisée. Season’s finale, spin-off, trailer ou making of : nul ne sait encore quelle forme prendra la prochaine, ce mois de mai, à la galerie Sadie Coles de Londres.
Exposition Jordan Wolfson, Schinkel Pavillon, Berlin, jusqu’au 1er avril.