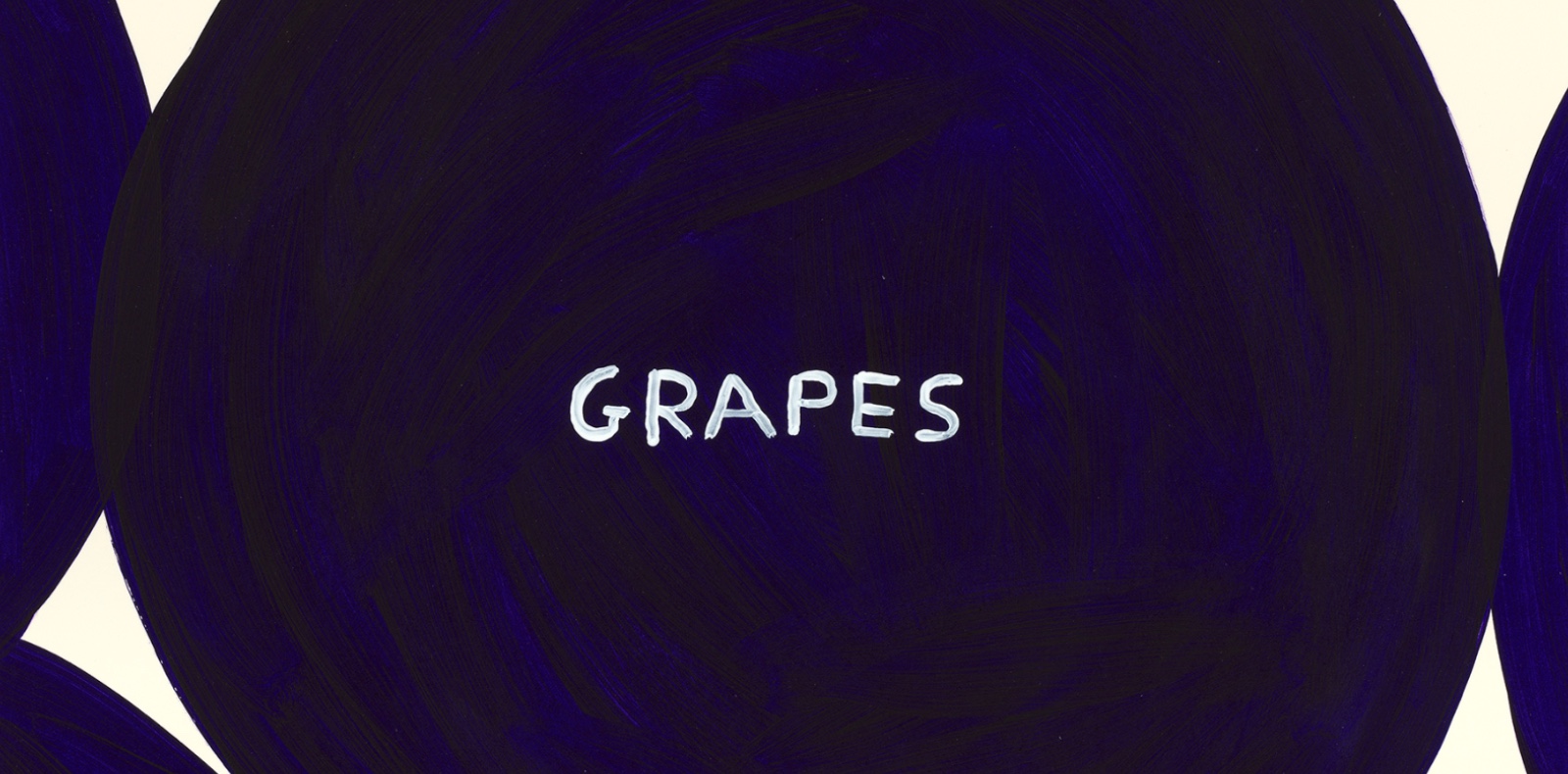20

20
“Il faut proposer au public des créations qui peuvent lui parler, avec des individus qui lui ressemblent.” Le futur de la danse selon Benjamin Millepied
Il incarne une pensée en mouvement, une articulation unique entre la culture du ballet classique et la liberté de la danse contemporaine… Depuis Los Angeles, où il vit et a décidé d’installer sa compagnie de danse LADP, le Frenchie Benjamin Millepied travaille d’arrache-pied à écrire l’avenir d’une discipline artistique longtemps restée passéiste. Numéro Homme fait le point sur les multiples projets de cet homme-orchestre.
Propos recueillis par Thibaut Wychowanok,
Portraits Matthias Vriens-McGrath.
Publié le 20 avril 2018. Modifié le 18 avril 2025.

Et si nous avions tout faux à propos de Benjamin Millepied ? À en croire les recherches Google les plus fréquentes associées à son nom, la vérité du chorégraphe se trouverait dans sa relation avec Natalie Portman (son épouse depuis 2012, après leur collaboration sur le film Black Swan), les Oscars (sa présence sur le tapis rouge avec… son épouse, encore !) et l’Opéra de Paris, dont il a soudainement quitté la direction de la danse en 2016. Pourtant, il y a fort à parier que le secret de Benjamin Millepied trouve son origine ailleurs que sous les projecteurs et la fame d’Hollywood ou de Paris. On parierait, sans trop prendre de risque, sur l’Afrique. Le danseur y a grandi, et semble en avoir gardé l’esprit chevillé au corps.
Si Benjamin Millepied a vu le jour à Bordeaux le 10 juin 1977, c’est bien à Dakar, où il a vécu une partie de son enfance, que le Français s’est offert à la danse, tâtant de ses plaisirs à l’écoute des rythmes et des percussions sénégalaises. Le plaisir et le rythme bien avant la technique, le ballet à Bordeaux à la fin des années 80, ou le Conservatoire de Lyon dans les années 90. Le plaisir et le rythme, bien avant le savoirfaire développé au New York City Ballet dont il devient étoile en 2001, puis au sein de sa propre compagnie, L.A. Dance Project, créée en 2011.
Depuis son enfance, Benjamin Millepied a travaillé cette approche multiculturelle originelle, renforcée par ses années passées aux États-Unis. Il a aussi développé une vision hédoniste de la danse, à rebours d’une image d’Épinal souvent spartiate à laquelle on l’associe souvent. Cette approche et cette vision, Benjamin Millepied les met aujourd’hui au service d’une ambition : projeter sa discipline dans un xxie siècle plus collaboratif, plus mixte, plus ouvert aux autres et aux autres disciplines, de l’art au cinéma. Un programme presque politique dont le danseur, chorégraphe et bientôt réalisateur d’une comédie musicale inspirée du Carmen de Bizet, dévoile les détails pour Numéro Homme.
Numéro Homme : En tant que directeur de compagnie, quelles sont vos premières préoccupations ?
Benjamin Millepied : Le public, par exemple. Quel est celui de la danse aujourd’hui ? Nous vivons à une époque très différente de celle qui a vu naître l’Opéra de Paris. J’ai envie de toucher une large audience et d’inclure des cultures différentes. Pour cela, il faut répondre à un certain nombre de questions : où est implantée votre organisation ?
Au sein de quelle communauté ? Quels sont les prix des billets ?
Vous avez été le premier à l’Opéra de Paris en 2015 à offrir à une danseuse métisse un premier rôle dans un ballet classique.
Oui, j’ai envie de voir des gens différents. Tout comme on pourrait imaginer un ballet avec des danseurs de plus de 40 ans. Ce problème de la représentativité existe dans beaucoup d’autres ballets, y compris aux États- Unis [en 2015, le sujet a été au coeur de l’actualité alors que la danseuse Misty Copeland était la première Afro-Américaine à interpréter Odette/Odile dans le Swan Lake de l’American Ballet Theatre]. Regardez ce qui s’est passé en février avec l’incroyable succès du film Black Panther. La minorité afroaméricaine, qu’on ne voit pas assez à Hollywood, était enfin représentée. Et le public a été au rendez-vous. Il faut juste lui proposer des créations qui peuvent lui parler, avec des individus – acteurs, artistes ou chorégraphes – qui lui ressemblent. La prise de conscience est importante, surtout chez les jeunes générations. Mais rien ne changera sans efforts importants.
Quelle est l’origine du problème ?
Les vieilles compagnies sont fondées sur des pratiques du passé, une hiérarchie et un environnement de travail difficiles. Il ne faut pas tout envoyer valser, mais essayer de développer une culture de ballet adaptée à notre époque. C’est mon ambition avec le L.A. Dance Project. Cela implique d’être moins nombreux, d’avoir un rapport plus personnel avec les danseurs et les équipes. Évidemment, avoir cent cinquante danseurs dans une grande institution est merveilleux. C’est fou ce que l’on peut faire avec cent cinquante danseurs ! Mais il y a trop de problèmes avec cette ancienne culture des ballets classiques. Il est temps de moderniser les rapports humains.

“Au Sénégal, j’étais le seul blanc dans la cour de récré. Cela m’a permis de grandir comme n’importe quel Sénégalais. J’exagère… j’ai eu une enfance plus aisée. Mais j’ai partagé avec eux le même rapport organique à la danse, la même envie de bouger, le même amour du rythme.”
Quelles sont vos propositions pour moderniser le ballet ?
Que voulons-nous faire de cette technique qui existe depuis un siècle et demi ? Comment allons-nous la faire évoluer ? Pourquoi entraîner des jeunes le matin à travailler des techniques extrêmement poussées si nous ne sommes pas capables de leur proposer de les mettre en pratique l’après-midi dans des ballets contemporains ? Je ne vois pas pourquoi les danseurs s’entraîneraient à faire des pointes le matin pour danser l’après-midi des ballets qui existent depuis cent ans, ou uniquement du contemporain pieds nus ! Le ballet a besoin d’un nouvel enrichissement culturel à travers le monde.
De quel ordre peut-il être ?
Les derniers grands ballets datent de l’époque de Lincoln Kirstein et George Balanchine au New York City Ballet ou des Ballets russes de Sergei Diaghilev. Pourquoi ? Parce ces grands projets étaient attachés non seulement à de grands artistes, mais aussi à de grands imprésarios extrêmement cultivés qui venaient de l’art contemporain ou de la littérature, comme Kirstein ou Diaghilev. Tous les deux naviguaient dans le milieu artistique de leur époque ! Leur réflexion, leur savoir et leur passion ont donné naissance à des pièces chorégraphiques qui ont révolutionné notre métier. Aujourd’hui, malheureusement, ces associations n’existent plus. Les compagnies de danse à travers le monde sont dirigées par des directeurs de ballet qui ne connaissent que la danse et rien que la danse.
Vous vous passionnez, a contrario, pour la musique, l’art contemporain et la mode et multipliez les collaborations avec des artistes comme Barbara Kruger, Mark Bradford ou Daniel Buren et des créateurs de mode tel Alessandro Sartori, le directeur artistique d’Ermenegildo Zegna…
Avec le L.A. Dance Project, je travaille actuellement sur une nouvelle pièce autour du travail de composition de Bach : le contrepoint, la fuite, le canon. J’explore
la structure musicale de son œuvre, en essayant de la transcrire par les corps. C’est une manière d’approfondir mon travail de chorégraphe, c’est-à-dire d’améliorer mon savoir-faire, ma sensibilité par rapport aux sujets que j’aborde, ma manière de les traiter visuellement et de mettre ces corps dans l’espace. Même s’il y a dans cette nouvelle pièce un aspect très organique et viscéral, la base de la structure demeure classiciste. C’est ce qui garantit une certaine beauté sur scène.
Est-ce que cette nouvelle pièce donnera lieu à des collaborations artistiques ?
Il n’y aura peut-être pas que Bach. Je m’intéresse également à un compositeur qui a travaillé autour du contrepoint, en hommage à Bach. Alessandro Sartori réalisera les costumes de cette pièce dont la première partie sera présentée au mois d’avril à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Et j’ai l’intention de faire appel à un artiste, que je n’ai pas encore choisi, pour m’accompagner sur la deuxième partie. C’est extraordinaire d’observer une pièce évoluer grâce au nouvel environnement qu’imagine un artiste, en amenant ses œuvres et son travail sur scène. Discuter avec les créateurs, c’est aussi nourrir sa propre pensée. Mes discussions avec Philippe Parreno sur la manière dont il envisage l’exposition comme une construction à plusieurs niveaux, et à partir d’œuvres en mouvement, ont eu une grande influence. J’espère que nous pourrons collaborer prochainement. Quand je suis à Paris, j’adore également parler avec Tino Sehgal.
Vous vous intéressez aussi au cinéma. Où en est votre projet de long métrage ?
Je travaille depuis deux ans sur une adaptation moderne de Carmen qui sera l’occasion de proposer une nouvelle musique. Je m’apprête à partir en casting et le tournage devrait commencer à la fin de l’année. Il ne s’agit pas d’une pièce filmée mais d’un véritable film. Nous allons totalement réinventer Carmen.
Avez-vous d’autres projets en cours ?
Je lance au mois de mars Artform, une plateforme de fundraising à destination des artistes. Sous la forme d’un site ou d’une application, Artform permettra à des créateurs en tout genre de présenter leur travail, et aux autres membres de les soutenir via une participation financière mensuelle. On pourra donner un, dix ou cinquante dollars par mois. L’artiste détermine le montant et ce qu’il est prêt à offrir en échange : un accès privilégié à un spectacle, une visite d’atelier… Il s’agit d’un nouveau modèle de soutien aux artistes sur lequel je travaille depuis trois ans.
“À New York, les compagnies de ballet sont financées par l’Upper East Side, qui lit le New York Times. Sa critique est beaucoup trop institutionnelle. Cela n’a pas amélioré la situation de la danse aux États-Unis et empêche les choses d’avancer.”
Et où en est votre résidence à la Fondation Luma dans le sud de la France ?
Nous avons présenté deux nouvelles créations l’année dernière [In Silence We Speak avec des costumes d’Alessandro Sartori pour Ermenegildo Zegna, et Orpheus Highway]. Cet été, nous inviterons des artistes américains à développer un travail avec la communauté d’Arles. Nous allons programmer différents workshops. Et nous emmènerons également des personnalités de la région à Los Angeles. Le dialogue doit se faire dans les deux sens.
Votre acolyte de toujours, Dimitri Chamblas, explique dans le film Relève, consacré à l’une de vos créations à l’Opéra de Paris, que vous avez un besoin vital “d’avoir la banane” pour avancer…
Soit le plaisir est là, soit je ne peux pas travailler.
C’est une idée que l’on vous voit défendre tout au long du film auprès des danseurs de l’Opéra. Mais la danse n’implique-t-elle pas aussi une discipline ? Et diriger n’oblige-t-il pas à faire preuve d’autorité, voire d’autoritarisme ?
Jamais. Quand vous allez travailler, de quoi avez-vous envie ? D’un environnement où vous vous sentez bien ! Quand on engage des gens, c’est parce qu’on les aime. On doit alors faire en sorte qu’ils soient à l’aise pour qu’ils puissent offrir tout ce qu’ils ont à donner. Il n’y a rien de plus beau que de voir un danseur s’épanouir, avoir conscience d’être lui-même, prendre confiance. C’est fantastique. Mon job est de tirer le meilleur des gens. Pour avoir une belle mise en scène, il faut de beaux interprètes. Et pour avoir de beaux interprètes, il faut qu’ils aient la chance de s’exprimer et d’être eux-mêmes.
Est-ce que vous avez une idée d’où vous vient ce rapport très décomplexé et hédoniste à la danse ?
Mon premier rapport à la danse s’est fait de manière très naturelle en Afrique. Au Sénégal, ma famille a choisi de ne pas me mettre dans une école privée ou une école française. J’étais le seul blanc dans la cour de récré. Cela m’a permis de grandir comme n’importe quel Sénégalais. J’exagère… j’ai eu une enfance aisée par rapport à d’autres. Mais j’ai partagé avec eux le même rapport organique à la danse, la même envie de bouger, tout simplement, le même amour du rythme. Ça vous marque à vie. Toute la polyrythmie et la complexité des sons de cette époque ont façonné mon rapport au rythme et à la musique et explique sans doute pourquoi je suis très attiré par un compositeur comme Steve Reich [pionnier de la musique minimaliste qui a développé une écriture musicale basée sur le rythme et la pulsation].
Vous vous êtes également très tôt passionné pour Mikhaïl Baryshnikov.
Il est le plus grand danseur de ballet de tous les temps. Il n’y en a pas eu comme lui avant et il n’y en aura pas après. Il avait tout : intelligence musicale, intelligence technique. Physiquement, il était incroyable. Il n’en faisait jamais trop. Sa gestion de carrière est un modèle, entre prises de risque et commandes. Il a même su s’arrêter au bon moment. Et aujourd’hui il est à l’origine d’un centre, le Baryshnikov Arts Center, qui vient en aide aux chorégraphes en leur offrant notamment des studios pour répéter.

Vous avez créé une compagnie en 2011 à Los Angeles. Et vous venez de vous installer dans un nouvel espace dans le quartier des galeries. Qui finance vos projets ?
Nous faisons appel à des fonds privés, et plus particulièrement au financement de grandes maisons du luxe. Nous avons la chance d’être soutenus depuis nos débuts par Van Cleef & Arpels, et par son président Nicolas Bos que je ne remercierai jamais assez.
En quoi ce soutien consiste-t-il ?
Cela peut prendre la forme d’une commande d’œuvre. Nous avons ainsi travaillé trois ans sur un ballet autour des Joyaux de Balanchine [le ballet originel est né de la découverte par le chorégraphe des vitrines du joaillier sur la 5e Avenue et de sa rencontre avec Claude Arpels]. Nous avons également travaillé main dans la main afin de présenter des performances spécialement conçues pour le site de la Fondation Chinati de Donald Judd à Marfa.
Que vous apporte Los Angeles que vous ne trouvez pas à New York ou à Paris ?
À Los Angeles, le monde des médias a déjà explosé. Aucun titre de presse ne domine. Ici, pas de New York Times pour imposer sa vision. Les communautés sont diverses et aucune n’impose son goût. Je m’y sens plus libre.
Il est arrivé au New York Times de ne pas être très tendre avec vous. Sa critique est-elle trop institutionnelle ?
Oui, beaucoup trop. Les choses ont été poussées dans le mauvais sens et n’ont pas amélioré la situation de la danse aux États-Unis. À New York, les compagnies de ballet sont financées par l’Upper East Side, qui lit le New York Times. Si les critiques sont bonnes, l’Upper East Side est content. Sinon… Cette situation est très problématique quand on veut faire avancer les choses.
Peut-on parler d’une nouvelle scène à Los Angeles ?
Une dynamique nouvelle souffle sur la danse aux États-Unis, et je crois qu’elle trouve son origine à Los Angeles. Je ne suis pas seul. William Forsythe a depuis longtemps ouvert la voie. Il intervient aujourd’hui au sein de l’Université de Californie du Sud. Je pense aussi aux initiatives de l’école de danse de CalArts à Santa Clarita au nord de Los Angeles, ou à celle de Colburn. De nombreux chorégraphes viennent s’installer ici. Une nouvelle génération de créateurs, d’artistes, de danseurs vont s’épanouir grâce à ses initiatives et faire évoluer notre discipline. L’avenir de la danse se crée aujourd’hui à Los Angeles, pas à New York.

Réalisation : Sean Knight. Coiffure et maquillage : Davy Newkirk.