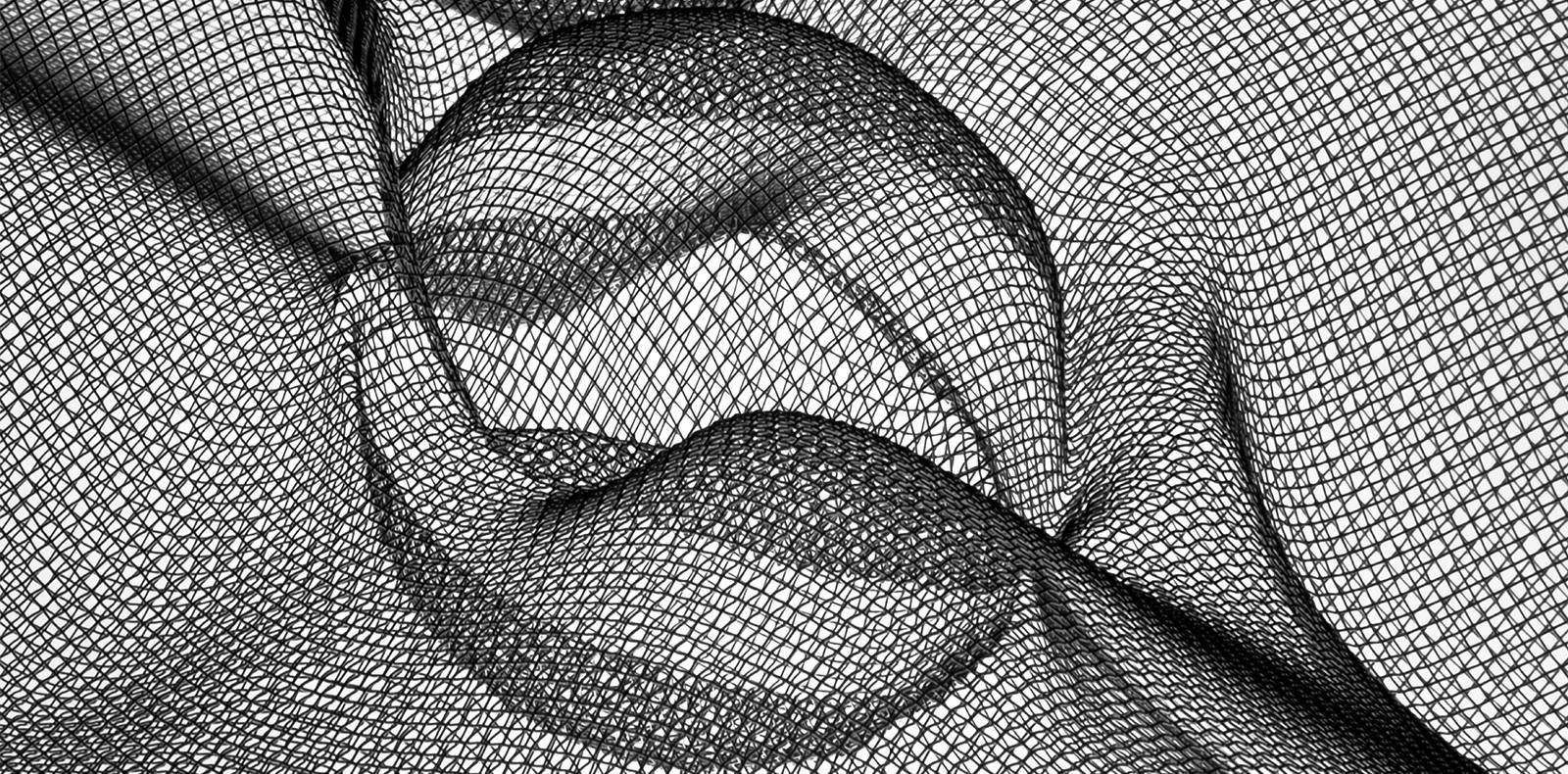8

8
Who is Brit Marling, the brains behind cult TV show “The OA”?
Actrice et scénariste, Brit Marling s’est forgé un espace bien à elle à Hollywood, en écrivant ses propres rôles. De la place des femmes aux utopies communautaires contemporaines, cette nouvelle voix explore le potentiel de subversion que recèlent la fiction et le récit, notamment dans la série The OA, diffusée sur Netflix. Rencontre.
Par Olivier Joyard.

À 34 ans, l’évanescente Brit Marling s’est révélée à la face du monde l’hiver dernier en tenant le premier rôle d’une fascinante série dont elle a également cosigné l’écriture. The OA, mise en ligne sur Netflix (une deuxième saison a été commandée), raconte le retour d’une jeune femme dans la ville de ses parents. Disparue pendant sept ans, elle confie à quelques adolescents le récit de ses années sombres, les entraînant, par le biais de sa parole fascinante, dans les contrées reculées de l’expérience humaine. Mêlant la sciencefiction au drame réaliste, cette incroyable exploration visuelle et narrative a permis à Brit Marling de s’affirmer comme l’une des créatrices qui comptent à Hollywood, une décennie après être arrivée en Californie. Constatant le manque de rôles forts écrits pour des femmes, la native de Chicago avait décidé de s’atteler elle-même à la tâche en écrivant avec Mike Cahill et Zal Batmanglij des histoires sur mesure. D’abord connue pour quelques films indies remarqués au Festival de Sundance (Sound of My Voice et Another Earth en 2011, The East en 2013, I Origins en 2014), Marling atteint désormais un public bien plus large, sans rien renier de ses ambitions et de sa bienveillance.
NUMÉRO : Depuis l’investiture de Donald Trump, l’atmosphère est tendue à Hollywood et dans le milieu du cinéma indépendant, dont vous faites partie. Comment allez-vous ?
BRIT MARLING : Je crois que l’ensemble du pays se sent concerné. Les gens réfléchissent plus que d’habitude à ce que cela veut dire de s’engager dans une démocratie pour la faire vivre. C’est intéressant de voir des foules protester, comme souvent dans l’histoire américaine. Grâce à cela, je suis une optimiste relative. L’optimisme est une stratégie de survie efficace pour réussir à mettre un pied devant l’autre.
Survivre est un mot qui résume bien The OA, votre série.
Tout le monde subit un trauma dans sa vie. Notre seule certitude en tant qu’être humain, c’est celle de la perte. Elle arrive toujours, d’une manière ou d’une autre. On perd son amour. On perd sa santé. Il faut apprendre à se mouvoir à travers ce territoire violent. Le message essentiel de notre série, c’est de dire que nous avons besoin d’unité : on arrive à quelque chose de très puissant si des êtres s’allient et mettent leurs forces en commun. Nous avons conçu The OA comme un refuge, un endroit pour aller mieux.
“Quand on apprend à subsister pendant assez longtemps avec très peu de choses, on connaît le prix de la survie et cela offre une autonomie radicale.”
Pour vous, la fiction a des vertus consolatrices ?
Je me souviens d’une citation de l’écrivain James Baldwin que mon partenaire créatif Zal Batmanglij [cocréateur de The OA] et moi avons partagée : “Tu penses que ton chagrin est sans précédent dans l’histoire, et un jour, en lisant un livre, tu te rends compte que les choses qui te tourmentent le plus sont justement celles qui te relient à toutes les personnes qui sont vivantes ou l’ont un jour été.” La fiction peut éviter l’isolement, surtout à une époque qui vénère l’individu et où les technologies peuvent favoriser le repli sur soi. L’art de raconter des histoires provoque l’empathie et la conscience du collectif. En tout cas, c’est ce que je crois.
Entre science-fiction, expériences de mort imminente et réalisme social, The OA est presque impossible à résumer. On imagine un processus long et minutieux avant d’arriver à donner du sens à ces articulations…
Au début, avec Zal, comme il était difficile de résumer les points clés de l’intrigue, nous avions l’habitude de raconter, oralement, le premier épisode à nos interlocuteurs. C’était notre manière d’expliquer comment passer d’une réunion parents-profs à une maison d’oligarques en Russie, d’un ado à problèmes du Midwest à un accident à 6 000 kilomètres de là. Très vite, nous avons pris l’habitude de ne pas écrire quoi que ce soit sans être capables, d’abord, de raconter l’histoire oralement à une personne prise au hasard dans un café, en réussissant à la captiver. Un long processus… mais un processus nécessaire, un peu dans l’esprit du “feu de camp”, ce moment où les histoires sont racontées de façon proche et intime et prennent une ampleur insoupçonnée. Ensuite, quand nous avons commencé à mettre des mots sur des pages, nous nous réunissions quelques heures par jour pour parler de ce qui nous intéressait dans les affaires du monde, et, très vite, nos conversations étaient rattrapées par la narration. Une séquence prenait forme, un personnage naissait, un rêve que l’un de nous avait fait s’invitait dans le flux. Au bout d’un certain temps, seules les meilleures idées restaient ancrées en nous.

Avec Zal Batmanglij, vous avez traversé une période freegan [végétarien essayant de se nourrir gratuitement et s’opposant au gaspillage alimentaire], qui a donné le film The East sorti en 2013. Pourquoi avoir plongé dans ce mode de vie alternatif ?
Après nos études à Washington, nous sommes arrivés, au milieu des années 2000, à Los Angeles et nous cherchions encore notre voie. Je voulais jouer dans des films, mais je ne savais pas comment le faire sans me compromettre, car les rôles proposés aux jeunes femmes à Hollywood sont souvent désespérants. C’était avant Occupy Wall Street… comme beaucoup, je me suis sentie concernée par des mouvements alternatifs. Comment dois-je vivre ma vie ? Comment lui donner du sens ? C’était un de ces moments où l’on se pose des questions essentielles sans les esquiver. Pas mal de gens quittaient le système, notamment à travers le “freeganisme”. Ils vivaient en collectivité, rompaient avec le capitalisme, s’installaient dans des communautés vertes, des fermes biologiques, travaillant la terre tous ensemble. Il y avait aussi des collectifs anarchistes, des groupes d’action directe. Nous avons passé du temps à travers le pays, dans cinq groupes différents. Nous essayions de comprendre. Avec Zal, nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes. La plus importante des leçons, c’est qu’il existe une manière de vivre qui ne nous livre pas à la peur. Quand on apprend à subsister pendant assez longtemps avec très peu de choses, on connaît le prix de la survie et cela offre une autonomie radicale. Depuis, on essaie de transposer cela dans notre manière de raconter des histoires. Dès notre retour à Los Angeles, nous avons commencé à tourner des films en dehors du système. Cela a donné Sound of My Voice et After Earth. Et nous avons eu la chance d’être repérés à Sundance en 2011.
Avez-vous le sentiment que votre enfance ou votre éducation vous ont conduite vers cette approche subversive de la pratique artistique ?
Je ne crois pas. J’ai étudié l’économie, et l’une des sensations que l’on peut avoir en approfondissant ce sujet dans ce pays, c’est qu’il y a un fort besoin d’idées nouvelles. Personnellement, j’ai toujours considéré que l’éducation pouvait être une forme d’endoctrinement qui amène à accepter les choses telles qu’elles sont. Pour les jeunes, le vrai défi consiste à penser par eux-mêmes et à réinventer leur discipline. C’est valable aussi pour la narration. J’ai beaucoup parlé avec les frères Duffer qui ont créé Stranger Things. Zal et moi, nous avons aussi tenté quelque chose et trouvé en Netflix un interlocuteur qui nous a libérés. Tout cela vient d’un désir de rébellion.
“La plus importante des leçons, c’est qu’il existe une manière de vivre qui ne nous livre pas à la peur.”
En tant que femme, vous avez dû créer votre propre espace à Hollywood. Jill Soloway et Lena Dunham, créatrices de Transparent et de Girls, ont montré la voie dans le domaine des séries.
Chaque fois que quelqu’un accomplit quelque chose, cela devient possible pour d’autres. Je me souviens du premier film de Jill Soloway, que j’ai vu à Sundance. Il racontait une relation entre deux femmes comme on n’en avait jamais vu auparavant : des femmes au foyer habitant un quartier chic, qui rencontrent une strip-teaseuse. Plus les femmes écriront et réaliseront, plus nos voix seront audibles. Zal me disait qu’en première année du département réalisation à l’American Film Institute, il y a maintenant autant d’étudiantes que d’étudiants. Il y a cinq ans, c’était inimaginable. Je pense aussi à la série Atlanta, de Donald Glover, ancrée dans la communauté afro-américaine de l’Amérique d’aujourd’hui. J’adore que des pans entiers du monde, qui étaient autrefois snobés par la fiction, sortent de l’ombre.
Quels sont vos rêves pour la suite ?
Certaines espèces animales ne sont pas capables de percevoir la lumière, même quand elle est là, ou n’entendent pas certains sons… eh bien, en tant qu’humaine, je me sens un peu comme cela. Je ne sais pas à quoi ressemblerait un organe qui aiderait à mieux percevoir, mais j’y pense tout le temps car il m’aiderait à créer. Créer, pour moi, c’est se débarrasser d’anciennes peaux au fur et à mesure qu’on avance, en essayant de façonner quelque chose d’essentiel pour soi. C’est essayer de toucher quelque chose qu’on n’a jamais touché avant, se regarder en profondeur, ce qui n’a rien de confortable.