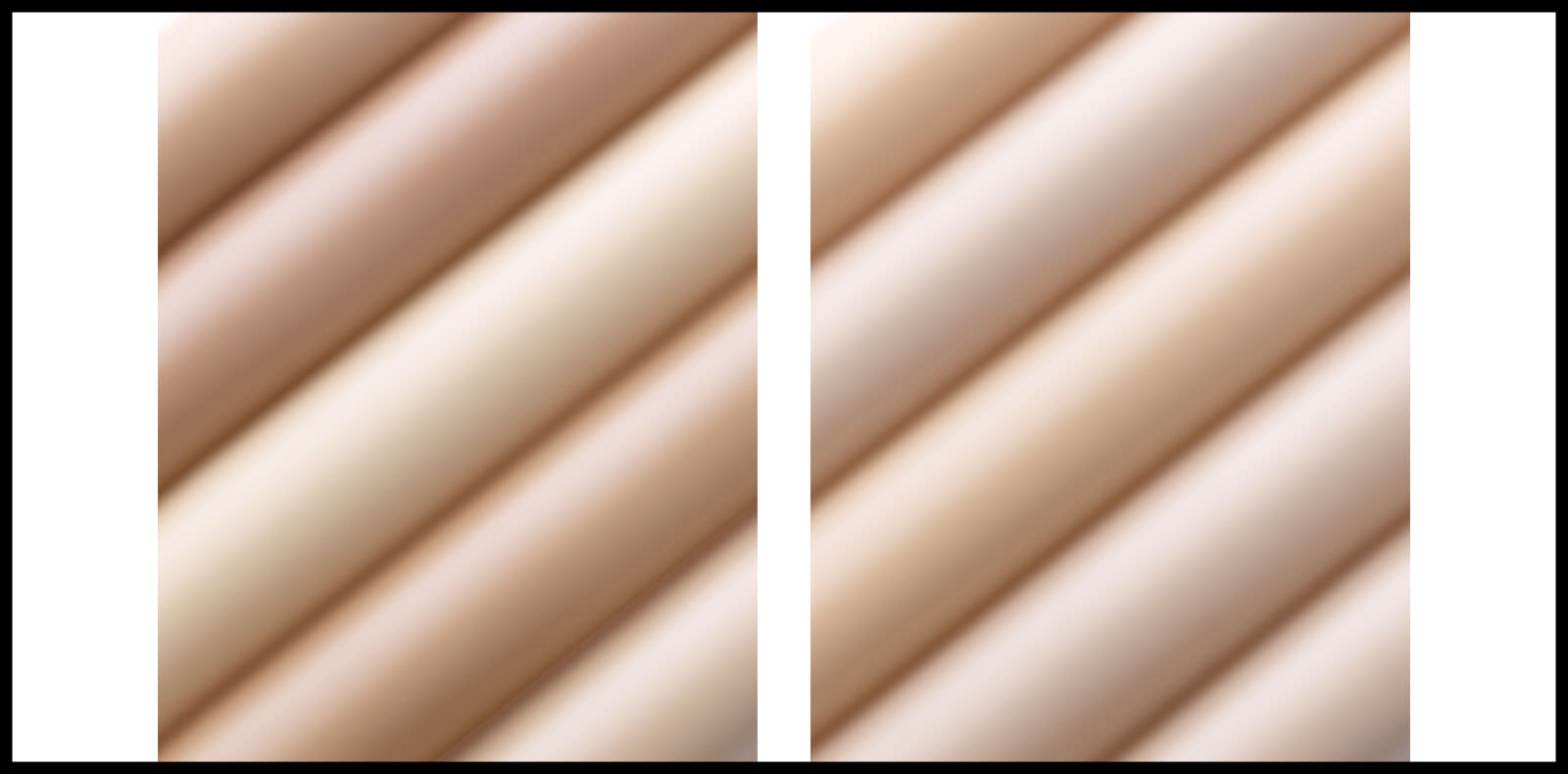5

5
Qui est Alex Katz, immense peintre américain trop longtemps sous-estimé ?
À l’occasion de son exposition “New Landscapes” à la Galerie Thaddaeus Ropac du Marais, Numéro revient sur sa rencontre avec l’artiste Alex Katz. Portrait d’un précurseur par Éric Troncy.
Par Éric Troncy.
Il a 89 ans et son exceptionnelle longévité artistique aura été bien utile à sa reconnaissance : c’est peu dire qu’Alex Katz n’a pas toujours eu le succès qu’il méritait. Lui qui clame depuis ses débuts que le style EST le contenu de sa peinture n’en a pour ainsi dire jamais changé. Imperturbable, il a traversé tous les grands courants artistiques avec une implacable froideur et, dans le meilleur des cas, certains se sont reconnus en lui. Artistes pop, minimalistes, conceptuels sont tous, en effet, redevables d’une manière ou d’une autre, à cet artiste, que seul un regain d’intérêt manifeste pour la peinture à la fin des années 90 fit considérer à nouveau. Ce regain d’attention fut le fait, en particulier, de jeunes artistes revisitant sans tabou les possibilités de la figuration picturale, d’Elizabeth Peyton à Peter Doig, dont les célèbres tableaux représentant des canoës sont des hommages appuyés à Alex Katz. Tous virent en lui un infatigable précurseur. Aujourd’hui salué par la critique et le marché comme l’une des figures saillantes de l’art du XXe siècle, qu’il a traversé allègrement, le compromis esthétique n’a cependant pas été son fort.
La première singularité de ses peintures est bien, en effet, de sembler n’offrir aucune prise au temps qui passe : difficile, en vérité, de dire si telle œuvre date des
années 60 ou des années 2000. A fortiori quand le sujet est indémodable : The Black Dress, une grande peinture de 1960, présente six femmes vêtues de la “petite robe noire” chère à toutes les garde-robes féminines. Plus sérieusement, c’est à peine si la manière de peindre la peau et les ombres indique qu’une telle œuvre a aujourd’hui plus de 50 ans. Bientôt, la trace du pinceau disparaîtra totalement dans la réalisation des portraits au profit d’aplats impeccables concourant à un style totalement épuré, proche, peut-être, de l’illustration.
Comme les artistes pop, mais avant eux, Katz ne s’est pas défendu de l’influence de la publicité, des grands panneaux d’affichage et de l’esthétique de l’ère des médias qui se mettait en place. Quand les artistes pop utilisaient les images ready-made de la société de consommation dont ils étaient environnés, Katz peignait, lui, les gens de son entourage, convoquant une facture aussi pure et simple que les images de bande dessinée qui feront le succès de Warhol ou de Lichtenstein. “Nous ressemblerions à ces préraphaélites qui contemplaient l’œuvre de Botticelli en oubliant celle de Piero della Francesca si, dans notre collection d’icônes, nous mettions celles de Lichtenstein et non celles de Rauschenberg, de Rosenquist et non de Rivers, ou de Wesselmann et non de Katz”, écrit rétrospectivement l’historienne d’art Lucy Lippard dans son ouvrage sur le pop art paru aux éditions Thames & Hudson, tandis que, dans la même collection, l’ouvrage consacré à l’art depuis 1960 ne parle même pas de lui.
Il faut dire que les sujets de la peinture de Katz ont eu matière à déconcerter les spécialistes : il peint, depuis les origines de son travail, ce qu’il voit, ce qui est autour de lui, enregistrant le monde comme une caméra de surveillance embarquée dans son quotidien – une préfiguration picturale littérale du Big Brother télévisé qui colonisera les écrans à la fin du XXe siècle. Ce qu’il voit : ses amis, les garden parties auxquelles il assiste (Réception sur l’herbe, 1989), et la nature dans laquelle est installé l’un de ses ateliers. Depuis 1949, en effet, invariablement, Alex Katz se retire de la fin du mois de juin jusqu’à la fin du mois de septembre dans l’atelier qu’il a acheté dans le Maine, en compagnie de son épouse, Ada, à qui il a d’ailleurs consacré un nombre impressionnant de toiles et qui reste l’un de ses principaux sujets. Depuis cette retraite estivale, il regarde inlassablement la nature, les couleurs de l’eau d’un ruisseau, le dessin formé par les troncs d’arbres dans une forêt. Il ne fait pas d’esquisses. De retour à l’atelier, il convoque ses souvenirs et les retranscrit sur de grands rouleaux de papier, cherchant à restituer un sentiment plutôt qu’une réalité – un procédé qui devait emporter l’adhésion, quarante ans plus tard, de photographes comme Jeff Wall. “Il est indispensable d’omettre certains éléments pour obtenir une peinture réaliste plutôt que ressemblante”, confiait Alex Katz au critique d’art Heinz Peter Schwerfel, qui réalisa plusieurs films sur lui, et le suivit lors de ses voyages qui le conduisent à la fin de l’été de l’atelier du Maine à celui de New York.
Là, il déploie sur le sol les rouleaux réalisés dans le Maine et s’attaque aux tableaux, des formats qui ont toujours, chez lui, été gigantesques, comme de très grands écrans de cinéma. Voir Alex Katz peindre est une expérience fascinante : l’homme est imposant, élancé, son visage est sévère et concentré. L’atelier résonne des notes feutrées d’airs de jazz qu’il écoute en peignant (avec une préférence marquée pour Stan Getz), il porte des vêtements clairs, monte sur des escabeaux pour atteindre le haut des toiles monumentales, et porte des gants pour ne pas se salir les mains. “J’ai commencé à porter des gants il y a dix ou quinze ans, explique-t-il avec nonchalance. Je ne suis pas un peintre très propre et je n’aime pas me salir les mains.”
Sa peinture est aussi simple que cela : elle envisage le monde qui l’entoure avec une forme évidente de sérénité et beaucoup de bon sens. Et qu’importe si les sujets qu’il choisit n’ont rien de véritablement exotiques : “La forme n’est pas importante, c’est la manière qui compte, dit-il. Le style est une manière consciente de présenter les choses. La peinture est une méthode tout à fait acceptable pour décrire sa vision du monde.” Et les questions de style, justement, ont toujours été centrales dans la famille de Katz : sa mère, Russe émigrée comme son père aux États-Unis dans les années 20, avait étudié le métier d’acteur à Odessa et se passionnait pour la poésie, qu’elle lui enseigna, en même temps qu’il avait, avec son jeune frère Bernard, de longues discussions sur la littérature, le théâtre et la mode.
Au début de sa carrière, ses cinq premières expositions ont été de cuisants échecs. Il subvenait à ses besoins grâce à un job à mi-temps dans un magasin d’encadrement et vivait “sans chauffage, sans jamais aller chez le médecin ou chez le dentiste ni acheter de vêtements”. Les temps ont changé, pas sa peinture.
New Landscapes d’Alex Katz, du mardi 5 au 30 juillet, à la Galerie Thaddaeus Ropac du Marais, 7, rue Debelleyme, Paris IIIe. Vernissage le mardi 5 juillet 2016, de 19 heures à 20h30