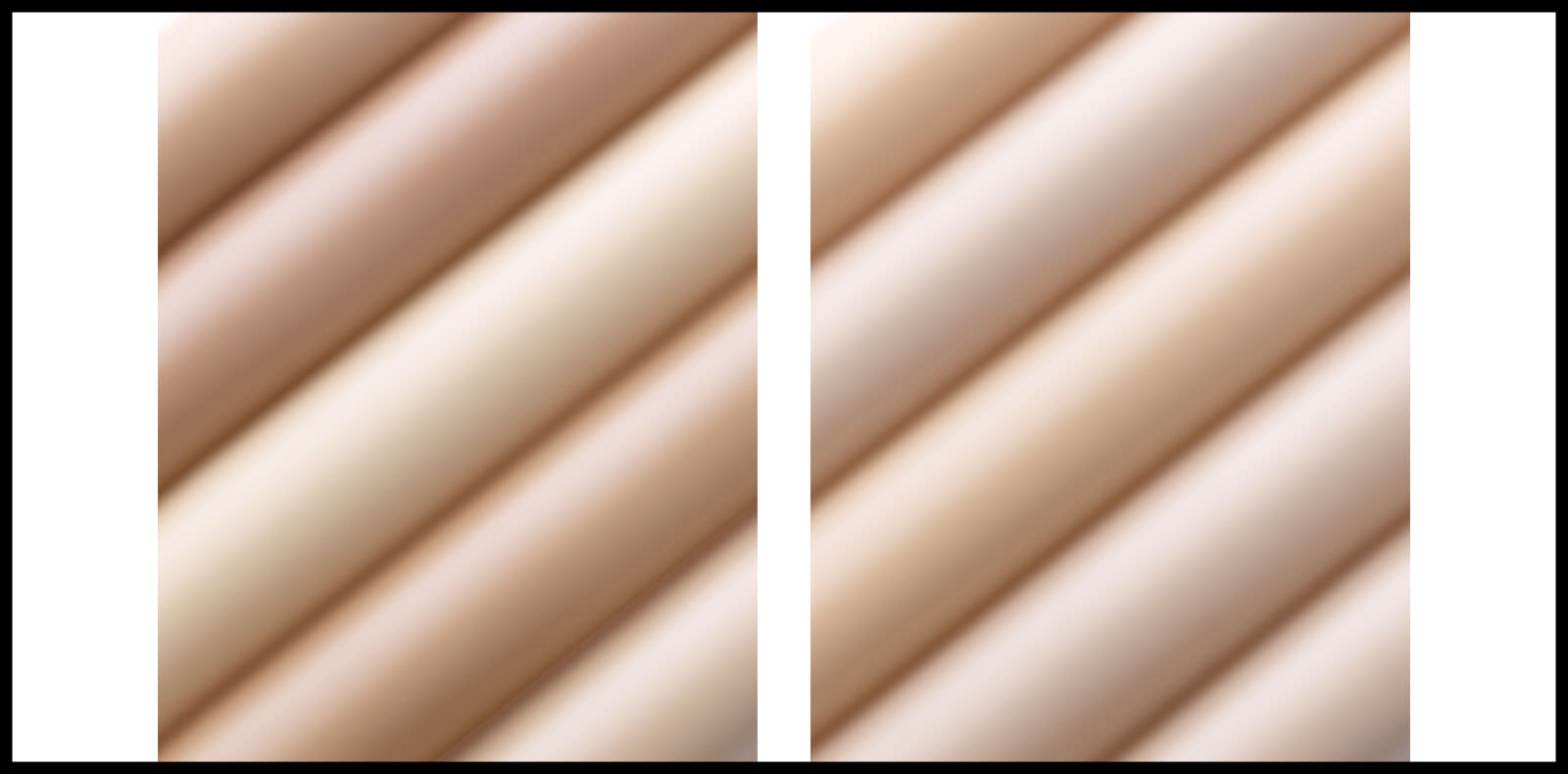4

4
“Les artistes femmes affrontent des critiques que l’on n’oserait pas faire à un homme.” Rencontre avec Maria Grazia Chiuri
Romaine d’origine, la directrice artistique de la maison Dior dialogue depuis toujours avec les créateurs de son pays. Elle partage avec Numéro art sa passion pour la création italienne mais aussi internationale, et son engagement féministe auprès des artistes femmes.
Propos recueillis par Gea Politi,
Portrait par Harry Gruyaert,
By Gea Politi,
Portrait Harry Gruyaert.

Numéro art: You greatly admire several Italian artists.
Maria Grazia Chiuri: I hold Carol Rama, Carla Accardi and Marisa Merz in very high esteem. I’m far from being a specialist, but I’m easily moved by art. I’m confident that one day these artists will gain wider recognition than they have now. Unfortunately, in Italy we tend not to promote our local talents. We’re so focused on elsewhere… For example, I think Italian Pop Art was overly eclipsed by American Pop Art. While Leo Castelli was showing the best artists in New York, we sorely lacked the equivalent in Rome. But I’m convinced that time will bring their dues to these important figures.
How do you explain this tendency in Italy?
In general we’re incapable of promoting our talents on the international stage – not only art, but also Italian cuisine, design, etc. Perhaps our inability to get organized is both our strength and limitation. We’re a nation of individualists, which pushes us to be creative and innovative, but doesn’t encourage us to unite behind our artists and chefs… I see the same thing happening in Italian fashion. And yet what makes Rome beautiful is that art is everywhere. At Valentino, we had an unforgettable experience organizing Mirabilia Romae; it gave us the opportunity to discover a hidden Rome. At one point we had the chance to visit Luigi Ontani’s studio. Ontani is an artist whose universe is pretty close to fashion. Just look at his costumes, ceramics, and paintings, even his personality. He has an exceptional ability to encapsulate the Zeitgeist.
As a native of Rome, how do you view the city’s artistic effervescence in the 60s and 70s? I’m thinking of figures like Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano and Giosetta Fioroni.
I adore them. I had the chance to work with Giosetta Fioroni at Valentino. She’s incredible, an emblematic figure of Italian art who always fought prejudice against women artists. She also belonged to the Piazza del Popolo School, which is why I feel close to her and her story, since it’s inseparable from my city’s story. I was impressed by her open-mindedness: she was curious about my ideas and wanted to understand the creative processes in fashion. Visiting her studio in Trastevere was a great discovery. I would also have liked to collaborate with Carol Rama, but unfortunately I was too late [Rama passed away in 2015]. There’s Alberto Burri too. I remember, during his centenary retrospective, I excitedly asked, “How much would it cost to restore the Cretto di Burri?” Everyone looked at me like I was crazy. I’d like to do something, it’s a monument to a catastrophe after all [the 1968 earthquake that destroyed Gibellina]. Italy’s most famous piece of land art is in a state of total abandon.
“I like collaborating with contemporary artists. They deal with subjects, in one way or another, affect us directly as women.”

Do you frequent the new generation of artists?
Yes. I discovered Pietro Ruffo in Rome when he exhibited an old aeroplane, and I fell under his spell. By chance, I had dinner with a collector who owns one of his globes. I asked for Ruffo’s phone number and went to meet him in his studio. I like his work a lot.
To the point of collaborating with him?
Yes, of course. In the archives, I discovered a book in which Christian Dior talks about the year 1957 – a decade after opening his fashion house – and his meteoric business success on an international level. He opened boutiques in London, New York, Havana… It’s astonishing to see the speed with which the brand was exported and globalized. His quest to make his label international and to break down frontiers fascinates me. When I went to see Ruffo, he was working on a project that used projections on globes and reflected on the fact that the earth has always known massive migration, and therefore a certain mixing of peoples. The path that led me where I am today was also like a migration, and considering this new possibility, I looked at Pietro and said, “We were made to get along famously!”
“Talking about fashion comes down to talking about women, in relation to their bodies, but also to society.”
I know you are very interested in Georgia O’Keeffe. Is she a source of inspiration for you?
While working on my last Dior collection, I did indeed find many sources of inspiration in the Georgia O’Keeffe show in New York [Living Modern, Brooklyn Museum, 2017]. It was particularly interesting because it didn’t focus so much on the work as on the shamanic artist herself.
Are you referring to the many portraits of her by Alfred Stieglitz, her husband, which are almost a parallel oeuvre to her painting?
These photos attest to Stieglitz’s fascination with his wife’s personality. They’re incredible. I wish I had a husband who photographed me like that! There’s a rare form of love, passion, and devotion in those photos.
Why is fashion so interested in artists these days?
Talking about fashion comes down to talking about women, in relation to their bodies, but also to society. That’s why I like collaborating so much with contemporary artists. They deal with subjects that, in one way or another, affect us directly as women.
“I have a certain responsibility in my role as the first woman to head Dior. I had to be completely prepared to broach subjects outside the limits of pure fashion but that are fundamental on a social level…”

Especially in her early career, Tracey Emin focused in a very conceptual way on the relationship between bodies and sexuality.
Now we’re getting down to the nitty gritty. Tracey and I had a long discussion when we first met in her studio. The first point she brought up regarding fashion was the size problem, the fact that a “normal” woman often feels uncomfortable. I have a certain responsibility in my role as the first woman to head Dior. I had to be completely prepared to broach subjects outside the limits of pure fashion but that are fundamental on a social level, all the while maintaining a playful rapport with it. We often forget that fashion has to be both be audacious and fun.
“The higher you go, the fewer women there are in leading positions” is a quote from a 2014 speech given by Nigerian writer Chimamanda Ngozi Adiche, who you know I believe. Is this statement is still true?
Chimamanda’s speech was very pertinent, delivered in a facetious, biting tone. I remember laughing so much during an interview with her in Los Angeles. We talked about her ability to dive into very serious concepts with humour. Perhaps it’s the solution to changing the way people think: taking a light-hearted approach, inverting viewpoints and fighting this image of feminist “furies.” I don’t like being thought of as angry when we’re simply concerned. I’m concerned for my children’s future and for future generations. That a woman who says what she thinks must be a strong woman is a very widespread stereotype. I think I’m pretty vulnerable, but I try to say what I think, even if it’s not easy. The sole fact of trying is perceived as a demonstration of strength. The women artists we’ve talked about, who weren’t afraid of exposing themselves, fascinate me. They faced criticism that no one would dare direct at a man. Works by these women, such as Tracey Emin’s Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995, were real punches to the gut.


Numéro art : Vous vouez une grande admiration à plusieurs artistes italiens…
Maria Grazia Chiuri : J’estime énormément Carol Rama, Carla Accardi et Marisa Merz. Je suis loin d’être une spécialiste, mais je me laisse facilement émouvoir par l’art. Je suis certaine que ces artistes seront un jour davantage reconnues qu’elles ne le sont aujourd’hui. En Italie, nous avons malheureusement tendance à ne pas promouvoir les talents locaux. Notre regard est tellement tourné vers les autres… Je trouve, par exemple, que dans les années 60 et 70, le pop art italien a été un peu trop éclipsé par le pop art américain. Au moment où Leo Castelli exposait les plus grands artistes à New York, on manquait cruellement d’équivalent à Rome. Mais je suis convaincue que le temps rendra justice à ces grands personnages.
Comment expliquez-vous cela?
De manière générale, nous sommes incapables de porter nos talents sur le devant de la scène internationale, en matière d’art, mais aussi de cuisine, de design, etc. Peut-être que notre incapacité à agir de façon organisée est à la fois notre force et notre limite. Nous sommes une nation d’individualistes, ce qui nous pousse à être créatifs et innovants, mais cet individualisme ne nous encourage pas à nous unir pour faire connaître nos artistes, nos chefs… Je le constate tout autant dans la mode italienne. Pourtant, ce qui fait la beauté de Rome, c’est que l’art est partout. Nous avons vécu une expérience inoubliable avec Valentino lorsque nous avons organisé Mirabilia Romae, ce parcours qui offrait l’opportunité de découvrir la Rome cachée. L’une de ces étapes permettait de visiter le studio de Luigi Ontani, un artiste finalement assez proche de l’univers de la mode. Il suffit de regarder ses tenues, ses céramiques, ses peintures, ou lui-même. Sa façon de saisir l’époque est exceptionnelle.
“On oublie trop souvent que la mode doit être à la fois audacieuse et divertissante.”
En tant que Romaine d’origine, quel regard portez-vous sur l’effervescence artistique de la ville dans les années 60 et 70? Je pense à des artistes comme Franco Angeli, Tano Festa ou Mario Schifano, qui ont développé un véritable univers artistique romain, sans oublier Giosetta Fioroni.
Je les adore. J’ai eu l’opportunité de travailler avec Giosetta Fioroni lors de mon passage chez Valentino. Elle est incroyable. C’est une figure emblématique de l’art italien, qui a toujours combattu les préjugés contre les artistes femmes. Et puis elle fait partie de l’école de la Piazza del Popolo, c’est pourquoi je me sens proche d’elle et de son histoire, car elles sont indissociables de ma ville. J’ai été impressionnée par son ouverture d’esprit; elle était curieuse de connaître mes idées et de comprendre les processus créatifs qui régissent l’univers de la mode. Visiter son atelier dans le Trastevere a été une grande découverte. J’aurais également souhaité collaborer avec Carol Rama, mais je m’y suis malheureusement prise trop tard [elle est décédée en 2015]. Je pense aussi à Alberto Burri. Je me rappelle que lors de la célébration de son centenaire, dans mon excitation j’ai dit : “Voyons, combien ça coûterait de restaurer le Grande Cretto de Burri?” Tout le monde m’a regardée comme si j’étais folle. J’aurais aimé apporter ma contribution, car il s’agit tout de même d’un monument dédié à une catastrophe [le tremblement de terre de Gibellina, en janvier 1968]. Il est complètement à l’abandon, alors que cette pièce de land art est la plus célèbre d’Italie.
“J'aime collaborer avec les artistes contemporains parce qu’ils traitent de sujets qui, d’une manière ou d'une autre, nous affectent directement en tant que femmes.”

Fréquentez-vous aussi la nouvelle génération d’artistes?
Oui, j’ai ainsi découvert Pietro Ruffo à la Galerie communale d’art moderne de Rome, où il exposait un aéroplane, et je suis tombée sous le charme. Le hasard veut que je sois allée dîner chez un collectionneur qui possède l’un de ses globes terrestres. J’ai donc pris son numéro de téléphone et suis allée le rencontrer dans son atelier. J’aime beaucoup son travail.
Au point de collaborer avec lui?
Bien sûr. Dans les archives, j’ai découvert un livre dans lequel Christian Dior évoque l’année 1957 – soit dix ans après l’ouverture de sa maison – et le succès fulgurant de son entreprise à l’international. Il a ouvert des boutiques à Londres, à New York, à La Havane… Il est étonnant de voir la rapidité avec laquelle la maison s’est exportée, globalisée. Ce souci de mondialiser sa marque, d’effacer les frontières, m’a semblé fascinant. Lorsque je suis allée voir Pietro Ruffo, il travaillait justement sur un projet qui incluait des projections sur des globes terrestres et une réflexion sur la façon dont le monde a toujours connu des phénomènes de migration importants, et donc un certain métissage. Le chemin qui m’a menée jusqu’ici a aussi été une sorte de migration, et devant cette nouvelle étape, cette nouvelle possibilité, j’ai regardé Pietro et me suis exclamée : “Nous étions faits pour nous entendre!”
“En tant que première femme à la tête de la maison Dior, j’avais une certaine responsabilité. Il me fallait être parfaitement préparée à aborder des thèmes éloignés de la mode pure, mais fondamentaux du point de vue social…”
Je sais que tu t’intéresses beaucoup au travail de Georgia O’Keeffe. A-t-elle été une grande source d’inspiration pour toi?
Lors de mon travail sur la dernière collection que j’ai dessinée, j’ai effectivement trouvé beaucoup de sources d’inspiration dans l’exposition de Georgia O’Keeffe à New York [Living Modern, au Brooklyn Museum, en 2017]. Celle-ci était particulièrement intéressante, car elle ne mettait pas directement en avant les œuvres, mais plutôt l’artiste chamane.
Tu veux parler de ses nombreux portraits réalisés par son mari, le photographe Alfred Stieglitz, qui constituent presque un travail parallèle à sa pratique?
Ces photos montrent l’intérêt qu’il témoignait pour la personnalité de sa femme. Elles sont incroyables. Comme je voudrais avoir un époux qui me photographie de cette manière! Il y a un amour, une passion, un dévouement que l’on voit rarement.

Pourquoi la mode s’intéresse-t-elle autant aux artistes d’aujourd’hui?
Parler de mode revient à parler des femmes, de leur rapport au corps, mais aussi à la société. C’est la raison pour laquelle j’aime collaborer avec des artistes contemporains. Ils traitent de sujets qui, d’une manière ou d’une autre, nous affectent directement en tant que femmes.
L’artiste Tracey Emin s’est beaucoup consacrée, surtout dans les premières années de sa carrière et sur un plan conceptuel, au rapport entre corps et sexualité…
Nous voilà au cœur du sujet. Nous avons beaucoup échangé avec Tracey lors de notre rencontre dans son atelier. Le premier sujet qu’elle a pointé quand nous avons parlé de mode était le problème des tailles, le fait qu’une femme “normale” se sente souvent mal à l’aise. En tant que première femme à la tête de la maison Dior, j’avais une certaine responsabilité. Il me fallait être parfaitement préparée à aborder des thèmes éloignés de la mode pure, mais fondamentaux du point de vue social… tout en maintenant un rapport ludique avec elle. On oublie trop souvent que la mode doit être à la fois audacieuse et divertissante.
Quand vous parlez de jeu avec la mode, je pense aux photographies de Cindy Sherman et à sa façon de se transformer grâce au vêtement.
Bien sûr. Cindy Sherman s’intéresse à la manière dont les femmes doivent revêtir plusieurs identités pour s’adapter au monde dans lequel nous vivons. Ce sont des thèmes très liés à la mode et à la société actuelles.
“The higher you go, the fewer women there are in leading positions” [plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes aux postes de dirigeants] est une phrase extraite d’une conférence donnée en 2014 par l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, dont vous êtes proche, je crois. Pensez-vous que cette affirmation se vérifie encore?
Chimamanda Ngozi Adichie s’est montrée très juste au cours de ce discours, en adoptant un ton impertinent et mordant. Je me souviens d’une interview avec elle à Los Angeles, nous avons beaucoup ri. Nous avons justement parlé de sa capacité à approfonfir de manière amusante des concepts très sérieux. C’est peut-être la solution pour faire évoluer les esprits. Il faut adopter une approche plus humoristique, en inversant les points de vue et en combattant cette image des “furies” féministes. Je n’aime pas que l’on pense que nous sommes enragées, nous sommes simplement préoccupées. Le stéréotype qui veut qu’une femme qui dit ce qu’elle pense est une femme forte est très répandu. Je crois être assez fragile, et pourtant j’essaie de dire ce que je pense, même si ce n’est pas facile. Le seul fait d’essayer est perçu comme une démonstration de force. Je suis fascinée par les artistes femmes dont nous avons parlé, qui n’ont pas hésité à se mettre en danger. Elles ont, avec courage, affronté des critiques que l’on n’aurait pas osé faire à un homme. Les premières œuvres de Tracey Emin, comme Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 [l’intérieur d’une petite tente était entièrement couvert des noms des personnes avec lesquelles elle avait “dormi” au cours de sa vie], furent, à l’image du travail de ces figures artistiques, de vrais coups de poing.