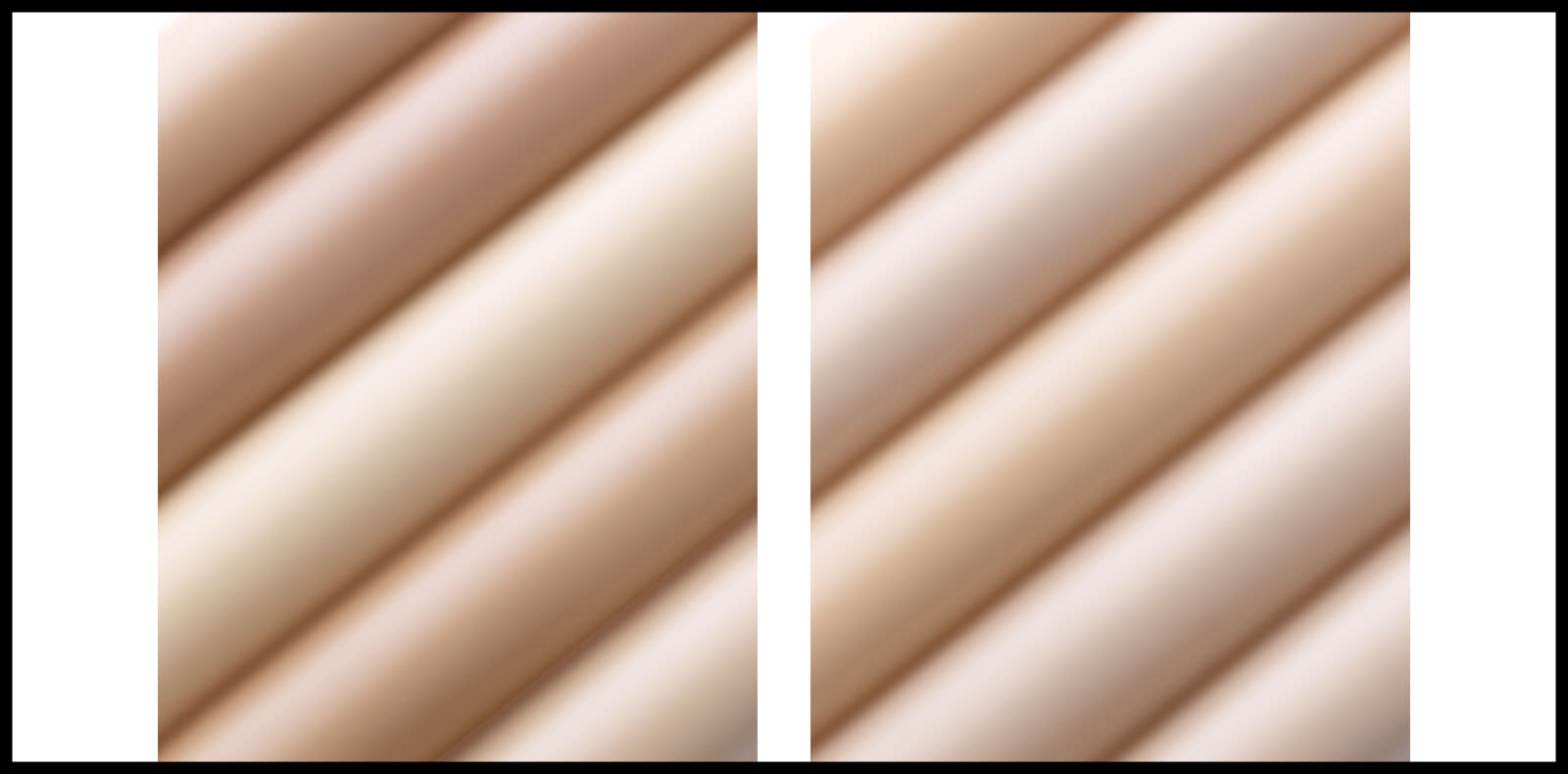2

2
Dans l’atelier de… Camille Henrot
Jeune Française de 37 ans, Camille Henrot est déjà une artiste accomplie. De sa consécration à la Biennale de Venise en 2013 au prix Edvard Munch en 2015, sa reconnaissance est internationale. Numéro l’a rencontrée dans son atelier à New York.
Propos recueillis par Thibaut Wychowanok.
Numéro : Vous êtes installée à New York depuis quelques années déjà. Est-ce que la culture américaine a nourri votre pratique artistique ?
Camille Henrot : Aux États-Unis, il y a une culture de l’excès, de l’abondance et de la décadence… quelque chose comme Rome au XVIIe siècle. J’apprécie le baroque de la culture américaine, et la manière dont les mythes et les archétypes sont sans cesse manipulés et déconstruits. On observe surtout cela dans le hip-hop, mais aussi dans les comédies (à la télévision et dans les online comedy shows). En réalité, je me nourris surtout de l’inconfort que me provoque l’Amérique : le puritanisme, la voracité économique, l’ethnocentrisme culturel, la lâcheté du politiquement correct qui masque un vrai racisme et un conformisme social, la culture policière qui s’étend au milieu académique au travers, notamment, de ce que Michel Foucault dénonçait déjà en 1968 dans son texte D’où tu parles ? Une culture de la délation et du “pointing finger at”, et une absence de nuances qui empêche un véritable questionnement éthique au profit d’un dogmatisme policé ou d’une pensée bipolaire, fondée sur l’exclusion.
En quoi est-ce si différent en France ?
En France, il y a une vraie culture de la complexité, le goût du débat et de l’échange d’idées, mais aussi une fascination pour l’échec et – c’est un cliché – une vraie méfiance, voire une hostilité à l’égard du succès. Cela rend sans doute les gens plus prudents et subtils, mais aussi moins audacieux. Dans le milieu de l’art contemporain, les États-Unis sont très dominés par le marché. Mais c’est si évident qu’une vraie contre-culture existe et qu’il est assez facile, et même naturel, de passer outre.
Parmi les exigences françaises envers l’art contemporain, on trouve également celle qui voudrait que l’art révèle toujours une vérité.
ll y a une attente presque religieuse vis-à-vis de l’art en France. On attend de l’art une révélation. Il se doit de dévoiler des aspects essentiels de l’expérience humaine. Mais je crois que cette attente est raisonnable. L’art doit apporter une solution aux problèmes de l’existence humaine.
L’art n’est-il pas plutôt là pour poser des questions plutôt que pour apporter des réponses ?
Apporter une solution n’est pas forcément apporter une réponse. Si l’un de vos amis vient vous parler d’un problème important, qu’il est très angoissé, vous n’allez pas forcément lui dire ce qu’il faut faire et lui apporter une réponse définitive. Mais vous allez lui raconter une histoire un peu similaire. Cette histoire le renseignera et l’aidera à affronter son propre problème. C’est exactement ce que font les romans, les films ou les tableaux. Les œuvres d’art subliment les problèmes humains. Et une fois qu’ils sont sublimés, ils sont plus faciles à supporter et à accepter.
L’œuvre d’art laisse-t-elle toujours les interprétations ouvertes ?
Plus une œuvre est opaque, plus elle est complexe, plus elle est ambivalente et plus elle est stimulante pour l’esprit de la personne qui la regarde. Faire l’expérience d’une œuvre, c’est faire l’expérience de la vie dans sa dimension désordonnée, dans la manière qu’elle a de toujours vous surprendre et de déjouer vos attentes pour, au final, vous obliger à sortir de vos schémas d’action et de pensée préétablis.
Cette idée de désordre, justement, d’une vie désordonnée et foisonnante, se retrouve dans vos œuvres. La vidéo Grosse Fatigue, qui vous a valu le Lion d’argent à Venise en 2013, accumulait sans fin les images comme sur un écran d’ordinateur…
Le rapport entre l’ordre et le désordre, la structure et l’absence de structure, traverse mon travail et ma vie. Aussi bien lorsque j’organise mon studio ou mon emploi du temps que quand je réfléchis à un projet. Je suis très anxieuse, alors, évidemment, j’aime l’image de l’ordre parfait. Lorsque tout est archivé dans mon studio sur les bonnes étagères, au bon endroit, j’ai l’impression que mes angoisses sont rangées, chacune avec sa petite étiquette, et qu’elles ne sont plus menaçantes. Mais je suis aussi très impulsive et très intuitive. Je n’arrive pas à accepter l’ordre que je m’impose à moi-même. Je le conteste à mesure que je le construis. Je fabrique un système en même temps que je le défais. Et finalement, qu’en reste-t-il ? Il reste l’idée qu’une structure est nécessaire, mais qu’en son sein un certain nombre de libertés et de variations doivent toujours être possibles. Je refuse les systèmes fermés. C’est pour cela que je préfère parler de schémas ouverts quand il est question de mon processus de création.
Comment travaillez-vous ? Avez-vous une idée précise lorsque vous abordez un projet ?
Mon processus de création n’est jamais linéaire. Il se nourrit de ses propres échecs. Je me sens assez proche de Proust qui passe son temps à écrire qu’il n’arrive pas à écrire. Je passe beaucoup de temps à penser, à formuler une proposition et à l’abandonner. Puis à y revenir. Je ne sais jamais, jusqu’au dernier moment, ce à quoi je vais aboutir. J’aime beaucoup regarder mes notes, a posteriori. Quelquefois, je m’aperçois que tout était là quatre ans auparavant. Les idées reviennent souvent me hanter comme des fantômes… Alors j’essaie de tout noter dans mes carnets. Je les numérote. Là, j’en suis au n° 74. Ils me rendent totalement paranoïaque. J’ai toujours l’impression d’en avoir perdu un. Comme ceux qui ont peur d’avoir perdu leurs clés ou leur téléphone. Mon insécurité concernant ma capacité à gérer la vie quotidienne est intense. En même temps, c’est une occasion permanente de se réjouir, une panique suivie d’un soulagement : Ô joie, le téléphone est dans mon sac !
Qu’est-ce qui vous pousse à créer ?
Mes émotions et la nécessité de vivre avec elles : la colère, le désir essentiellement, mais aussi, dans une certaine mesure, la peur. Parfois, je commence à dessiner une chose ou une personne que j’aime, et puis je suis envahie par la colère et cela contamine le dessin. Associer les choses que j’aime à celles qui m’agacent est peut-être une manière de les conjurer, d’apprivoiser ma propre contrariété. Le sadomasochisme est très présent dans mes dessins. Plus généralement, la question des relations de pouvoir et de domination est au cœur de mon travail. Je suis fascinée par la symétrie entre le dominant et le dominé, et la manière dont toute relation binaire est instable… et finit par provoquer un renversement des rôles. Deux, c’est l’oppression et la révolution. Trois, c’est la stabilité. En ce moment je réfléchis beaucoup à ces questions à cause de mon chien. Le dog trainer m’a dit que c’était une femelle alpha. Sa manière d’alterner entre une attitude de domination et de soumission (quand c’est utile) me fascine.
Camille Henrot est représentée par la galerie Kamel Mennour à Paris,