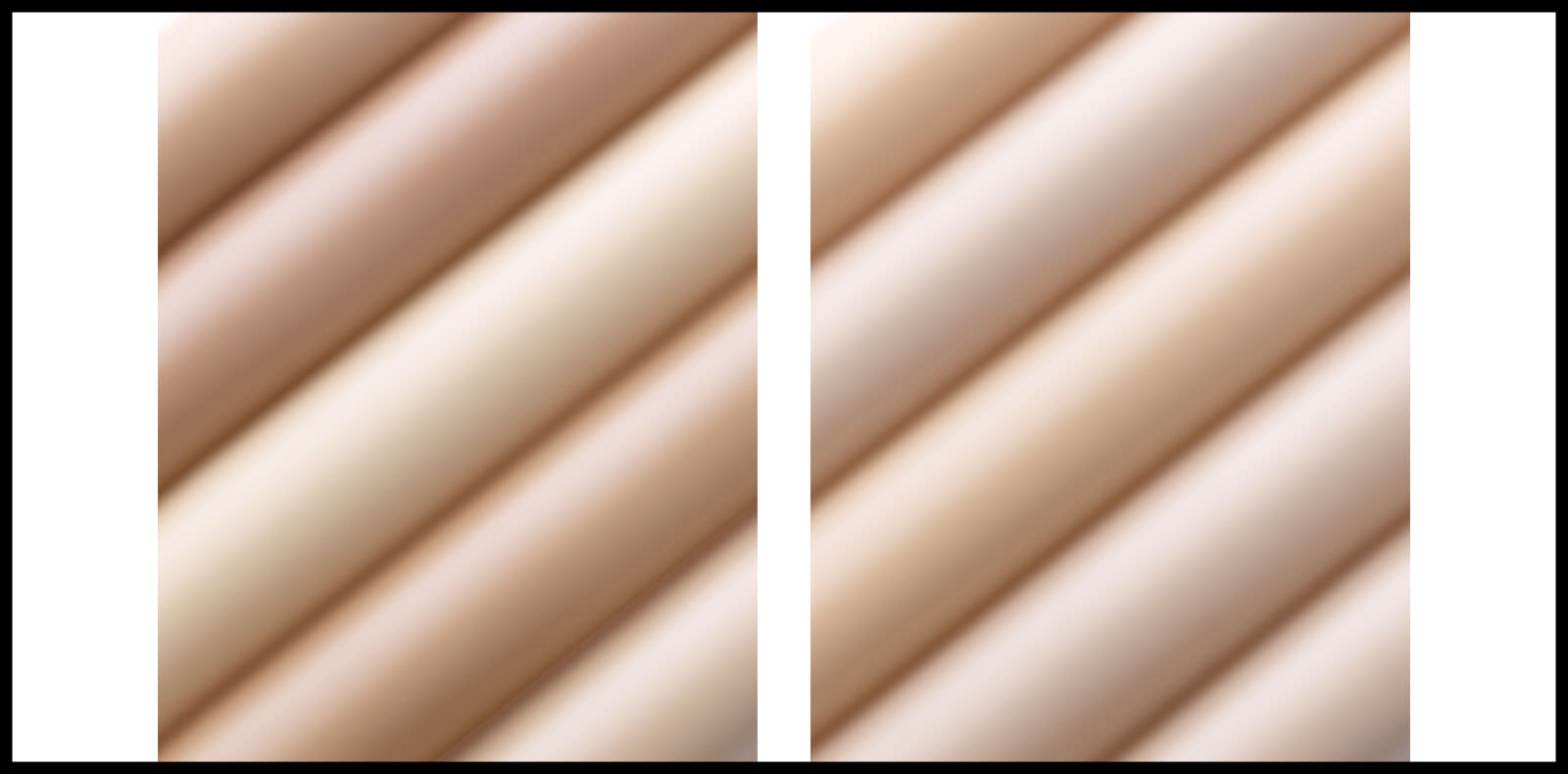21

21
Comment George Condo mêle fake news et histoire de l’art dans ses fresques monumentales
Dans ses toiles immenses saturées d’informations, l’Américain George Condo convoque les convulsions du monde contemporain. Des fresques ponctuées de nombreuses références à l’histoire de l’art. Rencontre.
Par Nicolas Trembley.

Life is Worth Living – “La vie vaut la peine d’être vécue”– est le titre de l’exposition personnelle de George Condo récemment présentée à la galerie parisienne Almine Rech. Ce titre a été inspiré d’un courrier adressé par George Condo à son ami de longue date, le collectionneur Bernard Ruiz-Picasso (petit-fils du peintre), dont il fut un grand familier au début des années 80, à New York. L’œuvre de Condo comporte de nombreuses références à Pablo Picasso et, comme celle du maître, s’inscrit dans un dialogue perpétuel avec les œuvres du passé. Pour lui, en effet, les artistes contemporains n’existent qu’en référence à ceux qui les ont précédés, lesquels, de leur côté, continuent d’exister grâce à ceux du présent. L’exposition chez Almine Rech confronte des œuvres des années 90 à d’autres plus récentes, qui mesurent plus de cinq mètres de long et sont saturées d’informations, évoquant justement des sujets très actuels comme l’obsession pour les médias, la politique et les fake news. Nous avons rencontré George Condo lors de la préparation de son exposition parisienne.
Numéro : Quel a été votre parcours ?
George Condo : J’ai suivi pendant deux ans des études d’histoire de l’art et de musicologie à l’université du Massachusetts, puis je suis parti pour New York, à la fin de l’année 1979. Du côté de mon père, j’ai des racines italiennes. Mon grand-père était originaire de Rome et mon père a grandi à Florence. Enfant, j’allais souvent au cabinet de mon grand-père (il était médecin) où je passais la journée à faire des dessins. Au xixe siècle, nous avions quelques artistes dans la famille, dont un assez important qui s’appelait Salvatore Albano Barca. Il était sculpteur et, à l’époque, son travail était exposé au Metropolitan Museum, à New York, ou au musée des Beaux-Arts de Philadelphie. Aujourd’hui, la seule pièce qui soit encore visible hors d’Italie se trouve, à ma connaissance, dans l’atrium du Brooklyn Museum. Son neveu, Concesso Barca, était sculpteur lui aussi et, lorsque mon père est décédé, j’ai hérité d’une sculpture de cet artiste.
”Je me vois plutôt comme un ‘soliste’ dans le monde de l’art”
Comment avez-vous pris conscience que vous vouliez être artiste ?
J’ai toujours eu une production artistique, et tout le monde répétait que j’étais un artiste. À 20 ans environ, j’ai fini par le croire. J’ai alors tenté de me forger une culture plus solide en étudiant l’histoire, la musique et la philosophie – l’exacte composition de tout art véritable. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à associer à mon travail les termes de “faux maîtres anciens”.
Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec l’art ?
Elle s’est produite quand j’avais 4 ans… En rentrant de la messe, une fois arrivé à la maison, j’ai dessiné une crucifixion. Ma mère l’a conservée, et elle sera d’ailleurs exposée au musée d’Art moderne de Louisiana, au Danemark.
Votre travail est aussi une relecture de l’histoire de l’art…
Mon travail se développe à partir de souvenirs, de certaines représentations qui surgissent dans mon esprit. Je leur donne alors une forme matérielle, telles que je les vois, et, souvent, elles semblent en effet constituées par l’agrégation de nombreuses particules d’histoire de l’art, réunies en une seule image.

Dans les années 90, le psychanalyste Félix Guattari a écrit sur votre œuvre. À votre propos, il parle de déconstruction. Quel sens cela a-t-il pour vous ?
Félix Guattari et moi-même avons passé de longues heures à discuter de la façon dont les choses peuvent morphologiquement se transformer en d’autres choses, et j’ai commencé à envisager la déconstruction comme un terme un peu dépassé pour décrire le processus de transformation qui se produit lorsque l’image mentale se change en image physique. L’ironie a voulu que nous le déconstruisions ensuite. La voie de la reconstruction a alors été engagée pour rebâtir une machine entièrement nouvelle à partir des pièces détachées d’une autre.
Dans l’exposition proposée chez Almine Rech, on retrouve des thèmes actuels comme les médias ou la politique. Pourquoi ces sujets ?
Chez Almine Rech, les médias et la politique sont les sujets de toiles de réalité abstraite. Ils n’en constituent pas la substance… La substance, c’est l’utilisation du geste, de la forme et de la ligne pour saisir l’illusion fugace de ce à quoi nous sommes soumis par l’intermédiaire des médias. Les États-Unis ont touché le fond avec ce nouveau gouvernement, et les artistes sont les seuls à pouvoir rendre compte de la réalité dans sa vérité, à travers les œuvres qu’ils produisent.
Comment choisissez-vous les titres de vos œuvres ?
Pour les œuvres récentes, je choisis des “formules accrocheuses” puisées dans les médias, mais, en définitive, j’observe plutôt l’œuvre en question, et c’est elle qui me dit comment elle veut s’appeler. Je ne commence jamais par le titre.
De quoi voudriez-vous faire prendre conscience au public à travers votre pratique ?
Je voudrais que les gens mesurent à quel point la vie est faite d’un réseau imbriqué de cultures et de croyances diverses, dont chacune à une importance équivalente. Dans la notion d’humanité, il n’y a pas de hiérarchies. C’est aussi pour cela que je ne fais aucune distinction entre les matériaux que j’utilise dans mes toiles. Peu importe qu’il s’agisse d’huile, de pastel, de crayon ou de craie grasse – ce qui compte, c’est ce que vous en faites.
De qui vous sentez-vous proche aujourd’hui ?
Je me vois plutôt comme un “soliste” dans le monde de l’art. Mais j’admire le travail de Paul McCarthy, Photos Rashid Johnson ou encore Anne Imhof. Ainsi que les œuvres de Christopher Wool.