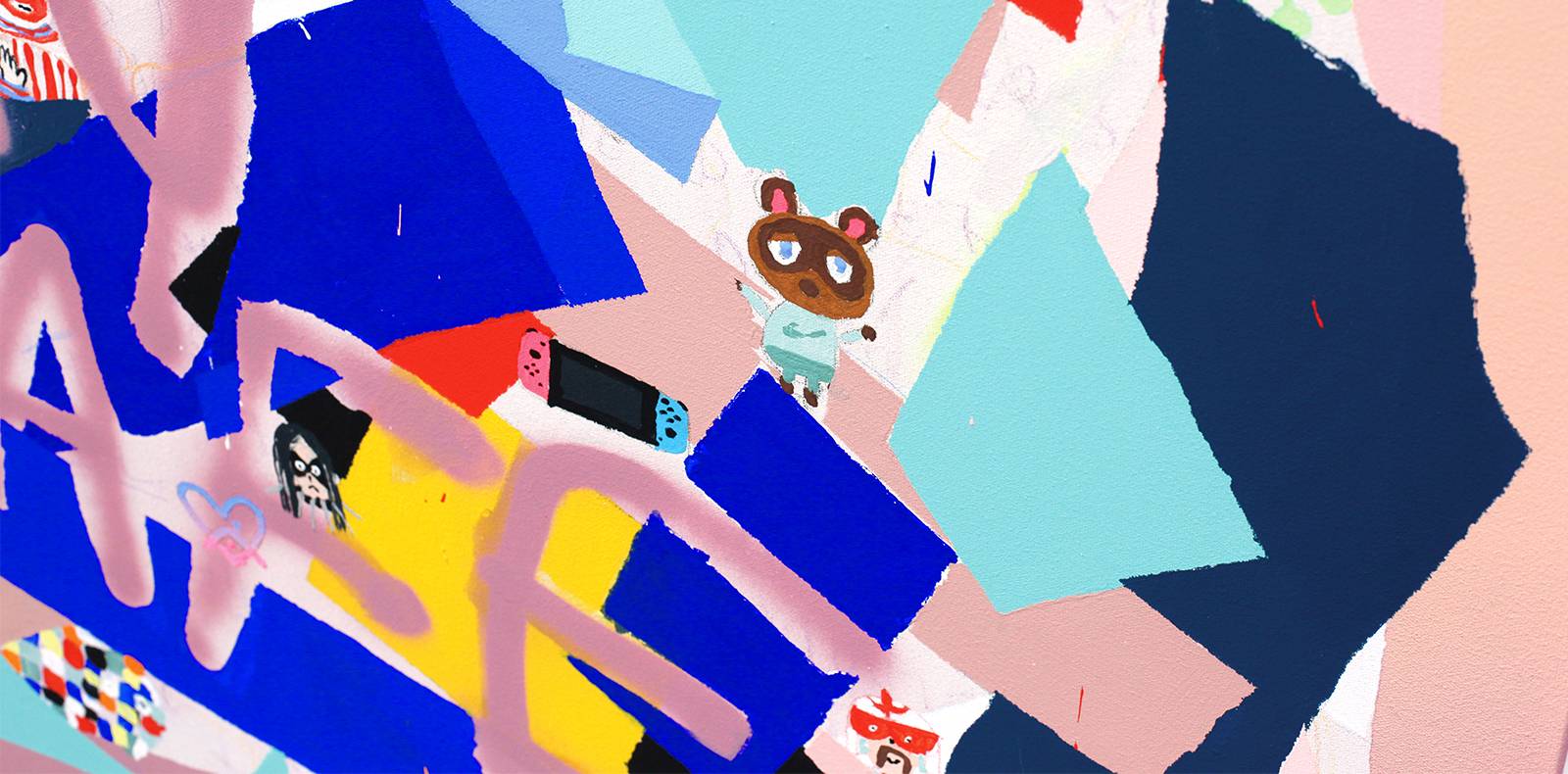3

3
Comment “Minari” a-t-il conquis Hollywood ?
Produit par Brad Pitt, le long-métrage sur l’arrivée d’une famille sud-coréenne sur le sol américain brille par sa douceur et la subtilité avec laquelle il aborde la thématique de la quête d’intégration.
Par Chloé Sarraméa.
À la sortie de Minari en France, le 23 juin 2021, il semble impossible d’occulter le parcours effectué par le film à travers le monde depuis sa présentation à Sundance, en janvier 2020. Même si, pendant des mois, il n’a pas pu être montré au public du fait de la pandémie, le long-métrage produit par Brad Pitt – avec sa société de production fondée en 2004 Plan B Entertainment (The Tree of Life, 12 Years a Slave) – a beaucoup fait parler de lui outre-Atlantique, s’attirant les louanges de tout Hollywood. Deux prix à Sundance, un Golden Globe du “Meilleur film en langue étrangère”, plusieurs nominations aux Oscars, une statuette de la “Meilleure actrice dans un second rôle” pour Youn Yuh-jung et un discours du jeune comédien Alan Kim, en larmes, devenu viral sur Internet… On s’attendait, dans l’Hegaxone, à un long-métrage majestueux. On n’a pas été déçus.
Signé de l’Américain d’origine coréenne Lee Isaac Chung, Minari pourrait se résumer à une simple autobiographie, née de la volonté d’un cinéaste de se raconter à travers ses racines, ses souvenirs d’enfance et notamment l’histoire de ses parents, deux immigrés coréens venus chercher bonheur et prospérité sur le sol américain. Mais, grâce à une mise en scène délicate surtout centrée sur un personnage ultra attachant, David – le jeune fils du couple devant s’habituer à cette nouvelle vie dans le pays de l’Oncle Sam –, Minari parvient avec habileté à conjuguer plusieurs thématiques, dont la cohabitation familiale, la recherche d’identité et la quête d’intégration.
Au début des années 80, Jacob Yi (Steven Yeun), sa femme Monica (Hen Ye-ri), et leurs deux enfants, s’installent dans un mobil-home planté dans un bourg du fin fond de l’Arkansas. Le couple est engagé dans une usine de sexage de poussins pour subvenir aux besoins de la famille tandis que leurs jeunes enfants, récemment scolarisés dans une école américaine, se voient vite livrés à eux-mêmes. Pour échapper à cette précarité, le père décide d’entamer une culture de légumes asiatiques (très prisés par la communauté coréenne en Arkansas) sur son lopin de terre et sa femme, souffrant du manque de sa mère restée en Corée, la fait venir habiter avec elle afin de s’occuper de ses petits enfants. Cette dernière, pas tout à fait à l’aise avec la langue de Shakespeare, est chargée de veiller sur le petit David (Alan Kim), qui souffre d’une maladie du cœur…
Par le prisme (audacieux) de la culture des légumes, et notamment à travers l’acharnement du père, qui se tue à la tâche, oscillant entre son activité à l’usine et son travail de la terre qu’il ne parvient pas à rendre fertile, Lee Isaac Chung raconte une quête d’intégration douloureuse, une poursuite du bonheur et une volonté d’adhésion à l’American way of life, quel qu’en soit le prix. Ce coût se matérialise ici, pour le personnage de Jacob, par des nuits passées à bêcher et à piocher et une obsession maladive pour l’eau – avec l’aide d’un voisin loufoque, un ancien soldat brisé par la guerre de Corée, il cherche par tous les moyens à creuser un puit viable permettant d’irriguer tous ses plants. Si les langues anglaises et coréennes se mélangent dans les dialogues, brouillant parfois les pistes de l’appartenance à telle ou telle culture, le réalisateur oppose, par petites touches, les différences. Dans des scènes où la famille se rend à la messe, les Américains l’observent comme un object exotique, ou carrément une curiosité, questionnant leurs habitudes alimentaires et la nourriture asiatique, alors qu’eux se gavent de Coca…
Évoquant avec brio la question de la difficile cohabitation entre les générations à travers l’arrivée de la grand-mère loufoque, qui parle uniquement coréen et n’a aucun moyen de converser avec ses petits enfants, Lee Isaac Chung dresse un beau portrait familial, sur fond d’une Amérique parfois trop policée, mais sans aucun doute fidèle à ses souvenirs d’enfance.
Minari (2021) de Lee Isaac Chung, actuellement en salle.