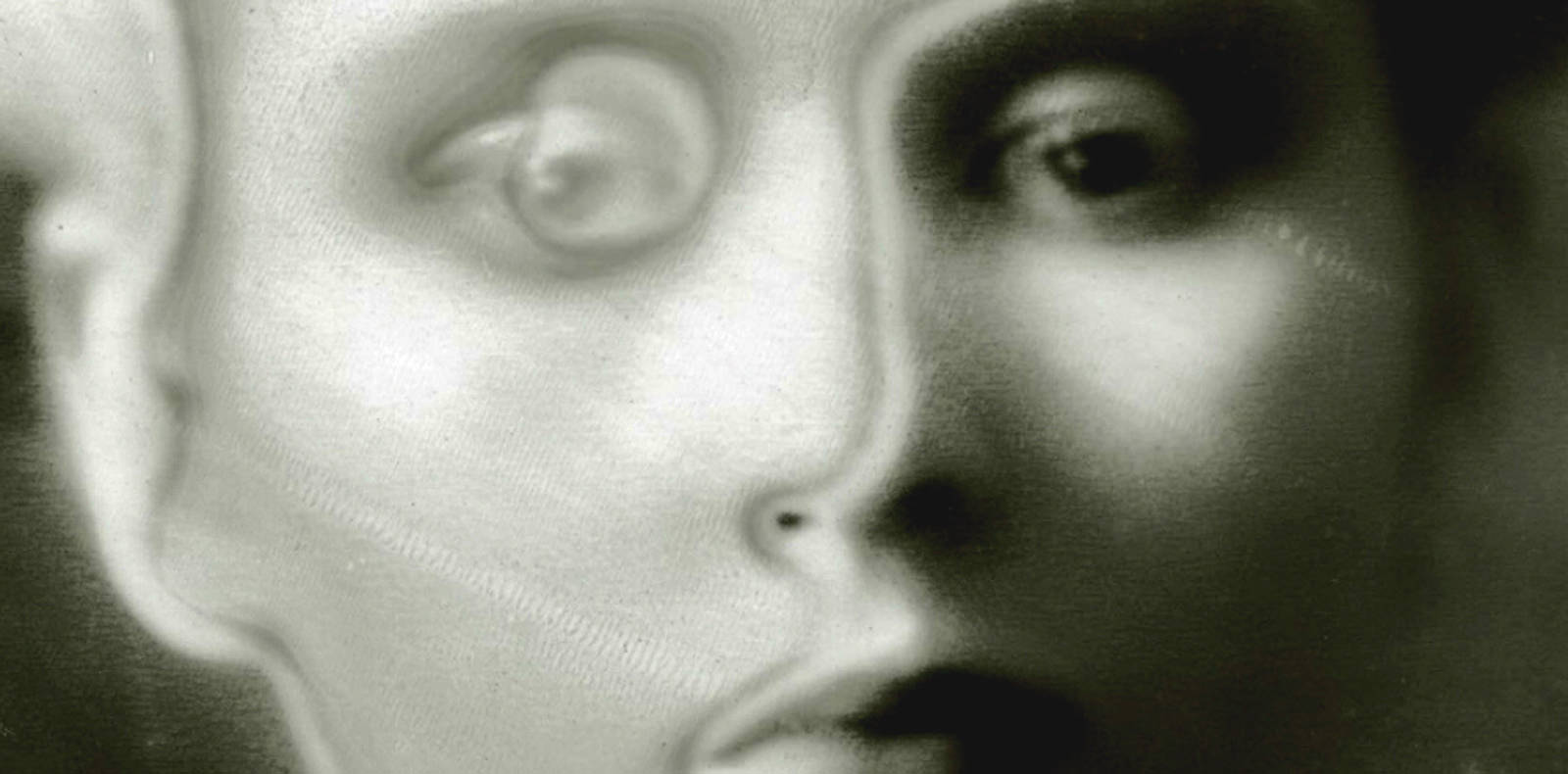16

16
“Ses films incarnent le XXe siècle.” Rencontre avec Jan Harlan, bras droit de Stanley Kubrick
C’est dans son manoir anglais de Saint Albans que le sulfureux réalisateur américain Stanley Kubrick, auteur de Lolita (1962), Docteur Folamour (1964), Orange Mécanique (1972) ou Eyes Wide Shut (1999), a pensé et élaboré son œuvre. Jan Harlan, son ami et producteur exécutif, y a gardé intacts son bureau, ses archives et ses souvenirs. Alors qu’une version remasterisée du deuxième long-métrage de Kubrick, Le baiser du tueur (1955) sort au cinéma cette semaine, Numéro revient sur sa rencontre inoubliable avec le complice du cinéaste culte, à la fois beau-frère, bras droit et confident.
Propos recueillis par Jonathan Wingfield.

Le 17 janvier, les salles de cinéma accueillent une œuvre toute particulière: une version remasterisée du deuxième long-métrage de Stanley Kubrick : Le Baiser du Tueur. Le premier film noir du maître Kubrick, son fameux thriller fortement influencé par les polars de Hitchcock et les productions du cinéaste austro-hongrois Fritz Lang. Entre ombres et lumières, le réalisateur livre le résultat de dix mois de tournage effectués sans aucune autorisation dans les rues new-yorkaises (la légende raconte qu’il aurait même corrompu des brigadiers afin qu’ils le laissent tourner une scène). Un film indépendant dans tous les sens du terme, construit avec un budget dérisoire, mais avec la minutie et le perfectionnisme légendaires du réalisateur. À la sortie du film, en 1955, les critiques sont subjugués : le travail autour de la narration et de la lumière est digne d’un virtuose. Malgré tout, l’utilisation de la voix off le dessert, une facilité aussi déconcertante que superflue. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui voient en ce deuxième long-métrage une histoire d’amour banale, un film assez quelconque. “L’intrigue était stupide, a confié Stanley Kubrick mais ce qui m’intéressait était d’acquérir de l’expérience et de travailler dans ce milieu. Le contenu, l’histoire me paraissaient secondaires. De toutes les histoires qui me tombaient sous la main, je choisissais simplement celle qui présentait le moins de complications.”
Auteur d’une douzaine de films seulement, réalisés durant la seconde moitié du XXe siècle, Stanley Kubrick a engendré une œuvre dont l’influence résonne encore dans le cinéma, bien sûr, mais aussi dans la culture contemporaine : du costume à la musique en passant par le design, la photographie, l’architecture, le théâtre et la littérature. L’homme, a souvent été dépeint comme une énigme, voire, vers la fin de sa vie, comme un ermite. À la fin des années 1960, il quitte son Amérique natale pour acheter un manoir avec un parc de quatre-vingt-dix hectares en pleine campagne anglaise, près de la ville de Saint Albans. Entouré de sa femme, Christiane, de leurs trois filles, de dizaines de chats et de chiens, il quitte rarement son nid. La fine fleur du 7e art n’hésite pas alors à faire le déplacement pour le rejoindre autour de son immense table de cuisine. Les apparitions publiques du cinéaste se font d’ailleurs si rares que pendant quelque temps, dans les années 1990, un certain Alan Conway se fait passer pour lui. Dans les dîners en ville, les convives, dont notamment de grands noms du cinéma, dupés, se sont ainsi imaginé qu’ils allaient prochainement collaborer avec le maître. Il y a eu cependant un homme pour qui la présence de Stanley Kubrick a été on ne peut plus réelle : Jan Harlan, à la fois beau-frère, ami de longue date, confident, bras droit (sur tous ses projets dès la fin des années 60) et producteur exécutif à partir de 1975. Rencontre.
Numéro: Comment Stanley Kubrick est-il entré dans votre vie ?
Jan Harlan: Quand j’ai commencé à travailler avec Stanley, je le connaissais déjà bien, il était le mari de ma sœur depuis de nombreuses années. Auparavant, nous n’avions que des rapports amicaux, nous discutions beaucoup et nos enfants jouaient ensemble. En 1969, il m’a proposé de partir en Roumanie pendant un an pour travailler sur Napoléon, le film qu’il préparait. A l’époque, je vivais à New York. Je l’ai alors rejoint en Angleterre, j’ai acheté une Land Rover en prévision du voyage, mais tout à coup les studios MGM ont laissé tomber le projet. Waterloo, avec Rod Steiger dans le rôle de Bonaparte, venait d’obtenir le feu vert, et les studios craignaient que celui-ci n’enterre les chances de succès commercial de Napoléon. Stanley a été déprimé pendant quelques semaines – Napoléon Bonaparte occupait toute sa vie depuis deux ans– mais au final, il m’a simplement dit : “Reste en Angleterre avec moi, on va faire un autre film.”
Aviez-vous déjà travaillé dans l’industrie cinématographique ?
Absolument pas. Je travaillais dans une entreprise de traitement de données à Zurich. D’ailleurs, cette formation m’a donné les notions de base pour devenir producteur exécutif : je savais comment m’y prendre pour conclure un marché, acquérir des droits, obtenir tout ce que Stanley voulait, et au meilleur prix. La première chose que nous avons faite ensemble, c’est d’acheter les droits de Traumnovelle [La Nouvelle rêvée, 1926], d’Arthur Schnitzler. A l’époque, cependant, il n’était pas satisfait de la fin, il a alors repoussé le projet (devenu Eyes Wide Shut des années plus tard) et nous avons fait Orange mécanique à la place. C’était la première fois que je travaillais sur la production d’un film.
Pouvez-vous nous décrire une journée de travail ordinaire avec Kubrick ?
Stanley était un oiseau de nuit. En général, on travaillait de midi à minuit. Mon bureau se trouvait – et se trouve toujours – ici, dans la maison de Stanley à Saint Albans, ainsi que tous les équipements de montage, de postproduction… Il ne travaillait en dehors de chez lui qu’en cas de force majeure.
Il ne voyageait que très rarement,n’est-ce pas ?
Il détestait cela ! Après s’être installé en Angleterre en 1968, il n’a jamais remis les pieds en Amérique. Il est bien allé en Irlande pour tourner Barry Lyndon (1975) et une autre fois nous nous sommes rendus aux Pays-Bas pour faire des repérages pour Aryan Papers [un projet avorté de film sur l’Holocauste], mais il n’y prenait aucun plaisir. Sa priorité était sa famille, ses chats, ses chiens, et il aimait dormir dans son propre lit. Les journalistes s’évertuent souvent à faire passer Stanley pour un ermite fou, mais c’était l’homme le plus normal que j’aie connu.
“Imaginez quand il disait : ‘Allô, c’est Stanley Kubrick à l’appareil’, la personne à l’autre bout du fil pensait forcément à un canular…”
Pourtant, on entend souvent dire qu’il vivait comme un “monstre reclus”…
Ce n’était pas le type le plus sociable du monde, mais il n’avait aucun problème pour parler au téléphone. Il passait sa vie à appeler des gens dans le monde entier pour ses recherches, pour échanger des idées ou simplement bavarder. Il n’hésitait pas à se servir de son nom pour obtenir ce qu’il voulait. Je me souviens qu’un jour, parce que sa photocopieuse était en panne, il a appelé la maison mère du fabricant au Japon et il a dit : “Bonjour, ici Stanley Kubrick. Pourrais-je parler au P-DG s’il vous plaît, car j’ai besoin d’une assistance technique ici, à Saint Albans.”
Quel type de rapports ce New-Yorkais entretenait-il avec l’Angleterre ?
Il adorait l’Angleterre, et pas une seule fois il n’a envisagé de retourner en Amérique. Il aimait beaucoup le climat, et la pluie ne le dérangeait pas. Au contraire, il adorait se promener dans son immense parc verdoyant. Il appréciait aussi le respect dont savent faire preuve les Britanniques pour la vie privée.
Les recherches obsessionnelles et le souci méticuleux du détail chez Kubrick sont légendaires. Mais comment germait l’idée initiale d’un film ?
Il lisait en permanence – des nouvelles, des revues scientifiques, tous les quotidiens anglais, des magazines, des romans et le New York Times chaque jour. Il savait aussi formidablement bien solliciter ses proches : à l’époque de ses recherches sur Napoléon, il a demandé à ses amis et connaissances dans le monde entier de se rendre chez les bouquinistes de leur région pour acheter tout ce qu’ils trouveraient sur la période allant de la Révolution française à 1815. Il était indispensable pour lui d’être passionné par son sujet, car il savait que faire un film représenterait une aventure qui allait durer cinq ans au moins.
“Je suis convaincu qu’en 2050, ceux qui se demanderont à quoi ressemblait la seconde moitié du XXe siècle regarderont les films de Stanley.”

Vous rappelez-vous des films qui sont restés à l’état de projets ?
Je me souviens que juste avant Shining, Stanley s’était complètement enflammé à l’idée de faire un film très sérieux, en noir et blanc, sur un médecin juif new-yorkais. Ce devait être un film d’art et d’essai à petit budget, tourné entre Londres et Dublin, avec Woody Allen dans le rôle principal. Mais il s’en est désintéressé très vite, déçu par le scénario. Woody Allen n’a même pas été contacté. En revanche, Stanley a repris l’idée du médecin new-yorkais dans Eyes Wide Shut.
On sait que dans le contrat de Kubrick chez Warner Bros. ,le final cut et une liberté totale lui étaient assurés. Considérait-il ces clauses comme un privilège ou comme un dû ?
Elles ont toujours été tenues pour acquises. Ce traitement exceptionnel n’intéressait que les journalistes et les autres cinéastes. Les gros bonnets de Warner savaient bien qu’avec Kubrick, ils n’avaient pas le choix. Soit ils lui donnaient les pleins pouvoirs, soit ils le perdaient. Contractuellement, ses deux seules contraintes étaient de réaliser des films qui ne soient pas interdits aux moins de 18 ans et de respecter une certaine durée. Néanmoins, il était très important pour Stanley que ses commanditaires rentrent toujours dans leurs frais. Il tenait à mériter leur confiance et la liberté qu’on lui accordait. C’est pour cela que l’échec commercial de Barry Lyndon l’a anéanti.
Qui négociait avec eux? Kubrick ou vous ?
Stanley n’allait jamais à Hollywood. Ça, c’était mon boulot, mais nous leur parlions tous deux au téléphone. D’ailleurs, il préférait parler aux responsables de la pub et de la promo ou même aux techniciens. Et lorsqu’il les appelait, il se faisait souvent raccrocher au nez. Imaginez quand il disait : “Allô, c’est Stanley Kubrick à l’appareil”, la personne à l’autre bout du fil pensait forcément à un canular…
Rétrospectivement, diriez-vous que cette liberté totale avait de mauvais côtés ?
Stanley aurait sans doute fait plus de films s’il avait délégué davantage et s’il ne s’était pas tant préoccupé du moindre détail. Mais ce n’était pas son caractère. Ce serait comme dire que Vermeer aurait dû peindre un peu plus vite.
Dans les années 50, Kubrick faisait un film par an, deux par décennie dans les années 70 et 80, et seulement Eyes Wide Shut dans les années 90. Pourquoi la période de gestation a-t-elle autant augmenté avec le temps ?
La seule chose qui lui faisait vraiment peur, c’était la médiocrité : il ne voulait pas faire des films dont la durée de vie serait éphémère. Il disait toujours : “Personne ne vous force à faire des films, alors si vous en faites quand même, vous avez intérêt à vous assurer qu’il y a une bonne raison.” On me demande souvent : “Qu’est-ce qui fait qu’un réalisateur est un artiste ?” Je réponds : “Quand ses films deviennent des références pour les générations futures.” Je suis convaincu qu’en 2050, ceux qui se demanderont à quoi ressemblait la seconde moitié du XXe siècle regarderont les films de Stanley.
”Nous avions regardé ensemble un match palpitant entre McEnroe et Becker. A la fin, il était dans tous ses états et il m’a dit : ‘Aucun film ne pourra jamais être aussi exaltant !’”
Qu’est-ce qui fait que ses films résonneront encore dans le futur ?
Son regard sur l’humanité et ses travers. Voilà la résonance profonde. Si dans la vie quotidienne, il était d’un optimisme prudent, il était très pessimiste quant à l’avenir de l’humanité, et ça transparaît dans tous ses films. Stanley disait souvent : “Quand nous pensons que nous sommes gouvernés par notre intelligence, notre éducation ou notre capacité à penser analytiquement, nous nous racontons des histoires. Dans les moments cruciaux, ce sont nos émotions qui nous gouvernent.’” Typiquement Kubrick. C’est la raison pour laquelle Napoléon exerçait une telle fascination sur lui. On a un homme extrêmement doué, charismatique et intelligent, qui, au sommet de son pouvoir, n’a pas réussi à vaincre ses émotions.
Quel a été son plus gros succès commercial ?
Orange mécanique, 2001 : l’Odyssée de l’espace, et Full Metal Jacket ont tous les trois rapporté beaucoup d’argent. Le budget d’Orange mécanique était modeste, celui de Full Metal Jacket, qui a été tourné dans l’Est londonien, aussi. Ce qui coûtait le plus cher dans la production de ses films, c’était le temps. Or, la rapidité, ce n’était pas notre truc : au final, le tournage d’Eyes Wide Shut a duré plus d’un an.
Combien de temps était prévu à l’origine ?
Vingt-quatre semaines. Quand j’en ai parlé à Stanley, il m’a répondu : “Vingt-quatre semaines ? C’est ridicule ! Il s’agit seulement de deux personnes qui parlent ! Dix-huit, c’est plus qu’assez.” Il était vraiment optimiste dans la vie quotidienne.
Devoir prolonger le tournage avec Tom Cruise et Nicole Kidman, deux stars débordées, n’a pas dû être chose facile ?
Bizarrement, si. Ils avaient un salaire fixe et ils n’ont pas eu un centime de plus [rires]. Ils pensaient qu’ils venaient en Angleterre pour vingt semaines et ils sont restés plus d’un an. Je suis quasiment sûr que Tom a dit à son agent de ne parler ni de temps ni d’argent avec Stanley. Ils l’adoraient et se sont investis à 100 % dans ce projet.
Tom Cruise et Nicole Kidman étaient mariés à l’époque. Cela a-t-il motivé Kubrick pour leur donner le rôle d’un couple à l’écran ?
Non, pas du tout. Il a toujours voulu Tom Cruise et nous avions un contrat avec lui dès le départ. En revanche, d’autres actrices avaient été pressenties avant Nicole – je tairai les noms –, mais Stanley l’a alors vue dans Prête à tout (1995), de Gus Van Sant. Il a appelé Tom et l’affaire a été conclue l’après-midi même.
Sur le plan stylistique, quelles références Kubrick a-t-il utilisées pour la scène de l’orgie masquée ?
Stanley n’avait jamais participé à une orgie. Il n’avait que le livre de Schnitzler comme point de départ. Il s’est inspiré de la représentation de l’enfer de Jérôme Bosch. C’est-à-dire une image crue, chargée, ennuyeuse et surtout complètement dépourvue d’érotisme.
Kubrick est mort à peine quelques jours après avoir apporté la touche finale à Eyes Wide Shut. Etait-il satisfait du résultat ?
Il était ravi. Il considérait que c’était sa plus grande réussite. Comme Tom et Nicole devaient valider les scènes de nu, une projection spéciale a été organisée à New York pour eux et les dirigeants de Warner. Ils ont téléphoné à Saint Albans pour dire qu’ils avaient tous adoré et qu’ils attendaient la sortie avec impatience. Stanley est mort la semaine suivante. Heureusement, il n’a pas vécu assez longtemps pour voir comment les critiques ont descendu son film en flammes.
En général, critiquait-il les films de ses pairs, ou cherchait-il plutôt leurs mérites ?
Il essayait toujours de voir les mérites d’un film. Lorsqu’il voyait un film qui lui plaisait, il était incroyablement généreux en compliments. Je me souviens qu’il ne tarissait pas d’éloges au sujet d’Heimat, un drame allemand des années 80. Il avait même contacté une partie de l’équipe pour lui proposer de travailler avec lui. Il adorait également regarder des films de série B. Mais il voulait faire des films en se fondant sur le jugement émotionnel qu’il portait sur la nature humaine.
“Quand je repense à Stanley, je vois d’un côté ce grand cinéaste existentialiste, et de l’autre, un homme qui aimait plus que tout photographier ses enfants et ses chats.”
Suivait-il les sorties ?
Il voyait tout ! Il avait une superbe salle de projection chez lui et il y regardait la plupart des films avant leur sortie officielle. En général, sept ou huit films par week-end, mais pas nécessairement jusqu’à la fin !
Echangeait-il avec d’autres cinéastes ?
Steven Spielberg, de temps à autre. Il l’aimait bien, parce qu’ils étaient aux antipodes l’un de l’autre. Il adorait E.T. et Rencontres du troisième type. C’est pour cela qu’il pensait que Steven serait par- fait pour reprendre le projet A.I.
Avait-il des films de chevet ?
Je sais qu’il regardait très souvent Radio Days, de Woody Allen, parce qu’il lui rappelait un peu sa jeunesse.
Et la télévision ?
Son grand truc, c’était le sport. Il était inutile de penser bosser pendant la deuxième semaine de Wimbledon, parce qu’il était accro au tennis. Un jour, je me souviens, nous avions regardé ensemble un match palpitant entre McEnroe et Becker. A la fin, il était dans tous ses états et il m’a dit : “Aucun film ne pourra jamais être aussi exaltant !”
N’avait-il jamais manifesté l’envie de faire de la télévision ?
Je me souviens qu’une année la BBC a diffusé plusieurs longues fictions, chacune d’une dizaine d’épisodes d’une heure. Stanley m’a dit qu’un format de ce genre serait parfait pour son scénario sur Napoléon. Mais, à ce moment-là, il voulait qu’il soit réalisé par quelqu’un d’autre.
Les avancées technologiques l’intéressait-il ?
Bien sûr. Regardez Barry Lyndon. Il a essayé par tous les moyens de restituer l’atmosphère de a fin du XVIIIe siècle à l’écran, et il y est parvenu. Mais quelle bataille pour trouver le bon objectif et l’adapter à une caméra ! Faire quelque chose de nouveau et vaincre les difficultés techniques, cela le passionnait. De même, l’utilisation du Steadicam dans Shining a vraiment contribué à imposer cette tension. L’excellence des images des caméras numériques et leurs modestes coûts l’auraient sans doute enthousiasmé.
Utilisait-il des ordinateurs dans sa vie quotidienne ?
En permanence. Tous les six mois, il achetait LE nouveau modèle de portable et ce, en deux exemplaires. Un pour moi et un pour lui. Il avait aussi une grande quantité de répondeurs et de téléphones portables dernier cri. On imagine aisément l’usage qu’il aurait fait d’Internet dans les recherches pour ses films.
Votre relation avec lui a-t-elle évolué au fil des années ?
Notre rapport n’a jamais réellement changé. Il était bien plus intelligent que moi. La musique était le seul domaine où nous étions à égalité. C’est moi qui lui ai suggéré Strauss pour 2001 : l’Odyssée de l’espace. Quand je repense à Stanley, je vois d’un côté ce grand cinéaste existentialiste, et de l’autre, un homme qui aimait plus que tout photographier ses enfants et ses chats.