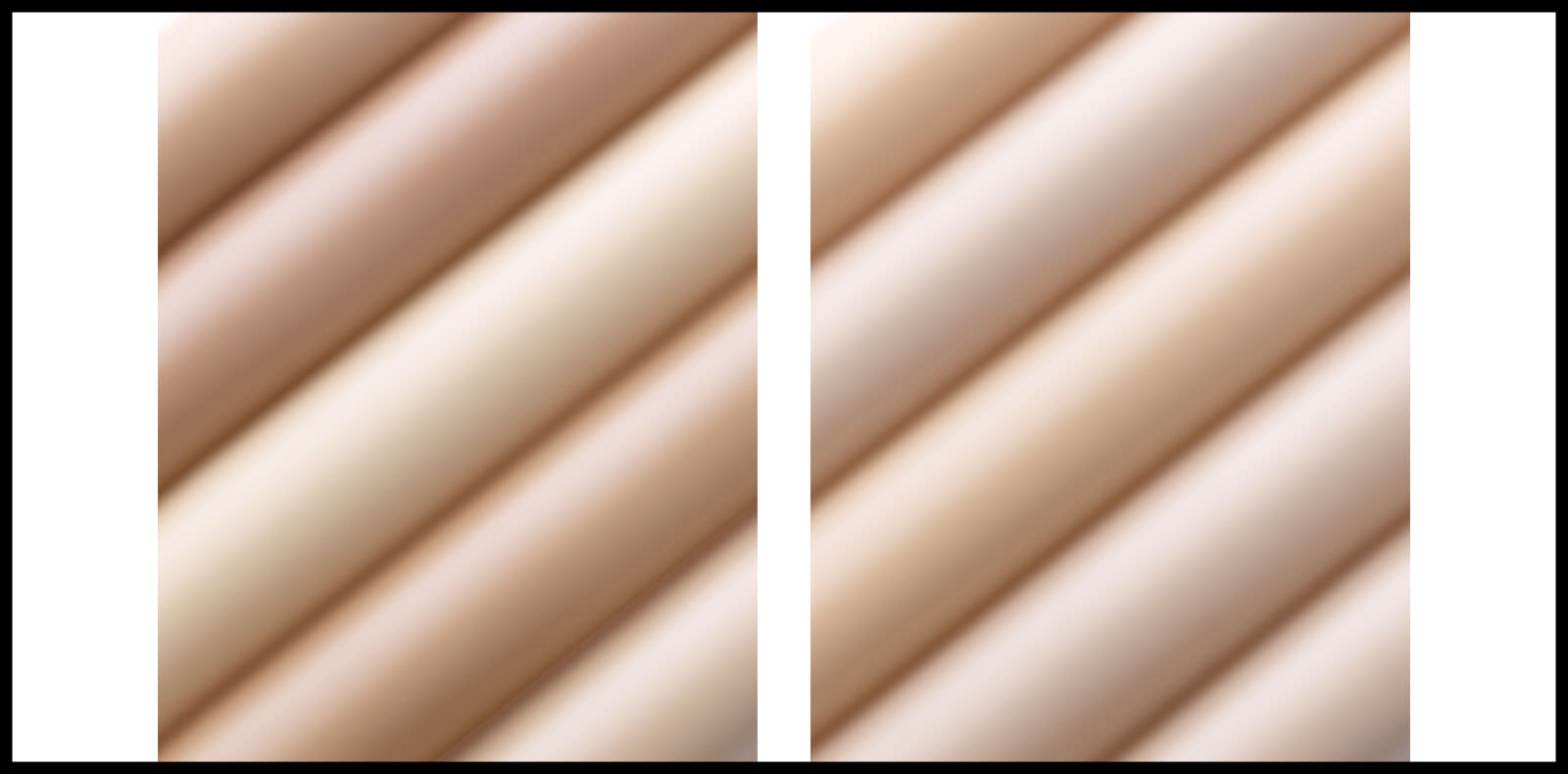20

20
Notre bilan cinéma de l’année 2024
D’une densité folle, 2024 a balayé tout le spectre du cinéma. Retour sur douze mois d’images et de personnages forts.
par Olivier Joyard.

Il a fallu parfois écarquiller les yeux pour confirmer que nous étions bien en 2024, avec des têtes d’affiche dignes des eighties, quand Clint Eastwood, 94 ans, a sorti Juré n°2, George Miller, 79 ans, a réalisé Furiosa : Une saga Mad Max, tandis que Francis Ford Coppola, 85 ans, a connu à nouveau les honneurs de la compétition au Festival de Cannes (et un flop en salles) pour son pharaonique et autofinancé Megalopolis. De là à conclure que le cinéma serait un art vieillissant, il n’y a qu’un pas, que la réalité contredit joyeusement.
Intensité maximale pour le cinéma en 2024
Pour preuve, la Palme d’or est revenue au superbe conte de fées anticapitaliste Anora de Sean Baker, un jeune quinqua au visage poupin. Le sentiment domine que tout le monde a aujourd’hui sa chance et que, foutu pour foutu dans un monde dangereux, il faut y aller à fond. Nous traversons les derniers feux créatifs d’une génération qui a eu une trentaine d’années durant les années 1970, tandis qu’une autre s’installe, pleine de verve et d’incertitudes. L’ambition reste la valeur la mieux partagée, avec des films marquants et maximalistes.
Malgré son insuccès, Furiosa : Une saga Mad Maxa brillé par sa puissance plastique, sa férocité jamais rentrée à une époque où la dévastation des êtres et des ressources fait le quotidien d’une partie de la planète. Dans un style plus fixe mais tout aussi habité, La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer a redéfini ce que l’on peut attendre d’un film sur l’holocauste, en s’intéressant à la vie de famille du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss. La manière dont la bile noire de la haine transperce l’écran ne laisse pas indifférent, redonnant au cinéma sa puissance de témoignage et d’évocation. De son côté, Clint Eastwood a signé ce qui pourrait être son ultime réalisation – jusqu’à preuve du contraire, on l’espère -, un film de procès simple mais profond, autour de l’idée de culpabilité et de privilège. Juré n°2 parait presque lisse, mais reste ancré longuement en nous. Il n’est pas seulement question du savoir-faire d’un vieux maître, mais du resserrement des enjeux autour d’une question majeure : comment mener une vie bonne et par quels moyens ?

La réponse n’est pas forcément rose, tout comme le regard de Todd Haynes sur ses héroïnes dans May December, film d’une cruauté et d’une ironie coupantes sur un sujet complexe, quand une actrice (Natalie Portman) vient vampiriser celle dont elle s’inspire pour préparer un rôle en s’incrustant dans sa vie. Cette dernière est une femme d’âge mûr (Julianne Moore) vivant en couple avec un homme de 23 ans son cadet, poursuivie par la justice car elle l’a rencontré lorsqu’il était au collège. De ce scandale aux résonances contemporaines, le cinéaste fait un objet conceptuel, une réflexion sur la puissance du jeu – jeu social, jeu des actrices – dans une Amérique bercée de faux semblants, sauvagement entretenus par les tenants de l’ordre établi.
Un sujet au fond pas si éloigné du Megalopolis de Francis Ford Coppola, dont la science-fiction politique renvoie New York à l’ère décadente de l’Empire Romain, et avait en quelque sorte prédit la réélection de Donald Trump avant qu’elle ne survienne. Dommage que cet ovni soit tout aussi bancal qu’inventif.

Un bilan positif pour la France
2024 a commencé avec le triomphe d’Anatomie d’une chute en Amérique – Golden Globes et Oscars pour Justine Triet et son coauteur/compagnon Arthur Harari – après la Palme d’or cannoise en 2023. Elle se termine avec la confirmation que le cinéma français s’est remis à l’endroit après le trou d’air du Covid, conservant sa réputation de place forte après les succès d’Un P’tit truc en plus (presque 11 millions d’entrées pour la comédie d’Artus sur le handicap) et du Comte de Monte Cristo (9,6 millions de spectateurs), porté par un Pierre Niney superstar.
On ne fera pas injure à ces deux films honorables en rappelant que la part la plus créative reste le cinéma d’auteur, dont la diversité et les audaces font l’admiration du monde, alors que le soutien à la culture, public ou privé, reste une lutte pour la plupart des artistes. Dans ce cadre, la réussite du Roman de Jim, le bouleversant mélo familial des frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu, installe un peu plus Karim Leklou au Panthéon des acteurs français qui comptent. Le succès fou de L’Amour Ouf – même si son financement généreux le place dans le haut du panier auteuriste – fait de Gilles Lellouche un réalisateur central du cinéma français, une véritable surprise.

En 2024, plusieurs révélations et confirmations ont donné de l’espoir pour la suite, comme la jurassienne Louise Courvoisier dont l’attachante chronique sociale Vingt Dieux cartonne, le nouveau visage queer Alexis Langlois, qui avec Les Reines du drame prend le prétexte d’une émission de téléréalité pour inventer une romance contemporaine addictive et pop. On n’oublie pas Les Fantômes, intense premier film de Jonathan Millet sur la quête de son bourreau par un jeune syrien, Dahomey, le saisissant docu-fiction de Mati Diop sur la restitution des œuvres volées par la France coloniale au Bénin, et la tentative tout sauf anodine de Caroline Poggi et Jonathan Vinel dans Eat The Night, sur des histoires d’amour impossibles dans l’univers des jeux vidéo en ligne.
Trois films importants sortent du lot, signés par des réalisateurs confirmés et néanmoins libérés. En passe de faire à nouveau une razzia lors de la saison des prix américaines, le taulier s’appelle Jacques Audiard. Emilia Perez, sa comédie musicale sur un ex-baron de la drogue devenu une femme aux visées humanitaires, a séduit par son désir virevoltant d’embrasser à la fois le contemporain et les possibilités stylistiques du cinéma. Imparfait, le film emporte par son énergie et façonne un écrin pour des actrices impeccables, Zoe Saldana, Selena Gomez et la flamboyante Karla Sofia Gascon, première comédienne transgenre à remporter un prix à Cannes.

Son passage en salle a été beaucoup plus discret, mais le très beau La Bête de Bertrand Bonello (réalisateur du superbe Saint Laurent en 2014) mérite tout autant d’attention. Inspirée d’une nouvelle de Henry James, La Bête dans la jungle, voici 2h30 barrées entre passé et futur dystopique, menace et consolation, où Léa Seydoux navigue dans les illusions amoureuses comme un poisson dans l’eau.
Ces mêmes illusions qui font le sel de Miséricorde du génial Alain Guiraudie, probablement le film français de l’année. Dans cette histoire de désir et de meurtre à la campagne, les personnages ont beau essayer de se mentir à eux-mêmes, leurs pulsions mènent la danse et Guiraudie, dont L’Inconnu du lac avait marqué les esprits en 2012, les filme avec une frontalité presque pépère mais très fine qui ne laisse jamais indifférent. Un vrai délice.

Des femmes au combat
Depuis MeToo, le cinéma voit des réalisatrices et actrices prendre une autre dimension. 2024 aura été un emblème puissant et novateur de cette tendance, avec des films dont les revendications féministes, bien réelles, servent de support moral et politique à une exploration artistique. Dans Anora, où une danseuse nue rencontre le fils d’un oligarche russe, avant lui passer la bague au doigt, Mikey Madison crève l’écran. Sexuel et arrogant, son personnage déjoue à la fois les clichés de la victime et de la Cendrillon moderne. Dans une scène mémorable, elle se bat à mains nues contre un homme qui veut la maîtriser. Son art du combat lui permettra une timide émancipation. Réelle, mais timide. Car il ne faut pas se leurrer : les femmes du cinéma contemporain n’ont pas fini de payer les pots cassés du patriarcat.
Les mêmes thèmes se déploient de manière plus douce mais pas moins insistante dans le long-métrage de l’indienne Payal Kapadia, All We Imagine As Light, à un doigt d’obtenir la Palme au dernier Festival de Cannes, le jury présidé par Greta Gerwig lui attribuant le Grand Prix. Porté par une rythmique sourde et enveloppante, le film chronique l’existence de trois femmes à Bombay, toutes en recherche d’autonomie. Dans une extraordinaire partie finale, All We Imagine As Light se déplace dans une station balnéaire où les fantômes sont pacifiquement évacués. Une leçon de mise en scène planante et précise, qu’aurait sans doute adoré Sophie Fillières, décédée en 2023. Son film posthume avec Agnès Jaoui, Ma vie ma gueule, terminé par ses enfants Agathe et Adam Bonitzer, a marqué l’année en dressant un portrait de femme sexagénaire en rupture avec les conventions, avec le quotidien telle qu’il s’impose à elle, mais certainement pas avec la vie.

Celle qui rompt avec tout et tout le monde, y compris avec elle-même, c’est Elisabeth Sparkle, alias Demi Moore dans le brutal film de body horror de la française Coralie Fargeat, The Substance. Dans ce récit d’un pacte faustien scellé par une présentatrice d’émission d’aérobic à Hollywood, l’actrice de Proposition Indécente, 62 ans, s’invente sous nos yeux le rôle de sa deuxième vie de comédienne, exhibant et déchirant son corps, hurlant et souriant, renversant la table de façon constante (et parfois trop appuyée par la réalisatrice) et surtout, façonnant quelques scènes dignes d’entrer illico dans l’histoire du cinéma. Quand elle s’étire et se frappe le visage pendant de longues minutes pour se trouver « belle » avant un date, Demi Moore incarne avec une fureur stupéfiante la colère de nombreuses femmes forcées de jouer le jeu de la séduction. Le cinéma n’est pas seulement un refuge pour échapper aux temps difficiles, c’est aussi une chambre d’écho qui repère et subvertit les images fausses.