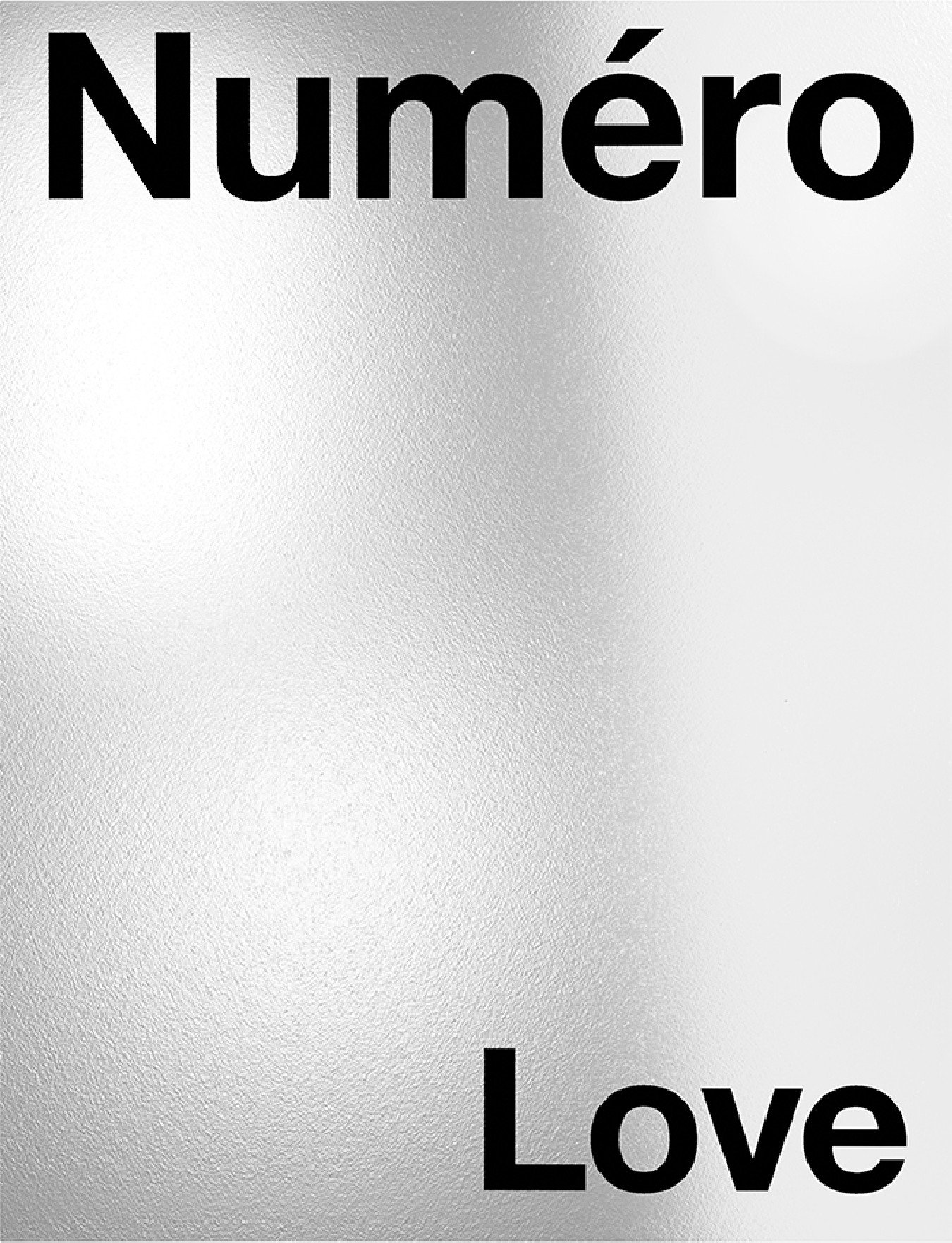Le metal féministe de Sasami
Sorti chez Domino, le deuxième album de l’Américaine d’origine coréenne Sasami ne fait pas que revisiter le metal à la sauce féministe : il twiste le genre, le déplace, grâce à ce que l’on appelle aujourd’hui le female gaze.
Par Chloé Sarraméa.

Peu auraient cru, il y a quelques mois, à un revival de l’esthétique rock dans la sphère fashion. Encore moins au retour en force du genre dans l’industrie musicale et en tête des ventes. Depuis, pourtant, Kourtney Kardashian, reine parmi les reines de l’influence sur les réseaux sociaux, s’est mariée à Travis Barker, batteur ultra tatoué du groupe de punk Blink-182 et musicien attitré des stars américaines, et son ami le chanteur Machine Gun Kelly bat tous les records au classement Billboard, faisant ré-exploser le pop-rock et son imagerie aux quatre coins du globe. Alors, on est surpris. Parce que ça fait dix ans que le les riffs de guitare sont boudés dans les concerts au profit des synthés et qu’on avait l’impression que l’hégémonie du rap, aux yeux du public, n’allait jamais se terminer. Mais le rock est bien revenu, le metal aussi, et pléthore d’artistes le prouvent, à commencer par Sasami, une Américaine d’origine coréenne qui, avec son deuxième disque sorti chez Domino, twiste le genre, le déplace, grâce à ce que l’on appelle aujourd’hui le female gaze.
Il faut dire qu’elle a, avec Squeeze, un disque qu’elle qualifie volontiers de tordu, théâtral et fantaisiste, renouvelé le style qui a érigé, au début des années 2000, les membres du groupe System of a Down en idoles. À coups de ballades mélancoliques aux guitares pleines de reverb ouvertes par l’aveu “Baby, I’d never let you go” (The Greatest), de manifestes anticonformistes, désabusés mais clairvoyants, où elle dézingue le modèle social dominant (“Settle into a life that you like for a little while/ Have a kid, get a pretty wife/ Get a real job and a fake smile”) et de brûlots féministes suintants, l’obsédée de romans audio fantasy livre un son qui donne envie de s’agiter, sauter, boxer, ramper… Bref, s’épuiser. Depuis une résidence perdue dans les forêts du Vermont, où elle répète avec son groupe pour sa prochaine tournée, elle s’explique : “Cet album est un coup de fouet. Il est le reflet des expériences émotionnelles des humains : en montagnes russes. Quand tu es vraiment en colère contre quelque chose, tu oscilles ensuite entre plusieurs stades, de la déception à la tristesse. Et après ça, te sens comme engourdi et à nouveau heureux.” La chanteuse passe donc du punk au metal et du folk au solo de cor, un instrument qu’elle a appris dès la pré-adolescente pour, dit-elle, faire tout ce que les autres n’osaient pas.
Parce que sa mère coréenne est traductrice de Japonais et que son père est professeur, qu’elle a grandi près de Sunset Boulevard entourée d’enfants d’acteurs, de chanteurs ou de peintres et qu’elle est allée dans une école coréenne puis dans un lycée d’art, la musicienne aurait pu avoir, comme on dit, une jeunesse dorée. Mais elle est d’origine asiatique. Surtout, elle s’appelle Sasami. C’est là que le Los Angeles libertaire et progressiste se révèle un mirage. Il lui faudra partir, à l’âge où elle écoute Cheryl Crown en boucle et où elle est, de son aveu, la version la plus émotive et dramatique d’elle-même. Loin des rues d’Hollywood où les maisons ont brûlé et où tout le monde a quelque chose à apprendre – chante-elle sur le titre At Hollywood sorti sur son premier album Sasami –, elle s’échappe… Ce sera le Conservatoire de musique de New York, perdu dans le nord de l’Etat, où il neige la majorité de l’année et où répéter est la seule activité envisageable – bientôt lucrative, pour certains.
Pour préparer son premier disque sorti en 2019, la rockeuse s’est immergée dans l’univers dark et plein de reverb de My Bloody Valentine et celui, plus rétro, kitsch et aérien, mais non moins inoubliable, de Stereolab : “À l’époque, je découvrais les pédales de guitare et le matériel analogique. Cet album est très autobiographique, beaucoup plus rudimentaire et simple que le dernier. Je n’essayais pas d’être expérimentale. J’étais juste très honnête et très vulnérable.” Sobrement intitulé Sasami, l’album, qui comprend une collaboration avec le prince de la folk vénézuélien Devendra Banhart (Free) dégouline de son passé d’emo-gothique, fan irrépressible d’Elliott Smith, et provoque, chez l’auditeur, une envie tout aussi irréfrénable de pleurer et de courir, même jusqu’à l’éclatement des poumons.
Elle a ensuite voulu sortir du cadre, le déformer même. Pendant le premier confinement aux États-Unis, Sasami a débuté la composition, chez elle, avec ses colocataires également musiciens, de son deuxième disque, Squeeze. Elle l’a créé pour ceux qui intériorisent leurs fantasmes négatifs et dealent avec certaines émotions qui, souvent, sont vues comme déviantes. Et faire découvrir, à sa communauté plutôt fan d’indie rock, le metal : un son forcément associé à une esthétique qui nécessite, donc, de mettre des mots sur l’image. On découvre alors la rock star, une sorte d’Avril Lavigne enragée en total look résille et chaînes autour du cou, acceptant enfin d’être totalement obscure et violente. Et de le transposer en musique. “Je souhaitais être extrême et surtout montrer que le metal, ce ne sont pas juste des énergies sombres et lourdes. C’est un genre qui suscite beaucoup d’émotions… Et moi la première : ni le shoegaze ni la pop ne génèrent chez moi ce genre de sentiment puissant”, avoue-t-elle, avant de conclure : “Bien sûr, il y a des gens de couleur et des homosexuels qui font du métal. Mais cet espace est globalement très masculin et blanc, même si ce n’est évidemment pas le cas à 100%. En faisant cet album, j’ai simplement pensé qu’il y avait une place pour moi.” On le sent : elle ne cessera pas de grandir.
Squeeze (2022) de Sasami, disponible chez Domino.