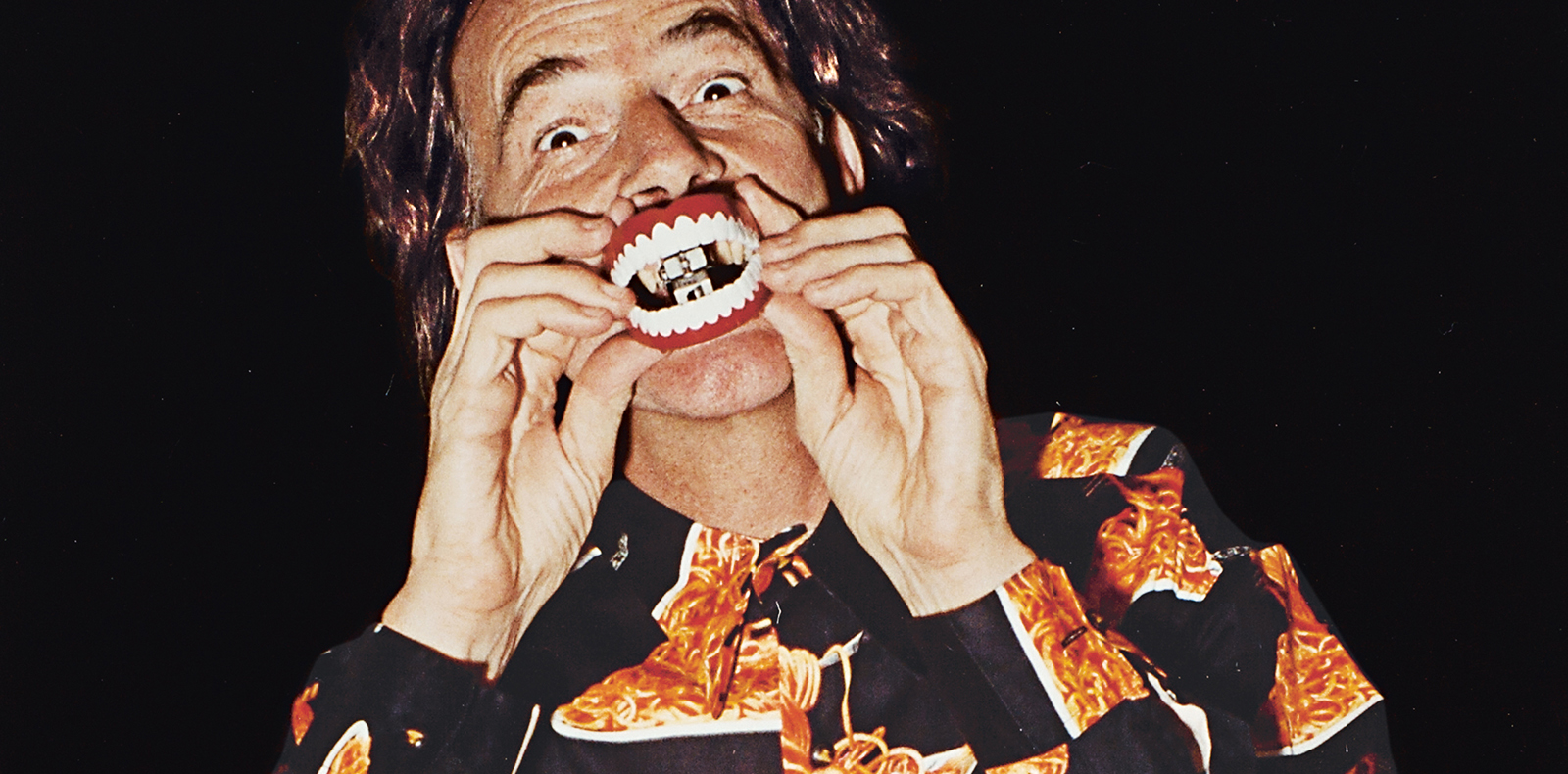16

16
Laura Owens, la femme qui repousse les limites de la peinture
Dans ses œuvres, l’artiste américaine hybride références historiques, artisanat et expérimentations digitales pour repousser les limites de la peinture. Elle devrait bientôt exposer à la Fondation Van Gogh d’Arles.
Propos recueillis par Nicolas Trembley.

Numéro : Quelle fut votre première rencontre avec l’art ?
Laura Owens : J’ai grandi dans une petite localité rurale de l’Ohio. Je me souviens de plusieurs sorties scolaires aux musées de Toledo et de Cleveland lorsque j’étais collégienne ou avec mes grands-parents. Je saississais toutes les occasions de sortir de mon périmètre clos et d’élargir ma vision du monde.
Quelles œuvres vous ont marquée ?
En 1984, Jackie Ferrara avait installé une sculpture dans l’espace public de ma ville natale, près du réservoir d’eau. Les musées autour de chez moi possédaient d’excellentes collections d’art contemporain, mais aussi d’art moderne, avec de très belles toiles impressionnistes, ou des peintures et des sculptures modernistes. Le musée de Cleveland détient aussi un splendide Caravage, Le Crucifiement de saint André, et beaucoup d’autres œuvres majeures.
D’où proviennent vos images ?
Toujours de sources multiples. Il est essentiel pour moi de rester réceptive à de nouvelles influences. J’ai toujours sur moi un carnet de croquis, des dossiers sur mon ordinateur, je fais des photos avec mon téléphone et je prends des notes sur des fichiers Word. Ensuite, je pioche dans ce vivier.
Quelle est la place du hasard dans votre travail ?
Quand je commence une œuvre, je ne décide rien à l’avance. J’essaie de laisser d’autres personnes intervenir de façon aléatoire, pour devoir à mon tour répondre à leur intervention. Il m’arrive de créer des situations où je récupère certaines informations par l’opération du hasard. Souvent, je pars du langage, par exemple d’un jeu de mots. Ainsi, le jour où j’ai décidé de créer du papier peint, j’ai scanné une feuille de papier préalablement froissée et j’en ai fait le motif de base de mon papier peint. D’autres fois, j’utilise un système d’information préexistant, comme un journal, une photo que j’ai faite ou un objet de récupération… Depuis le point de départ que je choisis, je sais que le chemin ne sera jamais rectiligne – et cela fait partie du plaisir.
La scénographie vous importe-t-elle ?
Oui, beaucoup. Pour une exposition personnelle, je tiens à installer moi-même mes œuvres de façon très spécifique,
en fonction du site. En 2016, ma galerie à Londres devait construire trois cloisons pour exposer mes toiles. Je leur ai alors présenté une série de ratios qui devaient déterminer le rapport de proportionnalité entre les murs, deux à deux, mais sans connaître leur taille respective ni leur position dans la galerie. À l’inverse, ma galeriste ne connaissait pas la taille des œuvres que j’avais sélectionnées ni leur nombre. L’intention était de créer une situation à laquelle je devrais répondre “dans l’instant”, sans pouvoir esthétiser à l’avance le rapport entre les œuvres et l’espace qui allait les accueillir.

Vous sentez-vous proche d’une communauté ou d’un mouvement en particulier ?
Pas au sens traditionnel, non. C’est une idée très romantique, qui m’aurait bien plu. En revanche, je me sens soutenue par beaucoup de mes amis artistes, écrivains ou musiciens.
Vous préparez une exposition à la Fondation Van Gogh à Arles. Pouvez- vous nous en parler ?
Pendant le confinement, j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre en France, et à Arles tout particulièrement. J’ai beaucoup aimé tout ce que j’ai pu découvrir du riche passé de la ville – et j’ai apprécié d’avoir pu mettre son histoire en relation avec notre présent. J’ai appris, par exemple, que la rue du Docteur-Fanton, où se trouve la Fondation, porte le nom d’un médecin mort pendant l’épidémie de choléra, en 1884, après avoir traité de nombreux patients. Ce n’est pas sans rappeler la situation actuelle. J’ai découvert aussi, au détour d’une brève mention qu’en fait Voltaire, l’histoire du cheval Marocco et de son maître, tous deux sans doute brûlés vifs à Arles aux alentours de 1606. Le cheval avait été dressé à réaliser de nombreux tours, mais sans fouet ni harnais, simplement guidé par la voix et les gestes de son maître. Les autorités de l’époque ayant jugé ses capacités suspectes – tout comme l’argent que le spectacle rapportait au dresseur –, ils furent tous deux condamnés au bûcher pour sorcellerie. J’espère à présent pouvoir achever plusieurs œuvres inspirées de ces passionnants récits.