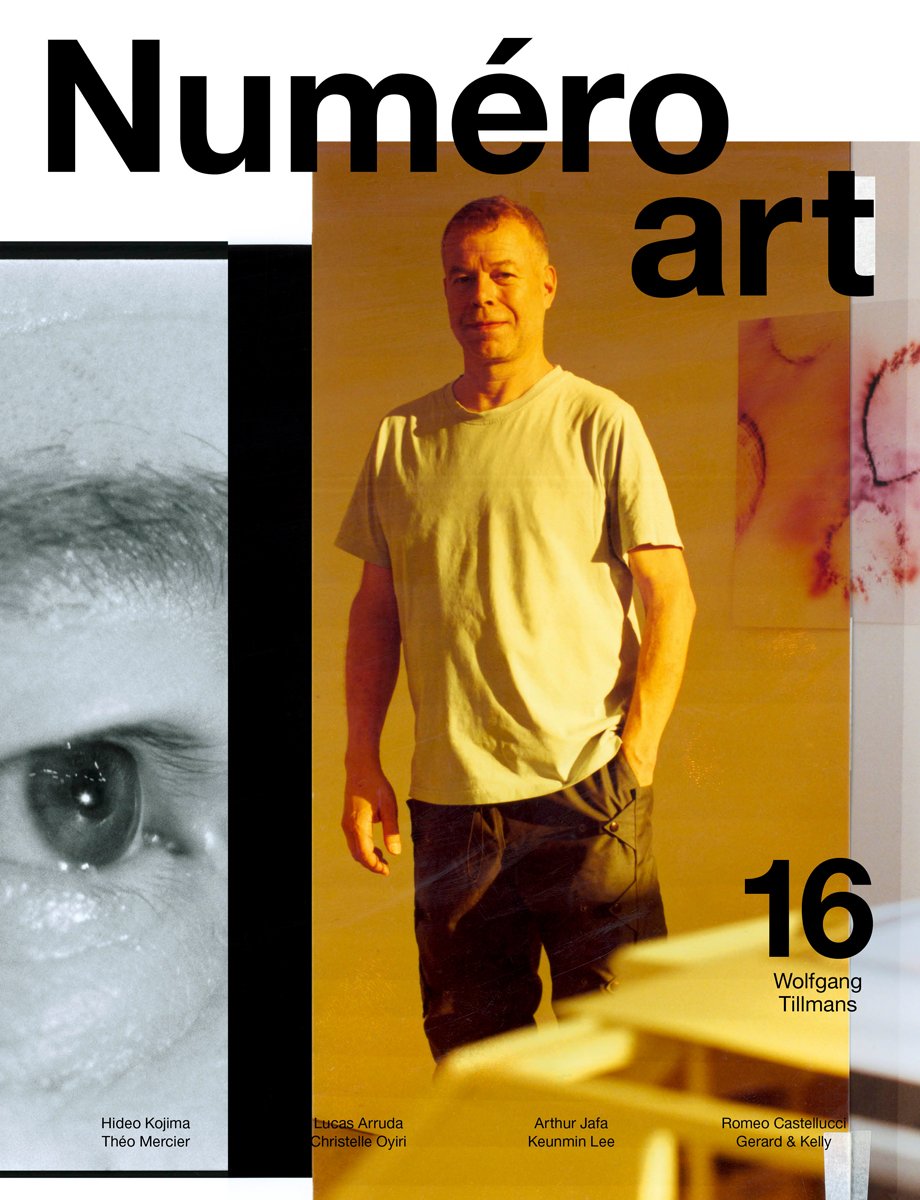25

25
À quoi ressemble le nouveau pavillon estival de la Serpentine Gallery imaginé par Frida Escobedo ?
C’est la Mexicaine Frida Escobedo qui a signé cette année la conception du célèbre pavillon d’été de la Serpentine Gallery, à Londres, construction éphémère nichée dans la verdure, à Hyde Park, jusqu’au 7 octobre. Rencontre.
Par Christian Simenc.

À 39 ans, la Mexicaine Frida Escobedo est la plus jeune architecte à s’être vu confier la réalisation du pavillon d’été de la Serpentine Gallery. Et la troisième originaire d’Amérique latine, après le Brésilien Oscar Niemeyer (2003) et le Chilien Smiljan Radic (2014). Depuis 2006, Frida Escobedo travaille pour le compte de sa propre agence, située en plein cœur de Mexico, dans le quartier de Juárez.
Numéro : Comment avez-vous abordé le projet du pavillon d’été ?
Frida Escobedo : Le pavillon d’été est un vrai défi. Depuis le premier exemplaire, en 2000, il y a eu beaucoup de bonnes idées. C’est un exercice difficile pour un architecte, car il s’agit de concentrer ses idées dans ce micro-espace, et d’y mettre en scène l’esprit et l’ethos de son agence, avec un budget restreint. C’est ce qui m’a conduite à travailler sur la thématique de l’“espace contraint”. Une référence s’est alors imposée : celle de la cour intérieure, dont on trouve de merveilleux exemples en Espagne ou au Moyen-Orient. Le pavillon lui-même se trouve, d’ailleurs, dans un vaste jardin, Hyde Park, qui est à la fois un espace extérieur, vu son immensité, mais aussi un espace intérieur, car il se trouve au cœur de la ville… comme un jeu de poupées russes. Résultat : le pavillon flirte lui aussi avec cette double notion du “dedans-dehors”. On y est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du monde.
L’édifice arbore deux visages : suivant l’angle sous lequel on le regarde, il change littéralement d’aspect…
Il s’agissait d’une part d’utiliser des matériaux simples et surtout locaux, et d’autre part de ne pas faire de formes ultra sophistiquées. Notre choix s’est porté sur cette tuile de couleur gris foncé. À partir de ce module de construction, superposé de manière élémentaire, nous avons imaginé un motif pour générer les parois. Une sorte de “mur-écran” qui filtre la vue et qui, effectivement, selon l’angle sous lequel le visiteur le voit, peut passer du très transparent à la quasi-opacité. L’inspiration vient aussi de la culture arabe et de la technique du moucharabieh. Le pavillon est un espace complètement sûr : on peut voir au travers sans être vu.
Côté matériau, vous semblez abhorrer le “maquillage” ?
J’aime beaucoup que les matériaux ne prétendent pas être autre chose que ce qu’ils sont. Si je veux faire une façade avec un matériau rouge, je l’utilise tel quel, sans le recouvrir d’une couche de peinture. Je ne veux ni cacher ni maquiller. En outre, si l’on utilise un matériau tel qu’il est, il dure plus longtemps et vieillit mieux.
“L’architecture est une façon de penser. C’est devenu ma manière de m’exprimer, mon langage. Et chaque langage a ses contraintes, sa grammaire.”
Comment se compose le pavillon ?
Il est organisé comme un théâtre. Aux deux extrémités, il y a deux petites cours, comme des coulisses, et au centre, une large cour intérieure, telle une grande “scène” : celle-ci accueille un bassin d’eau au fond réfléchissant, dans lequel on peut déambuler. Ce bassin est comme une métaphore : on y plonge son regard pour admirer le ciel, à l’extérieur, ou pour se regarder soimême, à l’intérieur. C’est un espace très contemplatif.
Vous rappelez-vous à quel moment vous avez été pour la première fois consciente d’un espace ?
Je me souviens d’un voyage chez une amie de ma mère, à New York. Je devais avoir 7 ans. Cette amie vivait dans un petit appartement. Au moment du repas, alors que les invités étaient assis autour de la table, je me suis agenouillée devant une table basse pour dessiner. Plusieurs années après, ma mère a retrouvé ce dessin et me l’a donné. On était toutes les deux très impressionnées. Certes, j’avais dessiné les gens, mais j’avais surtout représenté l’espace alentour, reproduit la salle à manger dans ses moindres détails, y compris les cadres. L’espace racontait aussi l’histoire de cette femme. C’était une personne très sophistiquée. Or, il n’y a pas que la beauté physique qui compte. Le dessin montrait aussi l’“épaisseur” de la personne.
“Le pavillon de la Serpentine Gallery est intéressant car il s’agit d’une construction provisoire. Comment évoquer le temps en architecture ? Cette question me passionne.”

En Finlande, les jeunes architectes s’appliquent, au figuré bien sûr, à “tuer le père”, en l’occurrence Alvar Aalto. Est-ce la même chose au Mexique, avec le célèbre Luis Barragán ?
Certes, comme on le voit dans moult réalisations de Barragán, la couleur est très importante dans l’histoire de l’architecture au Mexique, mais il n’y a pas que ça. On peut aussi évoquer la géométrie. Prenez la Casa Luis Barragán, la propre maison de l’architecte, à Mexico. Il y a une intense recherche sur les couleurs, mais aussi un énorme travail d’abstraction entre les murs et le ciel. Si certaines choses sont maintenant un peu datées, comme l’utilisation de la pierre volcanique ou des carreaux en terre, ce qui, aujourd’hui encore, demeure très important, est sa pensée. Barragán déménageait sans cesse, et quand il se fixait dans une maison, il changeait tout le temps l’intérieur, toujours à la recherche de la perfection. Il montrait ainsi qu’il n’y a pas de demeure immuable.
L’impermanence de l’architecture, n’est-ce pas un peu votre philosophie ?
Je ne crois pas à la permanence de l’architecture. Le pavillon de la Serpentine Gallery est intéressant car il s’agit d’une construction provisoire. Comment évoquer le temps en architecture ? Cette question me passionne. De ce point de vue-là, le Japon est un pays assez paradoxal. D’un côté, les Japonais détruisent et remplacent très rapidement les bâtiments. De l’autre, ils recherchent une forme de continuité comme, par exemple, avec le temple d’Ise, qu’ils reconstruisent à l’identique tous les vingt ans, et ce depuis des siècles. C’est l’idée d’associer l’impermanence et la permanence, une façon de représenter les différentes couches de l’histoire. De la même façon, une ville est composée de plusieurs strates temporelles. Lorsqu’une ville a de l’“épaisseur”, elle offre une multitude d’informations, un concentré d’histoire. Ainsi, le centre de Mexico possède un site archéologique célèbre, le Templo Mayor : or, la ville s’est érigée dessus. On construit toujours sur ses fondations. Il y a à la fois l’idée de changement et de permanence. Tout ne doit pas forcément être nouveau.
Dans un monde globalisé, comment faire ressortir les spécificités locales ?
J’ai suivi mon cursus d’architecture à l’Universidad Iberoamericana, à Mexico, puis un master en art, design et domaine public, à la Harvard Graduate School of Design, aux États-Unis. Étudier simultanément l’architecture et l’espace public m’a permis de développer une “conscience urbaine” dans l’approche de mon métier : l’architecture n’était plus seulement un objet isolé, mais faisait partie d’un tout qui était la ville. Depuis, à chaque fois que j’interviens sur un site, je recherche quelle histoire plus large ce lieu peut me raconter, ce qui se cache à l’arrière-plan, quelles sont les différentes strates historiques qui l’ont façonné…
L’architecture est-elle une contrainte ou une liberté ?
L’architecture est une façon de penser. C’est devenu ma manière de m’exprimer, mon langage. Et chaque langage a ses contraintes, sa grammaire. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas dirigée vers une école d’art : trop de liberté sans doute. J’aime, au contraire, répondre à des questions. C’est un défi supplémentaire.
L’art vous inspire-t-il néanmoins ?
J’apprécie beaucoup le travail des artistes des années 60, tels que Donald Judd, Carl Andre, Gordon Matta-Clark, Michael Heizer, Hans Haacke… Celui, aussi, de nombreux créateurs sud-américains comme Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Lygia Pape ou Lygia Clark.
Quelle étape d’un projet préférez-vous ?
La conception d’un projet est un formidable champ créatif. Je tombe amoureuse de mes projets. À un moment donné, je sens que j’arrive à la fin de l’élaboration. C’est un moment euphorique. Soudain, il faut passer à la phase chantier et, d’un seul coup, un sentiment complètement inverse m’envahit : le projet va devenir réalité et c’est la panique totale. En réalité j’apprécie toutes les étapes d’un projet, sauf, peut-être, la question du budget.
Après l’industrialisation au xixe siècle, la globalisation au x xe siècle, quels sont, selon vous, les thèmes importants pour le XXIe siècle ?
Au XXe siècle, on a essayé d’être global, mais on a oublié de respecter nos différences. Il faut désormais absolument prêter attention aux autres. Être global, certes, mais sans être homogène, tel est le défi de ce nouveau siècle.