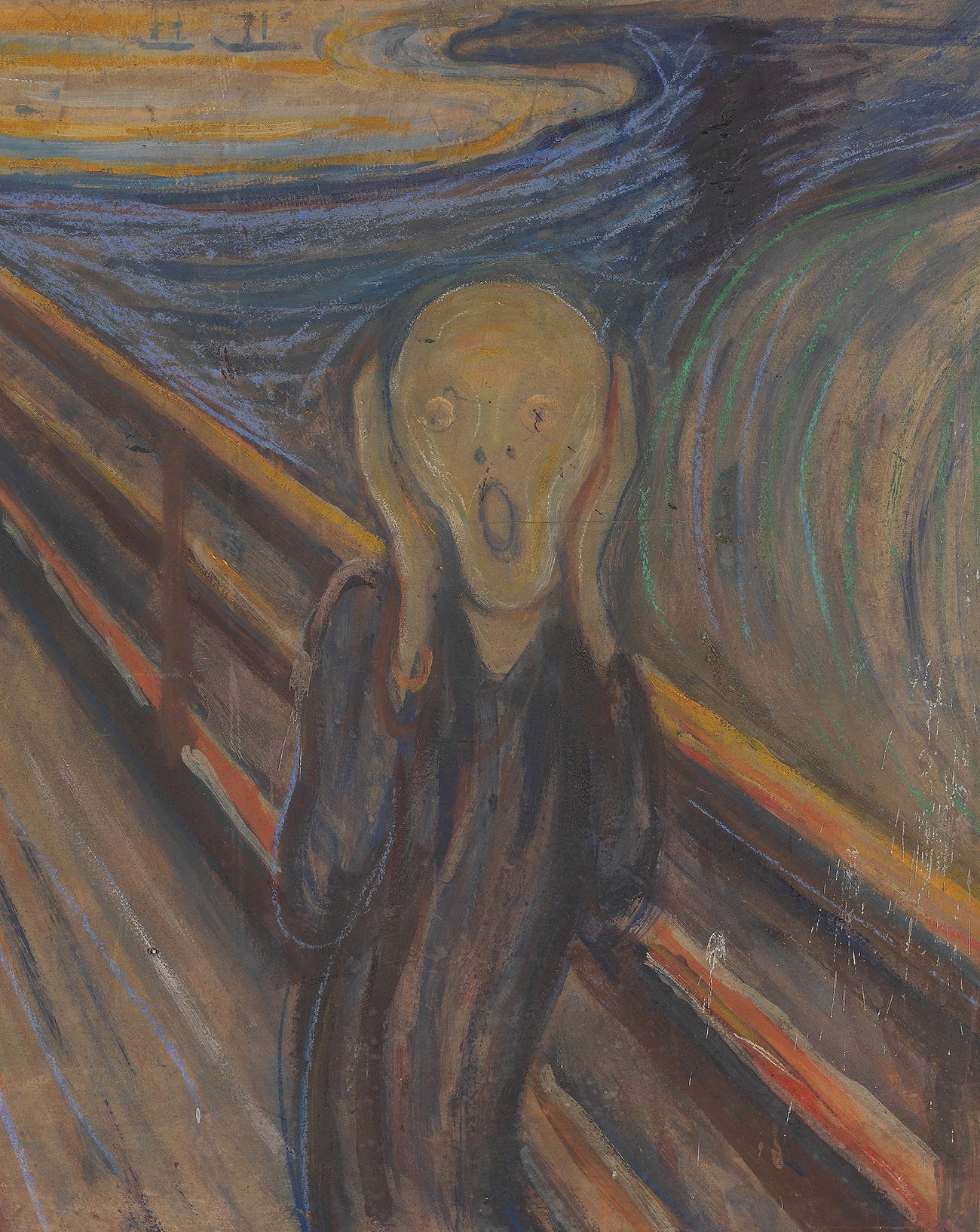13

13
Rencontre avec Mohamed Bourouissa pour sa grande rétrospective au Palais de Tokyo
À l’occasion de sa grande rétrospective inaugurée au Palais de Tokyo, l’artiste franco-algérien Mohamed Bourouissa revient sur son parcours éclectique et hors du commun.
En collaboration avec Paris+ par Art Basel.
Sur ses débuts dans l’art
“Je suis devenu artiste un peu par hasard. Ma famille n’était pas du tout dans ce milieu. Quand je suis arrivé en France à l’âge de quatre ans, je ne parlais pas la langue. J’ai commencé à dessiner très tôt, et c’était à la fois un moyen de communication et un refuge pour moi. Je recopiais beaucoup les dessins animés du Club Dorothée, et ça me valait la reconnaissance des copains et copines.
Je ne savais pas vraiment ce qu’était l’art. Quand j’étais au lycée, j’ai commencé à côtoyer des amis avec qui je faisais du graffiti. Il y avait une dynamique collective, qui me suis encore aujourd’hui, et je me suis aussi essayé à la danse et au rap, en plein boum à l’époque. J’ai ensuite rejoint une école de dessinateur maquettiste, dans laquelle on avait des cours de nature morte et des visites de musées qui ont été formatrices.
Puis il y a eu la photographie. J’ai fait la rencontre de la photographe Anoushka Shoot, qui était à l’époque étudiante aux Beaux-Arts. C’est avec elle que j’ai réalisé ma première série photo Nous sommes Halles (2002-2003). Je faisais de la photo avant, mais sans intention précise. Le travail du photographe américain Jamel Shabazz a aussi été un déclencheur, qui m’a permis de regarder différemment mon environnement et le monde dans lequel j’étais.”
Sur ses études, des Arts déco au Fresnoy
“Aux Arts déco, j’ai fait la rencontre de profs comme Florence Paradeis et Christian Courrèges, qui m’ont enseigné ce qu’était la photographie et la technique, et de l’artiste Jean-Luc Moulène, qui pense la photographie comme objet conceptuel. C’est à cette période que j’ai commencé la série Périphérique que j’ai présentée en Chine, à un festival de photographie. La série a eu un vrai retentissement : j’ai eu mes premiers articles dans la presse française et j’ai été mis en contact avec la galerie Les filles du calvaire, à Paris. C’est à ce moment-là que les choses d’un point de vue financier ont commencé à se mettre en place.
Plus tard, j’ai voulu refaire des études parce que j’avais besoin de me retrouver et d’expérimenter, et je suis parti au Fresnoy. Et c’est là que j’ai fait Temps mort (2009), qui était ma première vidéo. Le film raconte la rencontre de deux personnes, une à l’intérieur, en prison, et l’autre à l’extérieur, mais surtout une expérience humaine. Ce travail a été présenté à la Biennale de Berlin 2010 et m’a permis de prendre part à la Biennale de Venise en 2011. Comme avec Périphérique, les gens voyaient des images, mais moi, je voyais davantage les rapports humains, le fait d’aller sur le terrain, de créer de la confiance, de laisser les autres s’incarner.”
Sur ses obsessions, des cowboys afro-américains aux jardins sonores
“En 2013, j’ai découvert le travail de l’artiste Martha Camarillo, cinéaste et photographe, et j’ai réalisé un travail auprès d’un groupe de riders, des cavaliers, issus de la communauté noire américaine. Nous avons grandi avec les westerns, mais j’ai réalisé à quel point il y a eu une sorte de whitewashing par Hollywood de la figure du cowboy dans l’imaginaire collectif. J’ai voulu raconter cette réalité invisibilisée. Mais on reste toujours extérieur, d’une certaine manière, et ça je voulais le raconter aussi – ce rapport entre un artiste qui essaie de faire des projets et la réalité du terrain.
Depuis quelques années, je m’intéresse de plus en plus au vivant, à l’environnement. Il y a mon intérêt pour les jardins, né de la rencontre avec Bourlem Mohamed [un patient du psychanalyste et écrivain Frantz Fanon], qui s’occupait du jardin de l’hôpital psychiatrique de Blida, ma ville natale, en Algérie. Il m’a marqué parce qu’il avait une véritable manière de penser le jardin, de l’organiser et de le mettre en espace, mais aussi un rapport thérapeutique aux plantes, et j’ai voulu apprendre de lui. J’ai d’abord recréé un jardin à sa manière pour la Biennale de Liverpool en 2018. En 2020 à Sidney, avec l’installation sonore Brutal Family Roots, j’ai en partie tenté de rendre audible l’activité électrique des plantes, pour les montrer comme sujets (et non objets) et à quel point elles ont un impact sur nous. Pour l’exposition au Palais de Tokyo, je prépare un nouveau jardin, entre autres choses.”
Une œuvre évolutive, entre court-métrage engagé et aquarelles improvisées
“Ça fait presque 20 ans que je crée, donc avec le temps, on change, on grandit, on se transforme, et par curiosité, on va explorer d’autres formes. Ça se passe par rebondissements, souvent : quand j’ai commencé à travailler avec Bourlem Mohamed sur les jardins par exemple, je ne me suis pas posé la question de la forme. Je voulais rentrer dans la matière avant tout. Depuis le début, le rapport à l’expérience, c’est ce qui sous-tend tous mes travaux. La question de la forme découle de cette expérience.
Ça fait trois ans que je travaille sur un court métrage qui va s’appeler Généalogie de la violence, que je vais présenter au Palais de Tokyo et qui retrace l’histoire d’un contrôle de police. L’idée, c’est de filmer l’événement dans sa banalité et de montrer l’expérience de dépossession du corps qui se joue. Je pense beaucoup à Gilles Deleuze, qui parlait de la société de contrôle ; on est en plein dedans. La question du contrôle revient souvent dans mon travail – le contrôle du corps, du territoire, de l’histoire, la manière de quadriller la pensée. En parallèle, je travaille sur des aquarelles abstraites qui sont pour moi très proches de l’improvisation du free jazz et représentent au contraire un exercice de lâcher prise, avec l’eau, le flux, la dispersion. Je suis beaucoup plus sur la sensation. »
“Mohamed Bourouissa. Signal”, du 16 février au 20 juin 2024 au Palais de Tokyo, Paris 16e.
Mohamed Bourouissa est représenté par Mennour (Paris) et Blum (Los Angeles, New York, Tokyo).
Louise Darblay est critique d’art, rédactrice et traductrice. Elle vit à Londres.