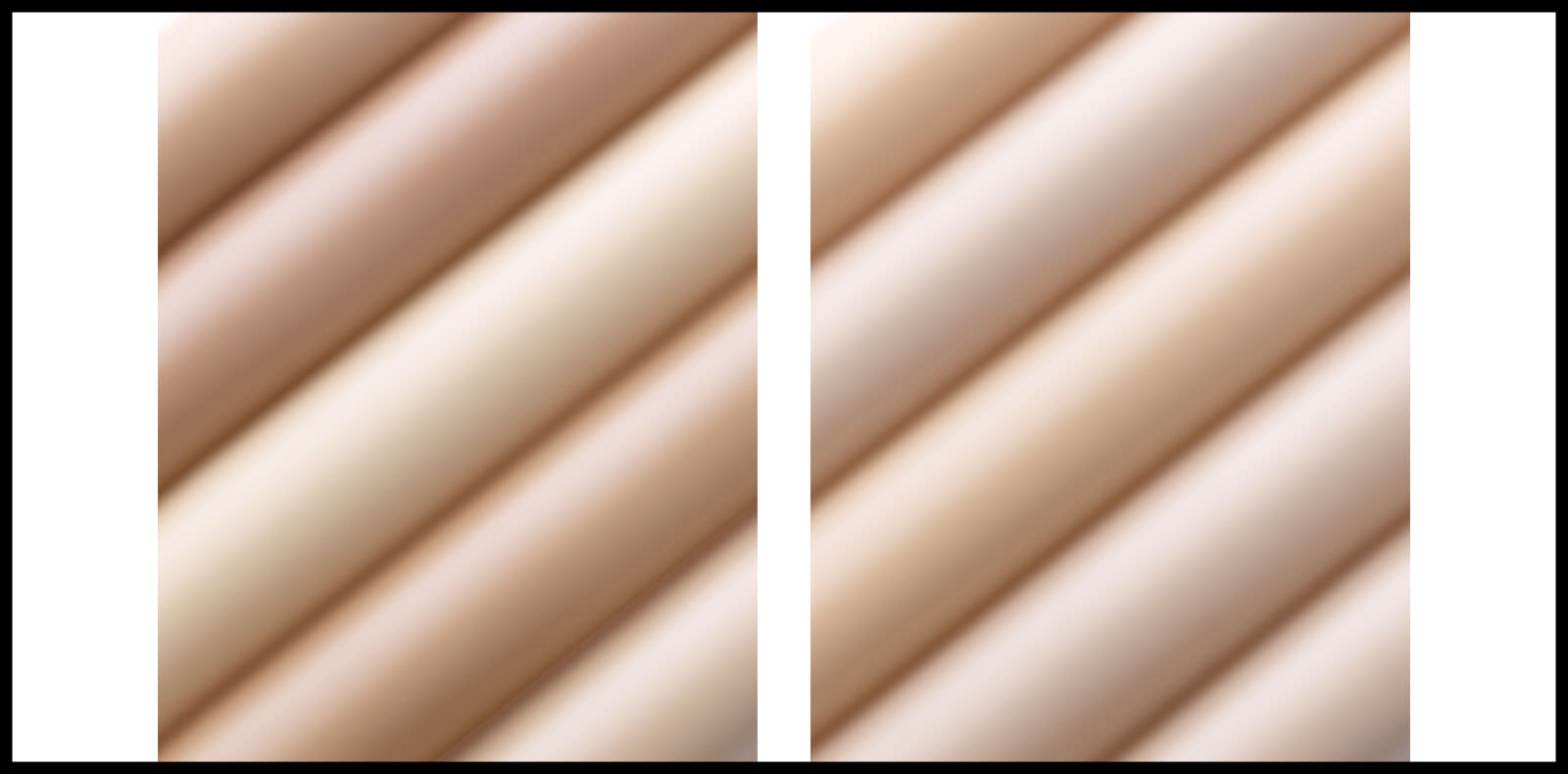31

31
Disparition de Bob Wilson, légende de la mise en scène et maître de la lumière
Sa signature formelle, étrange et minimaliste, est reconnaissable entre mille. Depuis les années 70, le légendaire Bob Wilson a mis en scène des opéras sur les musiques des plus grands génies contemporains ou disparus. Le maestro vient de s’éteindre à l’âge de 83 ans, des suites d’une maladie. Il y a quelques mois, l’Américain recevait Numéro Homme dans son célèbre Watermill Center, au cœur des Hamptons, pour un entretien exclusif.
Portraits et photos par Jason Schmidt,
Texte par Matthieu Jacquet.

Rencontre avec Bob Wilson, père du théâtre expérimental
À deux heures de route de Manhattan, au bout de l’île de Long Island, la région des Hamptons s’est imposée, depuis le 20e siècle, en eldorado pour les artistes new-yorkais. Willem De Kooning, Jackson Pollock et Lee Krasner dans les années 40, Rashid Johnson et Sheree Hovsepian aujourd’hui… Comme eux, Robert Wilson – dit Bob Wilson – a succombé au charme de l’île cossue balayée par la brise de l’océan Atlantique.
Depuis plus de trente ans, le metteur en scène et artiste américain né en 1941, considéré comme le père du théâtre expérimental, y possède son propre lieu de résidence et “centre interdisciplinaire pour les arts et les humanités” : le Watermill Center. Sis sur une petite colline, son domaine de quatre hectares comprend un bâtiment de deux étages en forme de U niché au cœur d’un vaste terrain.
Autour, des érables, des pins et des hêtres composent une forêt dense et rassurante où l’on croise des colonnes en pierre gravées de l’ère Ming et des mégalithes datant de 3 500 ans avant J.-C., probablement issus d’un ancien site funéraire sacré, qui font face à la façade de briques claires du bâtiment et sa grande cour de gravier blanc. Même désert, et en plein hiver, le site dégage d’emblée une aura exceptionnelle.
Le Watermill Center : un centre d’art fondé par Bob Wilson
Alors que, depuis les années 60, l’imaginaire poétique et foisonnant de Bob Wilson se déplace de salle de théâtre en salle de théâtre, ce site immuable forme sans doute l’image la plus prégnante de la diversité de son activité, mais aussi de son héritage. Constamment en déplacement aux quatre coins du monde, jonglant entre ses nouvelles productions scéniques, les reprises de ses anciennes pièces et les expositions de ses dessins et sculptures, l’artiste aujourd’hui âgé de 83 ans vit ici quelques mois dans l’année, mais souhaite garder ce lieu ouvert à tous en permanence.
“Dans la ville médiévale occidentale typique, la cathédrale était le point culminant, mais aussi le lieu où tout le monde pouvait entrer, qu’on soit riche ou pauvre”, explique l’Américain, alors qu’il nous accueille dans son fief éclairé par un soleil hivernal. “C’était dans cet endroit que la musique était composée, que la peinture était exposée. Nos communautés ont besoin de ces centres – et c’est de ce désir qu’est né le Watermill Center.”

Plus de 8 000 œuvres et objets d’art
Une atmosphère chaleureuse qui se ressent dès notre entrée dans le bâtiment. À gauche, une cuisine ouverte débouche sur une grande salle en contrebas où trône une immense table circulaire en bois clair, propice à des réunions comme à des dîners conviviaux. Autour d’elle, des dizaines de sculptures sur socles offrent un premier aperçu prometteur de la riche collection de plus de 8 000 œuvres et objets d’art que constitue l’Américain depuis des décennies.
Outre les bouddhas et les masques tribaux africains, on reconnaît la chaise Zig-Zag de Gerrit Thomas Rietveld, pièce iconique du design moderne, mais aussi un tabouret d’Alvar Aalto, tous deux témoignant de la passion de Bob Wilson pour les assises. “Je ne m’assois quasiment jamais sur ces chaises, j’aime juste les avoir sous les yeux, commente l’octogénaire avec un clin d’œil. Comme tout ce que je possède, si je collectionne ces objets c’est avant tout parce que j’aime les regarder.”
Un incubateur niché à Long Island
Lorsque Bob Wilson découvre ce bâtiment au milieu des années 80, il est alors un jeune metteur en scène à succès qui vient de lancer sa fondation, la Byrd Hoffman Water Mill Foundation, et cherche un lieu “incubateur” pour des artistes. Ancien laboratoire de recherche de la Western Union laissé à l’abandon depuis vingt ans, le domaine offre un grand potentiel à l’Américain, enthousiasmé par tout ce qu’il pourra y faire.
“Quand j’étais enfant, j’avais pour habitude de déplacer tous les meubles de ma chambre, de tout pousser contre les murs, juste pour pouvoir appréhender l’espace”, se souvient l’artiste, alors qu’il nous présente les bureaux de l’équipe du centre, où s’alignent de nombreuses plantes baignées par la lumière qui entre par les grandes fenêtres.

Un projet ouvert au monde entier
En 1992, le Watermill Center est créé. Il ouvre officiellement ses portes au public en 2006, après quatorze années de grands travaux pour aménager des bureaux, des salles d’exposition, de création et de répétitions, des espaces de stockage pour les œuvres et la collection, une bibliothèque, une salle d’archives, ainsi que le propre appartement de Bob Wilson, au second étage. “Le projet de ma fondation reposait sur quelques principes essentiels : regarder le passé pour avancer, soutenir la communauté d’artistes locale, et l’enrichir en regardant et en défendant l’art du monde entier.”
“Quand j’étais enfant, j’avais pour habitude de déplacer tous les meubles de ma chambre, de tout pousser contre les murs, juste pour pouvoir appréhender l’espace.” – Bob Wilson.
Des valeurs fondamentales pour un homme qui trouve sa place dans le New York des années 60, alors en pleine période de renouveau dans les arts vivants grâce à John Cage, Merce Cunningham, Trisha Brown ou encore Yvonne Rainer. Dans son loft, à l’époque, Bob Wilson organise des “movement workshops” (“ateliers de mouvement”) avec des performeurs de tous horizons, mais travaille aussi avec des patients hospitalisés pour poliomyélite. En 1970, le jeune Américain présente Le Regard du sourd, un opéra silencieux de sept heures inspiré par l’histoire et la perception d’un jeune adolescent sourd qu’il a rencontré dans la rue, puis adopté. Sortant des carcans de la narration théâtrale habituelle, cette œuvre témoigne également d’un parti pris : ouvrir les portes de l’art à ceux qu’on y croise encore rarement, pour l’enrichir de nouveaux points de vue.

Une utopie artistique signée Bob Wilson
À travers ses nombreuses initiatives, le Watermill Center ne cesse aujourd’hui de concrétiser les espérances de Bob Wilson. Chaque année, des artistes et des collectifs du monde entier postulent pour développer leurs projets sur place en s’inspirant du lieu, de sa collection et des autres résidents. L’été, le centre s’anime davantage en invitant vingt candidats à présenter, pendant quatre semaines, expositions, performances et installations, dans le bâtiment ou dans la forêt. L’institution organise également des partenariats avec des écoles des environs, et, tous les samedis, accueille des visiteurs pour un tour guidé du site. Une utopie artistique dont l’initiateur semble aujourd’hui très fier, lui qui fut inspiré par les politiques culturelles d’André Malraux dans les années 60.
Comme un poisson dans l’eau, Bob Wilson évolue d’une salle à une autre du Watermill Center en identifiant de mémoire les pièces qui composent sa collection : des reliques d’Égypte antique, des masques de l’île de Java, des vases chinois du néolithique ou encore un dessin d’Agnes Martin et une fenêtre de Frank Lloyd Wright… mais aussi les œuvres des nombreuses figures qu’il a côtoyées, comme son ami le sculpteur Paul Thek, auquel il consacre une salle d’exposition entière, ou encore Marlene Dietrich, dont il possède une paire de chaussures soigneusement présentée sous verre.
Le jour où il invita Marlene Dietrich à dîner
Le metteur en scène, qui n’a rien perdu de son humour ni de sa vivacité d’esprit, se plaît à raconter le jour où, à seulement 27 ans, il a osé inviter la grande actrice allemande à un dîner en tête à tête. Marqué par le contraste entre sa posture impressionnante et la chaleur de son timbre, il déclare depuis à ses acteurs : “Le corps doit être de glace et la voix comme du feu.” Parmi les centaines de créations scéniques signées par Bob Wilson, s’étendant des opéras de Wagner et Debussy à la réadaptation de textes de Shakespeare, en passant par les fables de La Fontaine, une rétrospective de la vie de son amie Marina Abramović (2011) et de nombreuses créations originales, deux constantes aident à reconnaître presque instantanément sa signature : l’éclairage et la gestuelle ultra précise, voire chorégraphique des acteurs.
Qualifiées de “minimalistes”, ses mises en scène reprennent régulièrement des arrière-plans immaculés où l’horizon apparaît dans une lumière froide, voire bleutée. Celle-ci souligne l’expressivité des visages, souvent peints en blanc, tandis que les corps, décors et accessoires se découpent distinctement sur le fond en raison de leurs silhouettes élémentaires. Avant d’être des opéras, les créations de Bob Wilson sont de véritables tableaux vivants.

Pour preuve, à chaque fois que le metteur en scène nous dévoile une nouvelle salle du Watermill Center, son premier réflexe est de chercher l’interrupteur. Un geste loin d’être anodin : pour lui “la lumière construit l’espace, sans elle, il n’y a rien”. Le hall qui relie les deux ailes du centre comporte deux ouvertures verticales. Sans portes, elles permettent à la lumière naturelle – et au vent – de traverser le bâtiment d’est en ouest, éclairant les sculptures en bois disposées à l’intérieur. C’est dans ce “cube” de briques quasiment vide que Bob Wilson nous schématise, à l’aide de son bras, la base structurelle de ses œuvres : “La ligne verticale, qui va du ciel vers le centre de la Terre, c’est le temps. La ligne horizontale, c’est l’espace. C’est à partir de cette croix que l’on construit n’importe quelle œuvre d’art.”
“La lumière construit l’espace, sans elle, il n’y a rien.” – Bob Wilson.
L’artiste nous ouvre enfin les portes de son appartement. On y découvre encore davantage de figurines, de masques et d’objets du monde entier, mais aussi des dessins de costumes réalisés pour de précédentes pièces. “Je ne suis pas très doué pour créer des vêtements”, prévient-il, plus à l’aise avec la réalisation de sculptures en verre et en céramique. Mais l’Américain n’est pas pour autant étranger à la mode : après des collaborations avec Giorgio Armani et Louis Vuitton, il vient d’accepter de mettre en scène le dernier défilé Dior femme présenté à Paris, en mars.
En attestent les piles de documents qui couvrent son bureau, Bob Wilson semble plus actif que jamais. Quelques jours après notre rencontre, il repartira pour un périple en Europe, qui passera par la Lituanie, l’Allemagne et la France, pays avec lequel il entretient une histoire très forte. À l’aube des années 70, Jack Lang, alors directeur du Festival mondial du théâtre de Nancy, et Michel Guy, fondateur du Festival d’automne, furent les premiers à apprécier son talent et à le programmer hors des États-Unis.

Des opéras architecturaux et expérimentaux
Assis derrière son bureau, Bob Wilson détaille sa méthode de travail, pendant que sa main gauche dessine sans relâche sur une feuille de papier. Doublement diplômé en peinture et en architecture, le metteur en scène dit imaginer ses créations scéniques comme des immeubles dont il doit avant tout déterminer l’armature : “Sans structure, je ne peux rien faire.” Avec son crayon, il trace plusieurs rectangles qu’il remplit plus ou moins de noir : sous nos yeux apparaissent alors les différents tableaux de The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets (1990), l’opéra écrit en collaboration avec le musicien Tom Waits et le romancier William S. Burroughs, résumés en quelques traits, jeux de vides et de pleins essentiels.
Une forme d’art total, applaudi par Susan Sontag
Bob Wilson revient aussi sur The Life and Times of Joseph Stalin (1973), création ambitieuse d’une durée de douze heures et mettant en scène une centaine de personnes. Ici, tout a commencé avec l’idée de sept actes dont chacun dialoguerait avec un autre, faisant du quatrième acte central le pivot de la pièce. Idem pour Einstein on the Beach, le fameux opéra qu’il cosigne avec le compositeur Philip Glass, et qui les a tous les deux révélés en 1976 : un opéra sans histoire linéaire, composé de neuf scènes principales déroulées sur cinq heures – là aussi, le binôme a commencé à parler de structure avant d’intégrer le texte et la musique. Vue comme une nouvelle forme d’art total, l’œuvre scénique sera décrite par la critique Susan Sontag comme “la plus importante du 20e siècle”.
À l’heure qu’il est, Bob Wilson travaille sur un tout nouveau projet à Vilnius et confie avoir là aussi défini la structure… mais pas le sujet. Le paysage arctique ? La culture inuite ? Les premières pistes sont encore très vagues. “Je travaille sur la surface, je n’ai pas besoin d’avoir une histoire à raconter”, affirme l’Américain. En effet, s’il y a bien une chose que le metteur en scène n’apprécie pas, c’est le trop narratif.
Lorsque le jeune homme débarque du Texas et se rend à Broadway, il déteste ce qu’il y voit : “Tout n’était que décoration, illustration.” À ce théâtre qu’il juge bien trop naturaliste et littéral, l’artiste répond dès ses débuts en revendiquant l’artificialité de la scène, que l’on doit envisager comme un lieu séparé du monde réel, propice à l’évasion. “Être consciemment artificiel permet d’en apprendre plus sur soi-même, et de se rapprocher d’une forme de vérité”, déclarait un jour le metteur en scène pendant l’une de ses nombreuses conférences.
Un travail silencieux, à rebours d’une époque très bavarde
D’ailleurs, dans son processus créatif, les mots arrivent bien après les mouvements. “Le langage est un obstacle à l’imagination, confie-t-il. J’interagis avec tout, dans le silence, pour commencer.” Victime d’un trouble de l’audition centrale quand il était enfant, Bob Wilson a mis du temps à associer les sons aux mots, et a rapidement pris l’habitude de préférer les images aux paroles. Aujourd’hui encore, il regarde la télévision en sourdine. À rebours d’une époque très bavarde, où l’on tend à tout expliciter, Bob Wilson préfère se désencombrer des concepts et des idées, qu’il juge ennuyeux. Une approche qui se traduit dans sa direction d’acteurs : jamais il ne s’attarde sur la psychologie d’un personnage, sur l’émotion à incarner et à transmettre, qu’il laisse à la discrétion de l’interprète et du spectateur. “Je donne seulement des directives formelles : plus vite, plus lentement, plus fort, plus à l’extérieur…”
S’il aime travailler avec des acteurs non professionnels, l’Américain a noué des relations solides avec plusieurs stars du milieu telles que Willem Dafoe et Isabelle Huppert qui, en 1993, interpréta Orlando, puis, en 2019, seule en scène, Mary Stuart dans Mary Said What She Said. Dans cette création, l’actrice a dû apprendre à se déplacer en vingt- huit minutes sur le plateau, dans un mouvement très lent, régulier et continu. Un exercice ardu auquel elle s’est pliée avec détermination : “Isabelle apprend lentement, mais elle est infatigable. Elle répètera encore et encore, jusqu’à y arriver”, confie Bob Wilson, dont Philip Glass précisait qu’il sait reconnaître un bon acteur à un simple mouvement.
“Aujourd’hui j’ai 83 ans. J’habite toujours le même corps. Je suis comme un arbre qui perd ses feuilles et dont les branches se brisent, mais je reste toujours le même arbre.” – Bob Wilson.
Pour Bob Wilson, c’est la répétition qui offre la clé de la réussite et de la liberté, que cela concerne ses acteurs ou lui-même. “Il ne faut jamais avoir peur de répéter, et de se répéter. On aurait beau commencer à jouer du Mozart à 2 ans, à 82 ans on apprendrait encore”, commente- t-il avec philosophie.
S’il arrive encore à l’Américain de douter de lui-même, surtout au début d’un nouveau projet, sa persévérance lui permet aussi de rester hermétique aux critiques. “Aujourd’hui j’ai 83 ans. J’habite toujours le même corps. Je suis comme un arbre qui perd ses feuilles et dont les branches se brisent, mais je reste toujours le même arbre.” À travers les fenêtres du Watermill Center, on aperçoit le soleil qui disparaît derrière la forêt, plongeant la pièce dans une ambiance crépusculaire. “On peut remercier le Seigneur pour la lumière que nous avons eue aujourd’hui !” conclut l’artiste, les yeux tournés vers l’horizon.