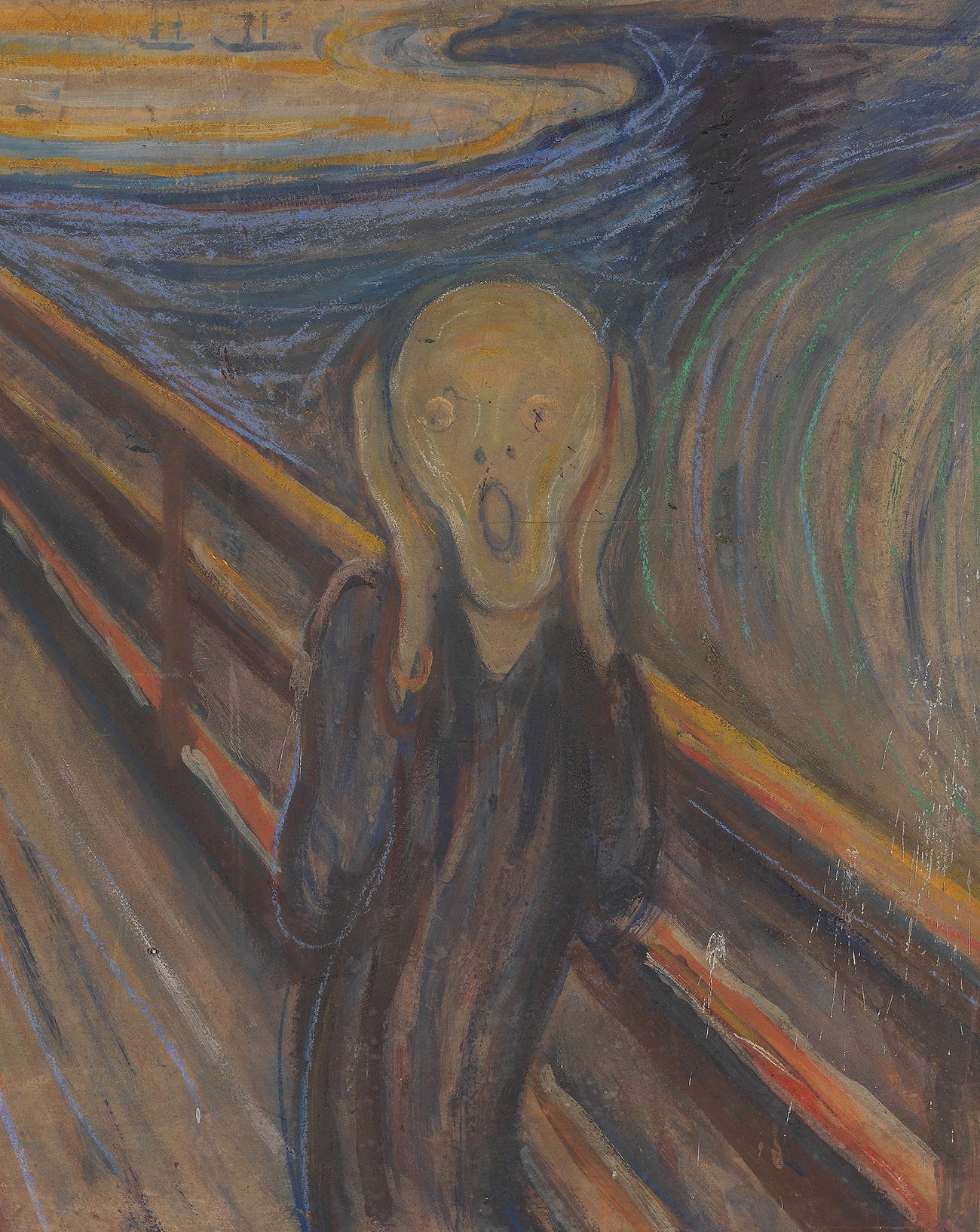8

8
Pourquoi faut-il connaître la photographe Mame-Diarra Niang, exposée à Paris ?
Jusqu’au 5 janvier 2025 à la Fondation Henri Cartier-Bresson, l’exposition de l’artiste française Mame-Diarra Niang convie les visiteurs à découvrir un travail introspectif, centré sur les limites de la mémoire et les représentations du corps noir, parfois flou, déformé ou abîmé, au contact du médium photographique.
Par Louise Menard,
et Matthieu Jacquet.


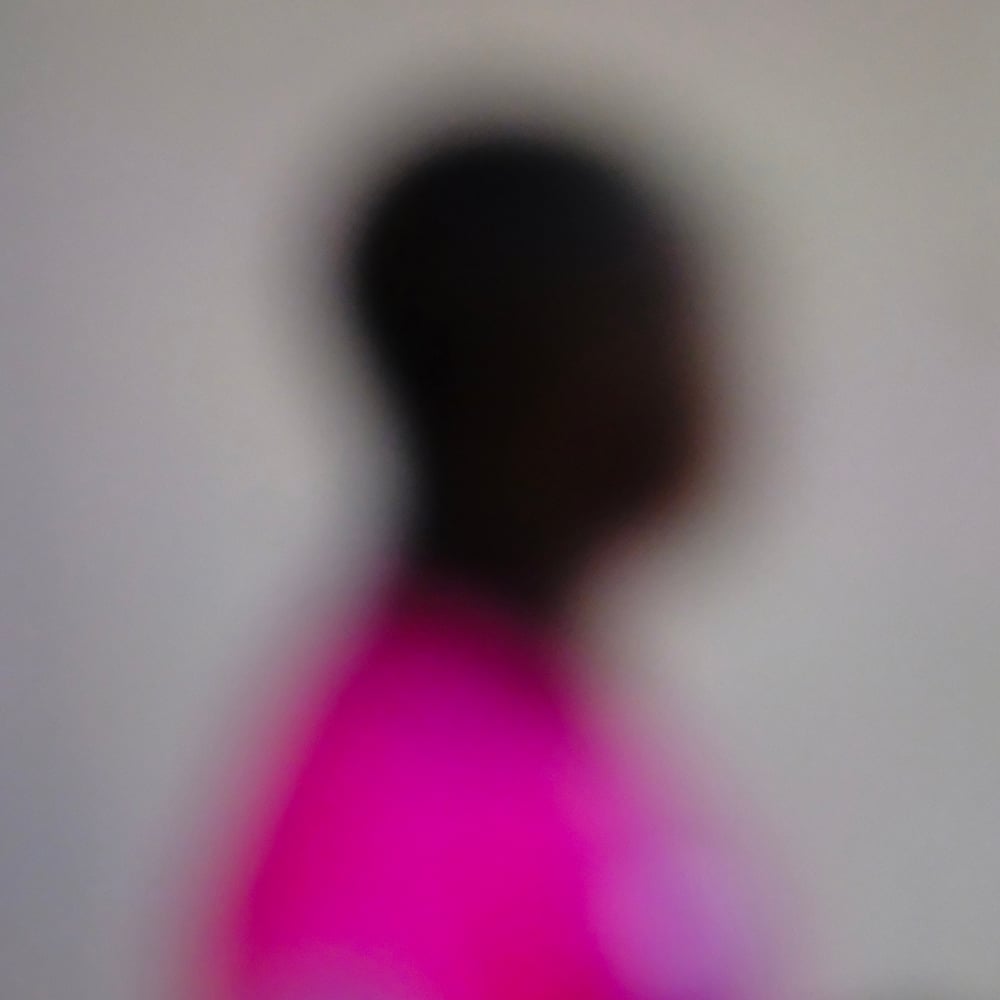
Les “non-portraits” de Mame-Diarra Niang à la Fondation Henri Cartier-Bresson
Une foule d’ombres colorées hante depuis quelques semaines les murs du rez-de-chaussée de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Telles des spectres, ces figures floues photographiées par Mame-Diarra Niang se fondent presque avec leur arrière-plan monochrome, avoisinant la peinture abstraite. Si l’on y reconnaît vaguement des têtes, rien ne permet d’identifier les traits d’un visage et ainsi appréhender une identité. Comme l’impression d’un visage qu’on aurait oublié, ou le vague souvenir d’une silhouette anonyme croisée, quelque part entre le rêve et la réalité.
Cela fait maintenant trois ans que l’artiste française a entamé cette série de clichés que l’on croise de plus en plus ces dernières années, entre foires et expositions collectives, de Dakar à Berlin. Elle en présente un échantillon dans sa première monographie en France – exposition qui, selon ses mots lors du vernissage, “parle du corps noir, et de mon corps noir”.
Pourtant, au sein de la Fondation Henri Cartier-Bresson, ces corps apparaissent presque indiscernables, perdus au milieu d’un amas de couleurs nébuleuses, accompagné çà et là de poèmes intimes… Si Mame Diarra Niang les baptise “non-portraits”, c’est justement car ces images presque illisibles se placent aux antipodes du genre, leur flou illustrant à la fois son besoin de se réapproprier son passé et ses racines africaines face à l’ambiguïté de ses souvenirs et l’invisibilisation des corps racisés.
Un voyage intime sur les territoires de son passé
La vocation de Mame-Diarra Niang pour la photographie lui vient en 2007, lorsqu’elle se rend au Sénégal afin d’enterrer son père. Ce retour aux racines incite la jeune femme à utiliser l’appareil pour capturer le pays où elle a passé une partie de son adolescence. En errant seule à travers ses paysages déserts, ponctués seulement de quelques silhouettes et de passants dont on ne distingue jamais les visages, l’artiste produit des clichés lumineux où l’architecture cisèle le ciel, donnant lieu à des compositions saisissantes par leur structure, leurs lignes et leurs formes souvent géométriques, et leur jeu habile entre les vides et les pleins.
“Ces allers-retours dans ces territoires ont forgé ma pratique artistique”, expliquait Mame-Diarra Niang au magazine Fisheye. En résultera son tout premier livre, The Citadel, publié en 2022 en trois volumes (Sahel Gris, At The Wall et Metropolis). Si ces images ne font pas partie du parcours de l’exposition parisienne, elles résonnent toutefois avec ses “non-portraits” plus récents par le nom que l’artiste leur a donné : “non-lieux”, pour évoquer les espaces liminaires et dépeuplés qu’elle a parcourus pendant des années, toujours en conservant avec eux une certaine distance. En les réalisant, l’artiste commence alors à s’interroger sur la présence fugace de son propre corps dans ces environnements.


Du glitch sur Google Maps au flou des écrans
Un événement mondial interrompra ce projet de terrain. Durant le confinement en 2020, à défaut de pouvoir retourner en Afrique, l’artiste commence à chercher sur Google Maps les lieux en Côte d’Ivoire (où elle a passé son enfance) et au Sénégal qui lui sont familiers : son école lorsqu’elle était petite, les rues et les maisons qui jalonnaient les chemins qu’elle empruntait alors et qui restent aujourd’hui ancrés dans sa mémoire.
Également exposée à la Fondation Henri Cartier-Bresson, la série Call Me When You Get There, recèle de captures d’écran de ces pérégrinations numériques, dans des coins où l’artiste a décelé des bugs de la plateforme Google Street View : ici, un corps voit sa partie inférieure disparaître, là, la silhouette d’une femme est étirée en grand sur le sol. Comme d’autres artistes avant elle, tel que l’artiste québécois Jon Rafman qui recense lui aussi des milliers de capture du site depuis 2008, Mame-Diarra Niang explore ainsi les failles dans le système. Chez elle, toutefois, ces bugs ont une résonance bien plus intime avec ses doutes et interrogations en pleine période de pandémie.
C’est en parallèle de cette série très domestique que l’artiste commence à développer ses “non-portraits”. Afin de créer ce flou si particulier, prononcé au point de transformer les corps en taches colorées, l’artiste photographie et rephotographie son écran, dont chaque nouveau cliché brouille encore davantage les contours. Peu à peu, le sujet disparaît alors dans l’abîme de l’image… Tout comme le souvenir se perd dans les tréfonds de la mémoire, laissant dans nos esprits des visions indéfinies que balayeront ou transformeront l’oubli et l’incertitude.
“Mame-Diarra Niang. Remember to Forget”, jusqu’au 5 janvier 2024 à la Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris 3e.