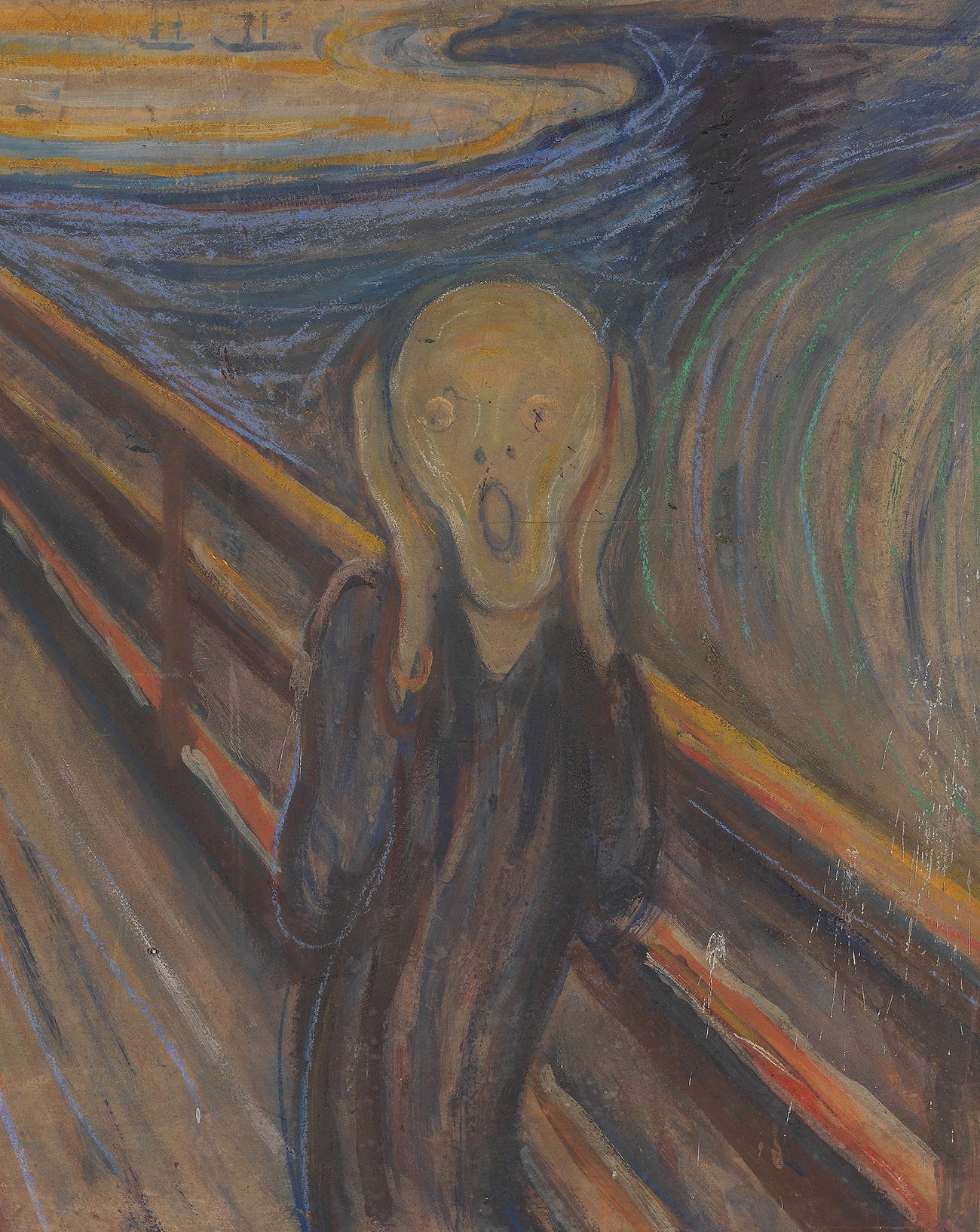27

27
Les œuvres provocantes et scandaleuses de Sarah Lucas
Depuis ses débuts dans les années 80 parmi les Young British Artists, Sarah Lucas s’intéresse à la représentation du corps féminin. S’emparant de ses attributs sexuels, elle les détourne dans ses sculptures sans visage aux poses irrévérencieuses et transgressives. L’obsession qui régit l’ensemble de son œuvre l’a menée des Bunnies en textile aux NUDS en métal qui, aujourd’hui, défient victorieusement le public avec une force de provocation toujours intacte.
Par Éric Troncy.

Discrètement, un peu avant l’été, elles se sont installées à Londres et à New York, et semblaient se réunir en conciliabule – le lockdown donnant à leurs réunions involontairement secrètes des allures de complot, auquel on ne pouvait prendre part que sur rendez-vous. Depuis leur première apparition, il y a plus de vingt ans, les Bunnies de Sarah Lucas, et leurs mutations génétiques qu’elle appelle les NUDS, ont connu des évolutions formelles qui ressemblent au développement d’une espèce inconnue et à son adaptation au biotope qu’est le monde contemporain. Évoquant l’Agrippine de Claire Bretécher autant que la sculpture de Barbara Hepworth, elles sont la preuve (presque vivante) des extraordinaires capacités de sculptrice – et de coloriste – de l’ancienne “enfant terrible” des Young British Artists, qui ne s’est pas assagie en gagnant un peu en classicisme.
Dans un élégant white cube oversize cerné de restaurants, de pubs et de wine bars de Kingly Street, près de Piccadilly Circus (Sadie Coles HQ) et dans les espaces de déambulation d’une imposante maison toute verticale (construite en 1876 et remodelée en 1956 par Edward Durell Stone, qui fut aussi l’architecte du MoMA de New York), sur la 64e Rue dans l’Upper East Side (Galerie Barbara Gladstone), les Bunnies ont pris leurs aises. Affalées dans des fauteuils de Charles et Ray Eames ou dans des sièges vintage, sur des bureaux ou sur des piles de briques en béton, affublées de baskets ou de chaussures à talons hauts et semelles exagérément compensées, elles affichent crânement, et avec lascivité, les contorsions infligées aux membres qui, tant bien que mal, composent leurs corps. Anthropomorphes, elles sont d’une espèce étrange, avec laquelle nous nous sommes familiarisés depuis qu’elles sont apparues dans notre monde, en 1997. Plus de vingt ans que nous cohabitons avec cette population qui, un peu, nous ressemble – mais qui a montré des capacités de mutation hyper rapides.

“J’ai réalisé la première Bunny de façon quasi accidentelle, j’entends par là que je n’avais pas une idée claire d’où j’allais avec les collants que j’avais pris pour matériau”, explique Sarah Lucas. Elles sont faites, en effet, de collants garnis de kapok, de coton ou de laine (selon elle, les collants mexicains de la marque Dorian Gray sont les plus résistants) et ne portent pas de vêtements en dehors de bas colorés et parfois de chaussures. Elles sont humanoïdes mais n’ont pas de visage, en tout cas pas d’une nature que nous connaissons, et leur tête fait parfois place à des membres longs comme des bras supplémentaires. L’artiste dit avoir fait l’expérience, lorsque la première Bunny fut achevée, d’un “sentiment d’‘eurêka !’ [où] vous avez soudainement envie de vous asseoir devant une bonne bière, de rire, de fumer des clopes à toute vitesse et de téléphoner dans tous les sens en disant : ‘Eh ! il faut absolument que vous veniez voir ça…’”
“J’ai commencé à faire ces choses en partie pour me tenir compagnie”, confie Sarah Lucas, qui s’est rapidement retrouvée en grande compagnie. En 1997, les huit premières Bunnies firent l’objet d’une exposition chez Sadie Coles à Londres (les deux femmes travaillent ensemble depuis les années 90), intitulée Bunny Gets Snookered (“Bunny se fait rouler”) et dans laquelle, installées sur des chaises, elles étaient disposées de part et d’autre d’une table de billard (et pour deux d’entre elles sur la table de billard elle-même) leurs bas reprenant les couleurs des boules. Depuis lors, ces créatures, affirmant de lointains liens de parenté avec les poupées de Hans Bellmer et les sculptures de Louise Bourgeois, n’ont pas vraiment grandi mais ont en quelque sorte “muté”, générant au passage une espèce parallèle que Lucas appelle les NUDS, et qui, elles, semblent parfaitement affranchies de références littérales au corps humain, en le suggérant cependant – à moins que ce soit notre regard qui soit incapable de s’en affranchir. Les collants remplis de laine et leur structure molle laissent la place à d’autres matériaux plus “durs” (le bronze, et même l’or) et dessinent une sorte de population se présentant comme assagie et embourgeoisée – mais non moins surréaliste – et qui semble plus arrogante encore.

Après une première rétrospective de son œuvre présentée en Chine, au Red Brick Art Museum de Pékin, ainsi qu’au New Museum de New York et au Hammer Museum de Los Angeles en 2018, les deux expositions qui suivirent, à Londres et à New York, célébrèrent le retour en force des Bunnies et des NUDS dans notre quotidien, sous le même titre : Honey Pie (Ma petite chérie). Ce faisant, Lucas, qu’on imagine plutôt pétrie de punkitude, cite-t-elle peut-être une chanson des Beatles : figurant sur l’album blanc paru en 1968 et dont Richard Hamilton pensa la célèbre pochette monochrome, Honey Pie débute ainsi : “She was a working girl/ North of England way/ Now she’s hit the big time/ In the U.S.A./ And if she could only hear me” (“C’était une fille qui travaillait/ Dans le nord de l’Angleterre/ Maintenant elle a décroché le gros lot/ Aux U.S.A./ Et si elle pouvait seulement m’entendre”) Dans l’imaginaire modelé par l’histoire de l’art des cinquante dernières années, on réserve souvent à Sarah Lucas la place qui revient aux agents provocateurs faisant de l’indiscipline, sinon une forme d’art, au moins une hygiène de vie. Ancienne élève du Goldsmiths College de Londres où elle fut diplômée en sculpture (ses récentes explorations de la couleur lui faisant a posteriori regretter de n’avoir pas plutôt étudié la peinture), associée à la fin des années 80 aux Young British Artists (elle a participé au Freeze show qui leur tint lieu d’événement séminal), elle est inévitablement associée aux sculptures qui firent son légitime succès. En particulier Au naturel (1994), matelas adossé contre un mur et sur lequel deux oranges et un concombre miment l’appareil génital masculin tandis qu’à côté, deux melons et un seau représentent un personnage féminin. Dans Two Fried Eggs and a Kebab (1992), un kebab a pris la place d’un sexe féminin sur un corps devenu table, deux œufs au plat faisant office de seins (lorsqu’elle exposa cette œuvre pour la première fois, Lucas vint changer les œufs au plat chaque matin) – œufs au plat dont elle s’affuble elle-même dans un autoportrait de 1996 (Self Portrait with Fried Eggs). En leur temps, ces sculptures étaient tellement chargées de provocation, tant dans leur forme que dans leurs narrations suggérées, que sembla passer au second plan cette étonnante façon de représenter des corps, c’est-à-dire la préoccupation principale de la sculpture classique. Regardée aujourd’hui en compagnie de Bunnies et de NUDS, et de leur coming out de sculptures aux préoccupations classiques justement, toute l’œuvre de Sarah Lucas semble éclairée différemment, et la représentation du corps y tenir le premier rôle.

Les NUDS offrent à l’artiste la possibilité d’expérimenter des matériaux “durs”, y compris dans la conception de socles intégrés, qui renvoient assurément à la sculpture moderniste, et donc de se confronter très directement à cette forme historique. Les Bunnies, volontiers présentées sur des socles colorés et chaussées de bas colorés eux aussi, donnent à Sarah Lucas la possibilité de se confronter à la “sculpture contemporaine” (Isa Genzken). Toutes évoquent le corps féminin, bien que les NUDS soient censés être plus abstraits – mais tirent leur nom d’une expression de la mère de l’artiste, “in the nuddy”, qui signifie “nu”. Dans la version londonienne de Honey Pie, Lucas a imaginé un dispositif de présentation pour ses sculptures dans lequel l’espace d’exposition est divisé par des murs en béton qui, très simplement, installent un décor de musée contemporain (on pense inévitablement à Bregenz), mais évoquent aussi les revêtements muraux des villas modernistes. Dans ce “décor”, leur lien avec la tradition sculpturale mise en place au xixe et xxe siècles (de la Petite Danseuse de quatorze ans de Degas aux sculptures de femmes alanguies de Matisse) s’épanouit sans distraction et sans fausse pudeur. Ce faisant, Lucas offre des versions parfaitement contemporaines de la sculpture du corps féminin : poses suggestives d’empowerment ou contorsionnées, comme entravées, multiplication des seins et sexualisation manifeste offrent tout un tas de prises à la narration sans être univoques. C’est toujours l’invention d’une forme qui domine, et l’on voit enfin distinctement quelles ombres planent sur cette œuvre : celles de Franz West, d’Edward Kienholz, de Louise Bourgeois…