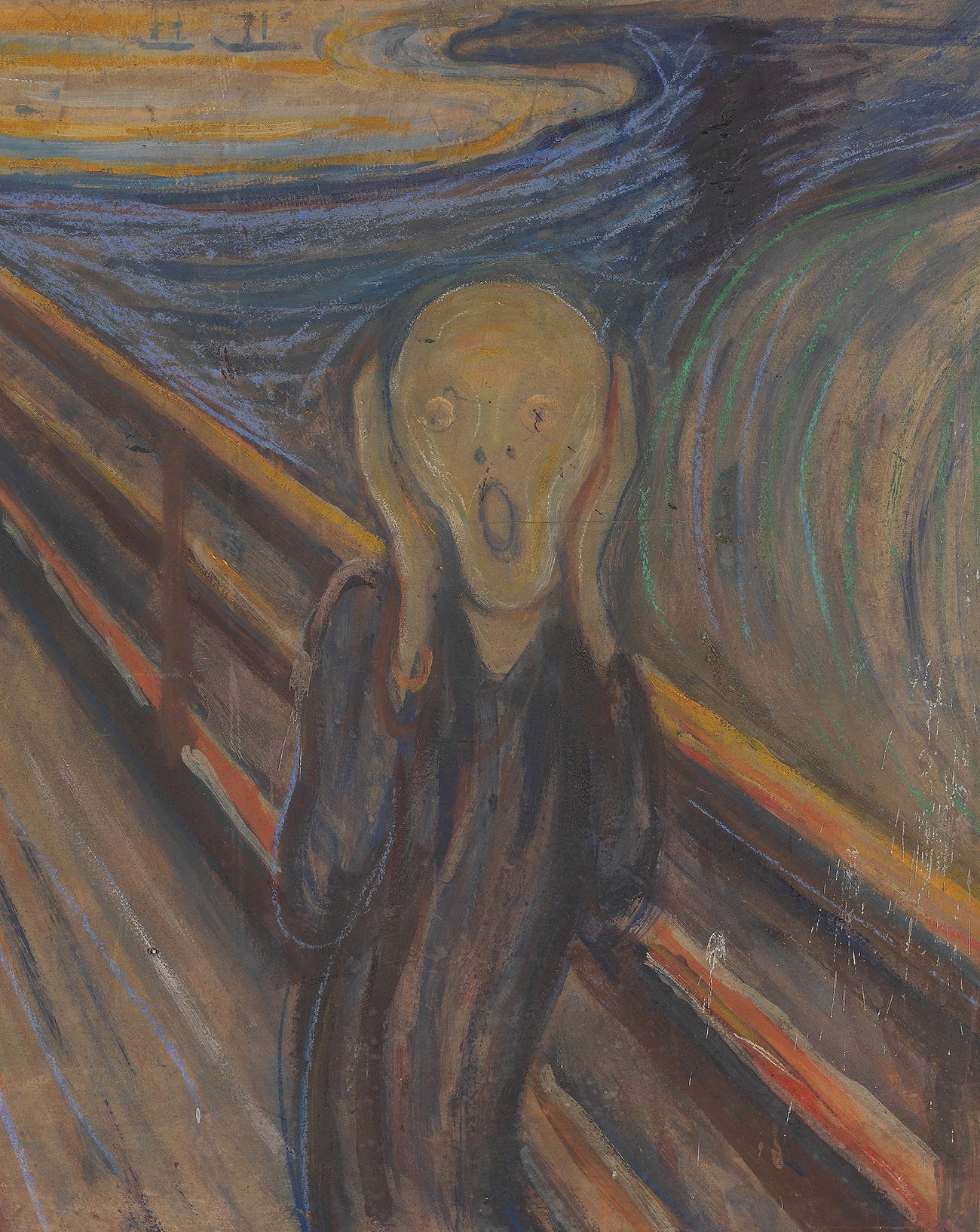25

25
Rencontre avec l’artiste Seth Price : “Les êtres humains sont des tubes”
Combinant clichés volés par téléphone ou macrophotographie de peau, l'artiste new-yorkais Seth Price recycle et redistribue le flux d’images de notre époque et brouille les repères traditionnels de l’art, du goût et de la culture, à travers des œuvres marquées par les nouvelles technologies.
Propos recueillis par Nicolas Trembley.

Sur www.distributedhistory.com, le site Internet de l’artiste, un lien renvoie à une page Wikipedia qui tient lieu de biographie et qui commence ainsi : “Seth Price (born 1973 in East Jerusalem) is a New York-based multi-disciplinary postconceptual artist. He lives and works in New York City.” [“Seth Price (né en 1973 à Jérusalem-Est) est un artiste postconceptuel multidisciplinaire. Il vit et travaille à New York.”] Cela ne veut rien dire et tout dire à la fois. Lors de sa grande rétrospective au Museum Brandhorst l’année dernière, le communiqué de presse annonçait une exposition comprenant “des sculptures, des films, des photographies, du design, des peintures, des vidéos, des vêtements et des tissus, du Web design, de la musique et de la poésie…”, bref à peu près tout ce qui est réalisable.
En effet, Seth Price est l’un des représentants parmi les plus influents et prolifiques d’une génération d’artistes qui pense et produit des images à l’ère du numérique. Sa dernière exposition à la Galerie Chantal Crousel, à Paris, est un bon exemple de l’hétérogénéité des formes de son travail qui, par fois, déroute tant il s’affranchit des classiques catégorisations du bon goût. Comme il le dit lui-même, nous ne sommes pas habitués à ce type d’images technologiques, mais cela reste de la photographie. À l’occasion de cette exposition intitulée Self as Tube, Seth Price a accepté de lever pour nous un coin du voile sur sa manière de travailler.
NUMÉRO : Sur l’affiche et le carton d’invitation de votre dernière exposition à la Galerie Chantal Crousel, on découvre un autoportrait de vous adolescent, reflété dans un miroir. Quel a été votre parcours et en quoi le contexte dans lequel vous avez grandi vous a-t-il influencé ? Pourquoi avoir choisi cette image ?
SETH PRICE : Mon parcours, le contexte ? Mais parler de ces sujets serait mortellement ennuyeux ! Ce que je peux dire, en revanche, c’est que mon entourage m’a beaucoup soutenu, et ce facteur-là a été déterminant. Sur la photo, c’est moi à la fin du collège, pris dans le cadre d’un travail scolaire réalisé à la demande d’un professeur. L’intention était de connoter l’univers photographique dont cette image est emblématique : son sérieux, le fétichisme du noir et blanc, la composition, les mots peints à la main… J’ai fait ce choix parce qu’en réalité, dans l’exposition à la Galerie Chantal Crousel, tout est photographie, sous une forme ou sous une autre. Il y a l’appareil à commande robotisée et le logiciel que j’ai utilisés pour la macrophotographie des peaux humaines. Il y a aussi ces clichés assez inesthétiques, pris au vol avec mon téléphone – des instantanés de ce que portent les gens dans les rues et le métro new-yorkais. Enfin, il y a ces procédés d’imagerie de synthèse dont je me sers pour créer les objets qui figurent dans les tableaux. Je considère les images générées par ordinateur comme un dispositif photographique en soi. L’image 3D consiste en effet à recréer une physique de la lumière et de l’optique. Une grande partie des objets en apparence “réels”, que l’on voit par exemple dans les publicités (téléphones, bijoux, voitures), sont générés par ordinateur, mais ils sont tellement convaincants qu’il est impossible de faire la différence. Pour le visiteur, aucune des trois approches représentées dans l’exposition ne sera spontanément associée à la “photographie”, mais, pour tant, toutes les trois relèvent de ce médium – et c’est ce que l’affiche tente d’exprimer à sa manière.
Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec l’art ? Comment avez-vous su que vous vouliez devenir artiste ?
Je n’ai pas vécu une “rencontre précoce” avec l’art, ni décidé, à un moment donné, que je voulais “être” artiste. Je détestais cette idée. Le dessin et l’écriture étaient des activités que je pratiquais depuis toujours, et qui faisaient partie de moi, aussi loin que remontent mes souvenirs, mais ce n’était pas un choix. J’éprouvais même une certaine hostilité envers l’art, ou ce que je croyais être l’art : une réalité construite de façon exogène par des adultes, et passablement mièvre. L’idée d’une identité de l’“artiste”, qui pourrait être désirée ou revendiquée, me semblait avant tout relative à l’opinion d’autrui, à des attentes – et je l’ai donc rejetée. J’ai mis très longtemps à accepter cette étiquette pour moi-même et je n’y suis parvenu qu’après ma première exposition, en 2004. On peut dire que j’avais quelques problèmes à régler, c’est certain.
“Dans l’idéal, nous ne devrions pas percevoir ou ressentir l’aspect technologique derrière l’oeuvre – seulement le sentiment qu’elle produit.”
Qu’aviez-vous sous les yeux à l’époque de la photo figurant sur l’affiche, et que regardez-vous aujourd’hui ?
À l’époque où j’ai pris ce selfie, j’avais au mur de ma chambre un poster de Hans Ruedi Giger [graphiste et designer suisse], et sur la porte, une photo en pied de Ronald Reagan, grandeur nature. C’était une image tirée d’un de ses films des années 50, avec un flingue et un chapeau de cow-boy. Dans les années 80, c’était la grande vogue des ninjas : avec mes amis, nous nous amusions à balancer des étoiles de ninja sur le poster… elles l’ont complètement détruit – et la porte aussi. Je bricolais aussi des affichettes des groupes que j’écoutais alors, Einstürzende Neubauten ou Throbbing Gristle, des choses dans ce genre-là, et pas mal de rap aussi. Je m’intéressais aux images de synthèse, et je découpais des photos dans des magazines d’informatique pour en faire des collages. Ce que je regarde aujourd’hui ?… Je ne sais pas trop. J’essaie de comprendre ce qu’était l’iconographie du début des années 2000. Je viens de me procurer le dernier ouvrage de Vinca Petersen 1. Honnêtement, j’aurais du mal à vous répondre. Difficile de dire ce qui mérite d’être regardé aujourd’hui, dans un monde où il y a une telle addiction aux images.
Avez-vous un support de prédilection ?
Je n’ai pas de préférence particulière pour un médium. Cela dit, certains sont incontestablement plus faciles d’accès en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. À cet égard, j’envie d’ailleurs un peu les écrivains. Leurs outils sont bon marché, réduits au strict minimum et disponibles absolument par tout. L’écrivain peut travailler dans son coin, tout seul, par tout et tout le temps. C’est un art de “camp d’entraînement pour survivalistes”, qui peut confiner à la névrose. C’est un peu la même chose pour le dessin : une histoire à raconter et des lignes. C’est aussi ce par quoi j’ai commencé. Une pratique artistique capable de survivre à la fin du monde.
“Difficile de dire ce qui mérite d’être regardé aujourd’hui, dans un monde où il y a une telle addiction aux images.”
Votre travail implique souvent des processus technologiques complexes. Quel intérêt portez-vous aux images de synthèse ?
L’enjeu n’est pas de rechercher la complexité, mais plutôt l’absence de familiarité. L’image photographique traditionnelle fait elle aussi intervenir des technologies de reproduction complexes, mais nous n’y pensons pas parce que cette technique nous est familière. Parfois cependant, on a envie de créer une image ou une impression qui nécessite de recourir à des méthodes inhabituelles, et il faut alors utiliser l’image de synthèse. Pour cette macro, par exemple, je voulais reproduire une image en grand format et à très haute résolution, parce que c’est quelque chose que l’on ne rencontre jamais dans l’univers commercial. Personne n’a besoin d’un tel degré de détail à grande échelle : le jeu n’en vaut pas la chandelle. De près, les publicités placardées sur les flancs des bus, par exemple, vous offrent une image pourrie, éclatée en pixels de faible résolution – et ça ne dérange personne. Il n’existe donc pas d’outil pour produire une image telle que je la voulais, et il m’a fallu trouver des solutions un peu inhabituelles. Une méthode inhabituelle aboutit à une oeuvre d’art qui produit un effet différent, lui aussi. Dans l’idéal, nous ne devrions pas percevoir ou ressentir l’aspect technologique derrière l’oeuvre – seulement le sentiment qu’elle produit.

Dans votre pratique, comment abordez-vous les images d’archives et le recyclage d’images existantes, notamment tirées de films ? Selon vous, la question de l’appropriation est-elle encore pertinente ?
Toutes les sources sont valables. À mes yeux, peu importe ce que j’utilise à partir du moment où cela fonctionne. De mon point de vue, l’appropriation n’est pas un sujet particulièrement intéressant – en tout cas, il ne l’était pas au moment où je suis arrivé sur la scène artistique. Dans ma pratique, je n’ai d’ailleurs jamais été un adepte des stratégies d’appropriation. Que l’on ait pu me percevoir comme un “artiste d’appropriation” était un vrai malentendu, une manière un peu hâtive et brouillonne de m’associer à un groupe d’ar tistes ou de me coller une étiquette.
La mise en espace de votre travail est-elle importante pour véhiculer votre message ? Comment se traduit‑elle dans vos expositions ?
J’essaie de faire en sorte que tout cela présente un intérêt pour le public – et pour moi‑même. Ça peut paraître simple, mais si vous en faites une règle à respecter, vous allez vous retrouver confronté à toutes sortes d’absurdités.
Comment choisissez-vous les titres de vos pièces ?
Au tout dernier moment. C’est en dressant la liste définitive des oeuvres, à moins d’une semaine du vernissage, que j’ai par exemple pris conscience que celles que j’avais sélectionnées constituaient ce qui pourrait s’apparenter à l’investigation d’un “espace social” [Social Space, titre de la série]. C’est devenu important pour cette exposition en particulier, et l’émergence du
thème s’est faite en envisageant tous les titres en même temps, dans l’urgence.
“Les êtres humains sont des tubes. Du point de vue strictement physique, nous sommes des tubes sombres, humides, enroulés sur eux-mêmes, avec des ouvertures aux extrémités.”
Sur plusieurs oeuvres figurent des macros de peaux, de très gros plans sur des corps. Comment cette série a-t-elle débuté ?
En 2015, j’ai eu envie de créer des images extrêmement détaillées de peaux humaines – tous âges, toutes origines ethniques et tous genres confondus. La peau peut apparaître comme quelque chose de banal et de familier, mais elle est en même temps troublante, étrange et provocante. J’aime ce qui est à la fois vide et plein. Ces caissons photographiques lumineux
ont été exposés pour la première fois en 2016, à l’espace 356 S. Mission Rd. (à Los Angeles), puis lors des rétrospectives organisées à Amsterdam et Munich.
Certaines images de la série Social Space relèvent d’une photographie figurative plus classique, par exemple celle où l’on voit un enfant dans la rue. Comment se passe cet aller-retour entre figuration et abstraction ?
Il n’y a pas d’aller-retour. L’exposition est entièrement consacrée à la photographie figurative. Et en même temps, l’exercice d’abstraction s’applique systématiquement. L’espace social luimême est à la fois figuratif et foncièrement abstrait. Vous pourrez toujours montrer du doigt une chose en apparence concrète et déclarer : “Nous sommes tous d’accord, cette chose-là n’est que ce qu’elle est…” Pour autant, notre façon de la comprendre ne sera jamais absolue.
“J'aimerais que ma pratique artistique serve à mettre l’accent sur des sensations ou des sentiments inhabituels.”
Que signifie exactement Self as Tube, le titre de l’exposition ?
C’était également un titre de dernière minute, donc laissez-moi réfléchir… Tout d’abord, les êtres humains sont des tubes. Du point de vue strictement physique, nous sommes des tubes sombres, humides, enroulés sur eux-mêmes, avec des ouvertures aux extrémités. En un sens, un appareil photo est aussi un tube. Je suis un tube : le matériau entre, puis il est modifié par son passage à travers un filtre. Lorsque je choisis ce vieux selfie pour le mettre sur l’affiche en le reliant à ce corpus d’oeuvres nouvelles, je crée une sorte de tunnel temporel, un tube qui traverse le temps.
Votre pratique artistique a-t-elle vocation à transmettre quelque chose ?
J’aimerais qu’elle serve à mettre l’accent sur des sensations ou des sentiments inhabituels.
En quoi consistera votre prochain projet ?
Au tournant du millénaire, pendant cinq ou six ans, je me suis mis très sérieusement à la photographie. Pas en tant que pratique artistique, mais j’avais toujours un appareil et je prenais des photos en mode “viser déclencher” : je capturais New York et les gens avec qui j’étais. Ces photos sont restées pendant des années dans un car ton. Ces trois derniers mois, j’ai passé en revue plusieurs milliers de négatifs et de diapos. J’avais envie d’utiliser ce matériel, de le traiter comme un regard ready-made posé sur les années 90, au moment où l’on est passé de l’analogique au numérique grâce à l’introduction des nouvelles technologies. Un regard sur New York à l’ère du 11-Septembre, les derniers soubresauts d’un XXe siècle fatigué. Personne ne sait encore exactement ce qui s’est passé à ce moment-là, et ça fait – quoi – quinze ou vingt ans ? À quel autre moment de l’histoire de l’art a-t-il été possible de se pencher sur un passé déjà aussi lointain, sans avoir ne serait-ce qu’un récit officiel de ce qui s’est vraiment produit ?